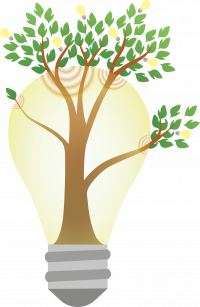Auteure : Brunhild
Il y a quelques mois de cela, j’avais rédigé une ébauche d’article sur la « valeur travail ». Il m’a semblé urgent de la remettre au goût du jour : plus que jamais, en ces temps de confinement, où une partie de la population est en télétravail, une partie au chômage technique, nous voilà confronté·e·s aux questions suivantes : quelle est l’utilité de notre travail ? Est-il indispensable de travailler autant que nous le faisons ? Les emplois les plus rémunérés sont-ils les plus utiles ? N’y a-t-il qu’une manière de réaliser son travail ? Et d’abord, qu’est-ce que le travail ?
Depuis longtemps se creuse un fossé entre les anciennes et nouvelles générations sur ce qu’est le travail, la « valeur travail », ainsi qu’entre ceux qui pensent « économie » et ceux qui pensent « utilité sociale ». Certes, cette dichotomie est un peu caricaturale, mais il est certain que le discours conventionnel de la classe dominante sur « le travail » et « la valeur travail », est de plus en plus mis à mal, notamment auprès des jeunes, des plus démuni·e·s, et de ceux qui s’alarment de la crise sociale et climatique que nous traversons. Dans le milieu des étudiant·e·s « favorisé·e·s » dont beaucoup d’Ingénieur·e·s Engagé·e·s sont issu·e·s, cette mésentente est la source de profondes frustrations. Beaucoup d’entre nous, comme rappelé dans l’article de Nicolas (Projet “Livre” : Une œuvre collective pour un récit commun), avons vu nos études financées par nos proches qui espéraient nous voir emprunter la « voie royale » du travail, CDI confortable et bon salaire à la clef. Comment comprendre que l’on puisse rejeter cette chance ? D’où vient ce désaccord ? Pourquoi, aujourd’hui, le « travail » et la « valeur travail » ne sont-ils pas ou plus satisfaisants ?
Le « travail » : que met-on derrière ce mot ?
Qu’est-ce que le travail ? Y a-t-il une seule définition ? Quelle évolution a-t-il connu ? Lorsque l’on parle de « travail », ce mot parle à tout le monde. Pourtant, lorsqu’on essaie de le définir sémantiquement, les choses se compliquent : ce mot si banal et si usité prend soudain des contours flous, et on réalise qu’il est difficile d’y accoler des caractéristiques précises et consensuelles. Pour essayer de cerner ce que nous mettons derrière ce mot, parlons tout d’abord de ce qu’il nous évoque.
D’après Dominique Méda [1], les Français·es considèrent particulièrement que le travail occupe une place très importante dans leur vie, pour trois raisons principales :
– parce qu’il serait une obligation envers la société, selon une forme d’« éthique du devoir » ;
– parce qu’il assure un revenu et donc une sécurité ;
– parce qu’il permet une forme d’épanouissement.
Intéressons-nous au premier point : le travail est considéré comme un devoir. Cela fait écho à la notion de « valeur » soulignée par un grand nombre de politiciens, comme Nicolas Sarkozy [2]. Devoir et valeur ont tous deux une dimension morale. Cette notion de travail-devoir renvoie à notre compréhension profonde et originelle du travail. Pour la comprendre, il nous faut réaliser un petit exercice et imaginer comment cette notion a pu apparaître et s’ancrer dans nos crânes d’Homo sapiens sapiens.
Quand l’Homme a-t-il commencé à travailler ? Toujours, pourrait-on penser, si l’on considère comme travail toute activité vouée à assurer sa survie. L’Homme a commencé par la chasse et la cueillette, activité qui lui permettait directement de récupérer le fruit de ses efforts. Oui, mais l’Homme ne mangeait pas toujours directement ce qu’il cueillait ou chassait : il fallait ramener la nourriture, la cuire, la préparer, la partager. Les tâches étaient segmentées. Si quelqu’un ne partait pas à la chasse ou à la cueillette, il n’en méritait pas moins de manger s’il exécutait une tâche utile au groupe telle que faire la cuisine. Il y avait déjà une notion d’échange : ta force de travail contre la mienne. Bien sûr, rien ne garantit que les choses se sont réellement passées de manière aussi équitable, mais gardons ce schéma simplifié en tête pour analyser notre compréhension implicite du travail.
Voilà proposée une première définition du travail : efforts fournis à la communauté pour assurer une meilleure survie ou un meilleur confort de l’ensemble de ses membres.
Mais alors, si le travail est un devoir envers la communauté, les sans-emplois sont-ils donc des profiteurs démunis de cette vertu, et qui méritent d’être privés de toutes ressources ? C’est une logique que beaucoup ont déjà épousée… mais il est évident que la réponse est ailleurs. Dans la perspective que nous avons développée, il y aurait nécessairement du travail pour tous. Et chacun travaillerait de manière équivalente, puisqu’il s’agit d’échanger une force de travail contre une autre. Il ne saurait y avoir moins d’emplois que de demandeurs d’emplois, comme c’est le cas aujourd’hui : depuis une décennie, 2 à 3 millions de demandeurs d’emplois (chiffres de l’INSEE de 2008 à 2018) (3), contre 600 à 700 000 offres disponibles à ce jour sur pôle-emploi.
Où est la faille de notre définition ? Elle a déraillé quand le travailleur·se a commencé à être dépossédé de sa force de travail. Le capitalisme ne l’a peut-être pas inventée, mais certainement il a donné à cette dépossession une dimension inédite. Elle a été permise par un élément-clef : la conversion de la force travail en argent.
Cela a été le rôle de l’argent de transformer le travail en unités de valeur permettant d’assurer – en théorie – des échanges équitables de forces de travail. C’est pourquoi il est gravé encore aujourd’hui dans les mentalités que qui est riche a dû le mériter, c’est-à-dire réaliser des tâches d’une valeur très importante. Le travail est donc avant tout rémunéré, dans une société où chacun ne vit pas en autarcie et où nous dépendons tous les uns des autres. Mais là où est le premier hic, c’est que toutes les activités humaines – y compris et peut-être surtout les plus utiles à la communauté – ne sont pas rémunérées. C’est pourquoi il peut exister de nombreuses personnes sans emploi qui, toute la journée, peuvent réaliser diverses tâches y compris pour le bien commun, sans pour autant qu’on considère qu’elles travaillent. Le bénévolat n’est pas travail. Le volontariat n’est pas travail. Tout ce qui est réalisé gratuitement, peu importe les efforts que cela a nécessité, n’est pas travail. Lorsque les politiciens parlent de « valeur travail », ils ne parlent donc pas de don de soi, de dévouement au bien commun, ou en tout cas pas seulement : en premier lieu, ils parlent d’une activité rémunérée.
Dans cette perspective, le travail est la vente de sa force de travail. Le travailleur est supposé récupérer une somme d’argent équivalente à la valeur de ce qu’il a produit. Est-ce le cas ? Non, par la magie du capitalisme, et c’est là qu’est le second hic. En effet, dans le système capitaliste, pour qu’une entreprise survive elle doit réaliser du profit : ce profit, elle l’obtient en achetant la force de travail de ses salariés à une valeur moindre que ce qu’ils produisent. Les bénéfices ainsi conçus vont dans la poche des actionnaires, qui sont le plus souvent des personnes différentes des salarié·e·s. En effet, ce sont eux qui ont investi au départ. D’après Bernard Friot, sur les 2000 milliards du PIB annuel français, 700 milliards sont reversés de la sorte aux actionnaires. Mais les actionnaires récupèrent bien davantage que ce qu’ils ont investi, et ne réinvestissent le surplus qu’en partie. Ce ne sont donc pas des travailleurs échangeant leurs forces de travail, mais seulement des commerçants de la force de travail des autres qui s’enrichissent uniquement en investissant : un cercle vertueux – pour eux. Cette logique n’est évidemment faite, ni pour rapporter au travailleur le fruit de son travail, ni pour faire du travail une force bénéfique pour le bien commun : le travail n’est voué qu’à enrichir les investisseurs. De plus, elle est directement génératrice de chômage : en effet, ce n’est pas la nécessité du travail qui manque – il y a, en fait, assez de tâches pour tous, puisque les tâches nécessaires sont proportionnelles aux besoins de la population – mais l’argent qui manque pour rémunérer l’exécution de ces tâches, celui que le travail a généré mais n’a pas récupéré. Enfin, troisième hic : de nos jours, un nombre croissant d’emplois ne servent plus ni au bien commun, ni même à la création de richesses, comme le montre David Graeber dans son livre Bullshit jobs [4]. Pourtant, ils sont rémunérés, ce qui pousse les demandeurs d’emploi à les accepter ; avec des conséquences psychologiques pouvant s’avérer dramatiques, comme les décrivent de manière criante les témoignages de ce livre. Une réalité à laquelle nous faisons face encore plus fortement depuis qu’une bonne proportion de ces employés – victimes ou parasites – se retrouve au chômage technique sans que la survie de la société n’en soit impactée d’un iota. Or, l’impact de ces « bullshits jobs » sur la santé psychique des personnes les occupant – burn out, dépression… – montrent bien que « le travail » dans ce cas nous est insupportable. En effet, s’il répond au besoin de sécurité, il ne peut s’accorder aux deux autres notions chères aux Français·es relevées par Dominique Méda : le travail comme devoir envers la communauté et le travail comme épanouissement.
Si la force de travail n’est plus rémunérée à hauteur de ce qu’elle produit, si le travail peut être déconnecté de la notion d’utilité aussi bien que de la notion d’enrichissement économique, que reste-t-il de la définition du mot « travail » ? Rien de plus finalement qu’activité contre argent, sans même la notion d’équivalence entre les deux. Le travail dans ces conditions peut être source de grandes frustrations, allant jusqu’à des dégâts psychologiques énormes.

Le chantage au travail
Le travail n’est jamais, pour le salarié, rémunéré à la hauteur de ce qu’il produit, le travail n’est pas nécessairement pour le bien commun : que reste-t-il qui motive à travailler ? Nous l’avons vu au début, lorsque nous avons listé ce qui rend le travail important aux yeux des français·es : le travail permet d’assurer une sécurité, la garantie à plus ou moins long terme de pouvoir subvenir à ses besoins de base. Quand bien même le salaire n’est pas équivalent à la tâche, nous en avons besoin ; et au-delà du salaire, nous avons besoin du statut que le travail nous donne. Le travail nous fournit une justification au sein de la société. C’est un héritage de la mentalité selon laquelle on devait fournir une tâche à la communauté en échange de l’assurance de sa survie au sein de cette même communauté. Mais cette justification – si elle a jamais existé – a disparu, nous l’avons vu, puisqu’il n’y a plus d’échange de force de travail équivalente et que les tâches ne sont plus nécessairement vouées au bien commun ; seul le principe social est resté. Mais il est encore très puissant, puisqu’il met les sans-emplois au ban de la communauté.
La société repose sur un équilibre fragile et il serait trop dangereux de la mettre face à ses failles et à ses aberrations. Or, les sans-emplois sont aujourd’hui si nombreux qu’il devient absurde de marginaliser une si grande partie de la population. De plus, le chômage touche surtout les jeunes [3], et une société ne peut perdurer en rejetant de la sorte une grande partie de sa jeunesse. Du fait de cette propagation du chômage, petit à petit le travail est presque devenu une sorte de privilège réservé à une élite. Autrefois, pour survivre il fallait travailler ; aujourd’hui, il faut mériter de travailler. Le travail n’est plus un moyen mais un objectif en soi. Or, comme le rappelle André Comte-Sponville [5] : personne ne travaille pour le travail, le but de l’homme est la recherche du bonheur. La société impose à chacun des contraintes contraires à son objectif intrinsèque. Cela ne tient que par le chantage suivant : si tu veux survivre et avoir ta place dans la société, il faut travailler. Le vocabulaire lié au travail et son évolution sont très révélateurs de ce point : autrefois « travailleurs », nous sommes aujourd’hui « employés » : nous passons d’un terme actif à un terme passif. Nous sommes « demandeurs d’emploi », et non offreurs de force de travail : en revanche, une proposition d’emploi est « une offre ». Bref, ceux qui nous font travailler nous concèdent par là une grande grâce, et nous sommes les passifs qui dépendons d’eux, au lieu du contraire. En réalité, les employeurs vivent grâce à leurs employés, mais le choix même des mots sous-entend l’opposé. Le pouvoir est basculé des travailleurs aux « faisant travailler », permettant la domination des seconds sur les premiers. En outre, le chômage galopant inscrit dans l’esprit des actifs qu’il n’y en a pas pour tout le monde, qu’il faut se battre pour en avoir un et le garder. On se crée ainsi des employés beaucoup plus dociles : la terreur du chômage oblige à supporter des conditions bien plus pénibles que si le travail allait de soi. Or cette contrainte devenue trop lourde augmente encore la révolte des chômeurs : ceux qui n’ont pas même droit à ce joug, de fait ne le supportent pas et sont donc en position de se rebeller et de réclamer mieux. La pression aujourd’hui sur le fait de posséder un travail est si forte que ceux qui en ont peuvent être tentés de rester dans le « droit chemin », mais ceux qui n’en ont pas restent libres de protester contre ces conditions.
À la colère des sans-emplois s’ajoute la colère même de certains travailleurs. Le travail est indispensable à la survie, il en est une condition nécessaire, mais pas toujours – de moins en moins – une condition suffisante. D’après l’INSEE, 8.2% des personnes actives de plus de 18 ans en emploi vivent en dessous du seuil de pauvreté [6]. Si le travail ne permet même plus d’assurer la subsistance des travailleurs, que lui reste-t-il ?
Le travail, dans une large proportion, a donc perdu les notions qui lui donnaient tout son sens : il ne permet pas de récupérer la valeur produite par son travail, et il n’est plus destiné – ou plus seulement, ou bien peu – à assurer une meilleure survie de l’homme ou un plus grand bien-être. Dans certains cas, il ne permet pas même d’assurer la subsistance du travailleur.
La « valeur »
C’est cette vacuité de sens que la notion de « valeur » vient combler. L’idée sous-jacente est que l’homme ne devrait finalement pas travailler que par intérêt mais parce que travailler est son devoir moral. Cela permet de justifier également un autre aspect du travail : sa pénibilité. En effet, dans la mentalité fortement imprégnée des idées du christianisme qui est la plus répandue en France, n’a de valeur que ce qui a généré au départ une souffrance qui a été surmontée : sans souffrance, pas de mérite. L’étymologie la plus populaire pour le mot « travail » est que le mot viendrait d’un instrument de torture appelé « tripalium ». Cette étymologie est toutefois contestée [7]. Véridique ou non, il est intéressant de noter la popularité de cette étymologie : en effet, elle révèle à quel point, dans la mentalité française, le travail est associé à la notion de souffrance subie. Le travail est supposé être pénible et générateur de souffrance, et c’est justement pour cela qu’il est valorisé. Cela fait encore une fois le jeu des capitalistes qui ont tout intérêt à ancrer cette idée dans la tête des travailleurs, pour ne pas avoir à améliorer leurs conditions de travail, ce qui serait moins rentable. Ainsi la pénibilité du travail devient une fatalité et non plus un vice du système. Comme le dit Bernard Friot [8] : « La classe capitaliste est en train de mettre le travail dans un sale état, et a tout intérêt à ce que nous considérions que, par nature, le travail est pénible. » De plus, c’est cette pénibilité même qui en fait le mérite et élève le travailleur – c’est presque dire qu’elle est à rechercher.
Le travail est donc censé être une valeur morale, un devoir mais en même temps n’est pas considéré comme tel s’il ne fait pas l’objet d’une rémunération. Ces deux notions sont-elles compatibles ? Non, comme l’a montré André Comte-Sponville [5]. Si le devoir était une valeur morale, comme une vertu, on ne saurait cesser de travailler : or, nous avons des jours chômés et des vacances, sans pour autant que notre intégrité morale soit remise en cause. De la même manière, si le travail était un devoir, il ne saurait être rémunéré : nous ne sommes pas payés à voter.
« Le travail n’est pas une valeur morale, c’est pourquoi il a une valeur marchande. Il n’est pas un devoir, c’est pourquoi il a un prix. » [5]
Les politiques préfèrent parler de valeur plutôt que de rémunération précisément parce que ces deux notions s’opposent telles le bien et le mal. L’argent, dans notre société, constitue un tabou historique. On ne parle pas d’argent, on ne demande pas son salaire ou le montant de son compte en banque à quelqu’un. Il y a quelque chose d’intrinsèquement vil à la notion d’argent, corrélée dès le Moyen Âge à la cupidité des marchands qui s’opposait à la noblesse de la vertu. De la même façon, de nos jours, la notion de « valeur » jette un voile pudique sur ce que le travail aurait, de par son étroite relation avec la notion d’argent, de vil, et vient au contraire donner au travail une chape noble et morale. Cela permet de rendre le travail à nouveau désirable, malgré ou grâce à la pénibilité du travail, comme nous l’avons vu précédemment. Cela permet surtout de détourner l’attention du problème de fond que rencontre le travail aujourd’hui, qui est corrélé avec cette déconnexion entre donné et perçu, entre l’argent que l’on reçoit et la richesse que l’on crée.

Conclusion
Le travail n’est pas une valeur, le travail n’est pas un devoir, le travail ne devrait pas être un privilège.
Le problème du travail aujourd’hui n’est pas la perte d’une valeur, mais la perte de sens. Il trahit aujourd’hui les attentes implicites qui reposent sur lui. Pour retrouver le sens du travail, il faut nous recentrer sur ce qu’il est originellement : un moyen, non une fin. Un moyen d’assurer notre subsistance, d’apporter au bien-être commun, de s’épanouir et d’être heureux. Comment est-il possible que tant de personnes soient sans-emploi, et qu’en même temps les travailleurs travaillent tant d’heures par semaine, parfois jusqu’au surmenage ? Si nous nous recentrons sur les tâches vraiment nécessaires, et si nous les redistribuons entre tous les actifs, cette situation ne saurait perdurer. Si nos objectifs peuvent être atteints en diminuant la charge de travail – parlons alors de labeur – pour chaque personne, tant mieux ! La mort même du « travail », tel qu’il existe aujourd’hui – à travers des initiatives telles que celle de « salaire universel » de Bernard Friot – n’est pas ce que l’on doit craindre. Le véritable objectif de l’humanité n’est pas le travail : c’est le bonheur.
Références
[1] MEDA, Dominique.Travail : la révolution nécessaire. s.l. : Editions de l’aube, 2010.
[2] Nicolas Sarkozy défend la «valeur travail». ROYER, Solène DE. 22 Février 2012, Le Figaro.
[3] INSEE. Activité, emploi et chômage en 2017 et en séries longues. 2018.
[4] Graeber, David. Bullshit jobs. s.l. : Les liens qui libèrent, 2018.
[5] Audenciatv. Conférence de André Comte-Sponville, Sens du Travail, Bonheur et Motivation. 14 Septembre 2011.
[6] INSEE. France, portrait social, Edition 2019. §4.2 : Pauvreté.
[7] L’arnaque de l’étymologie du mot travail. Flebas. 24 Mars 2016, Médiapart.
[8] FRIOT, Bernard.Emanciper le travail. s.l. : La Dispute, 2014. p. 47.