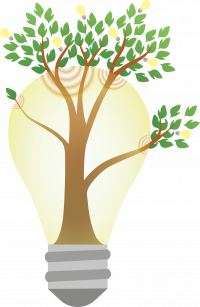Regards croisés de jeunes chercheurs
Entretien avec :
Baptiste Andrieu, doctorant à l’ISTerre[1] en thèse Cifre[2] financée par le Shift Project
Louis Delannoy, doctorant au sein de l’équipe STEEP[3] de l’INRIA[4] à Grenoble
Antonin Berthe, en stage de recherche à STEEP
Cet article s’insère dans la série « Changer le système de l’intérieur”, et a pour but de donner la parole à des ingénieur·es qui ont des postes qui leur permettent d’accomplir ce changement.
“J’exprime maintenant mon militantisme par mon boulot scientifique, qui avant était une passion. Avant je lisais des trucs sur les modèles globaux, l’anthropocène, et maintenant je suis payé pour le faire, mais aussi pour améliorer ces modèles et les communiquer”
Pousser la quête de sens jusque dans la recherche
NB : Bonjour Baptiste, Louis, Antonin. Est-ce que vous pouvez commencer par me parler de votre parcours ?
BA : J’ai fait un parcours classique, je suis allé en S parce que j’étais bon à l’école, puis je suis allé en prépa, et j’ai ensuite intégré une école en fonction de mon classement. Je n’avais pas trop travaillé, parce que je ne savais pas trop pourquoi je faisais ça. Après je suis arrivé à Grenoble INP, avec une spécialité physique, science des matériaux. J’ai lu plein de bouquins, notamment Bihouix, et je me suis dit que je voulais vraiment m’intéresser à la question des matières premières pour la transition énergétique. J’ai contacté mon seul prof qui nous avait un peu parlé de ces enjeux, qui m’a redirigé vers un chercheur, Olivier Vidal. Avec lui, j’ai pu faire mon stage de deuxième année sur la modélisation dynamique des besoins en matières premières pour la transition énergétique. L’année suivante, j’ai fait un stage au Shift Project sur la décarbonation et la réduction de l’empreinte matière de l’industrie. On a monté un projet de thèse Cifre pour continuer le projet de mon stage de deuxième année.
LD : Je n’ai pas fait d’études supérieures en France. Je suis parti, comme beaucoup de français, à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Génie Civil. J’ai fait un échange en Suède, où je me suis aperçu que la durabilité, c’était un peu plus intéressant que le béton. Quand je suis revenu en Suisse, j’ai changé de filière pour étudier la gestion de l’énergie et la durabilité. J’ai fait deux stages au Qatar et aux Émirats, où j’ai pu étudier les énergies renouvelables. Je suis aussi parti au Bangladesh, et c’est là-bas que j’ai eu une vraie prise de conscience sur l’effondrement, lors d’un summer camp à propos du social business[5]. Je me suis notamment intéressé à Pablo Servigne et autres. Je suis revenu à Lausanne en voulant en faire mon projet professionnel. J’étais en contact avec l’équipe STEEP depuis 2019, et on a monté un projet de thèse sur les risques systémiques globaux. On a eu la bourse, et j’ai pu commencer en janvier 2020.
AB : J’ai fait la filière sciences de l’ingénieur au lycée, car j’avais déjà en tête de devenir ingénieur. Au concours, j’ai passé du temps à choisir, et j’ai opté pour l’ENSEEIHT[6] parce que je voulais faire électronique et énergie électrique parce que c’est ce qui m’intéressait. Si en prépa j’ai passé énormément de temps à travailler, en école d’ingénieurs, j’ai choisi d’investir ce temps ailleurs. Je me suis énormément impliqué dans le groupe local d’Ingénieur·es Engagé·es de l’ENSEEIHT, mais aussi dans le pôle toulousain de Together for Earth, qui est un groupement d’associations étudiantes. J’ai fait l’ACademy d’Avenir climatique que j’anime cette année, je suis aussi animateur de la fresque du climat, fresque de la biodiversité, et fresque du numérique. En prépa, j’étais plus sensible aux questions politiques que climatiques. En école, je me suis beaucoup renseigné sur tous ces enjeux, et j’ai fait pas mal de chemin. Lorsque le moment des stages est arrivé, j’ai eu la chance d’avoir un ami qui a fait Grenoble INP qui m’a partagé l’offre de stage de Louis, et d’avoir été retenu.
La science comme outil de médiation
“À partir de nos travaux scientifiques, il y a un gros travail pour toucher les autres scientifiques et les décideurs, pour que ces travaux aient un impact.”
NB : Comment vos travaux permettent-ils de changer le système ?
LD : On a 2 axes de recherches à STEEP. Le premier c’est sur les risques systémiques globaux : comment fonctionnent les modèles intégrés globaux[7], quelle est leur robustesse, et leurs implications épistémologiques[8]. Le deuxième axe concerne les alternatives socio-techniques, à l’échelle locale et régionale, sur les flux de matière et d’énergie avec un apport conséquent de sciences humaines. Moi, je me place dans la catégorie des risques systémiques globaux. J’étudie comment les crises se transmettent dans l’écosystème mondial. Par exemple, si un bateau bouche le canal de Suez, comment ça se répercute dans l’approvisionnement en matières premières en France. Pour ce qui est de changer le monde, j’ai l’impression de le faire ici plus qu’ailleurs. Ça me permet de défricher un terrain inexploré, de prévenir des dangers structurels des interconnexions actuelles du “système” dans lequel on se trouve, mais aussi contribuer au design d’alternatives sociotechniques, et de nouvelles chaînes d’approvisionnement. On fait aussi beaucoup de médiation : on a une chaîne YouTube (Comprendre et Agir), sur laquelle on fait beaucoup de conférences sur les communs, les questions démocratiques, énergétiques, climatiques… On essaie de se placer en tant que médiateurs, vis-à-vis des autres chercheurs et du large public. Avec le monde scientifique, avec nos pairs, on lance la première conférence francophone sur les risques systémiques : Archipel 2022. On espère commencer à vraiment faire bouger les choses pour la communauté académique, en initiant la co-création d’une communauté de scientifiques qui s’intéresse aux questions de l’anthropocène, pour publier, se rencontrer… Le but de cette conférence est de faire avancer et faire se rencontrer la communauté scientifique et le public. Il y aura notamment un moment où des associations seront invitées à défendre des projets devant la communauté. Ensuite, nous souhaitons porter ça au niveau international.
AB : De mon côté, j’étudie la faisabilité ou non de la transition énergétique, les contraintes en énergie fossile, matériaux, et carbone. On se pose vraiment la question de savoir si la transition est possible ou pas. Est-ce que c’est faisable à l’échelle mondiale, vers où on va, et quelles en sont les conséquences ? Un gros travail concerne l’utilisation de ces résultats. On sait depuis les années 70 qu’il y a une grosse urgence écologique, pourtant on a continué à se développer et à polluer sur les mêmes trajectoires. A partir de ces travaux très scientifiques et rigoureux, il y aurait un gros travail avec le Shift pour toucher les scientifiques et les décideurs, pour que nos travaux aient un impact. Il y a un gros enjeu à transmettre tout ce qu’on fait, car cela fait une grosse différence si ça reste dans la communauté scientifique, ou si on diffuse ça plus largement.
BA : Je pense que le Shift a un rôle assez particulier dans le panorama des structures associatives françaises. Le parti pris à l’origine, c’est de dire « y’a assez de militants pour le climat en dehors du système, nous on va aller en plein dedans, on va se jeter dans la gueule du loup et travailler avec les “grands méchants” ». On est financés par des entreprises qui ont intérêt au changement, et on essaie de faire du lobbying pour la transition énergétique. Ça nous place comme un acteur du système. Ça permet d’avoir la confiance de ces entreprises, ça nous donne un gage de sérieux, et on s’efforce par ailleurs d’avoir une rigueur scientifique qui permet que nos messages soient entendus par tout le monde. C’est une grande force pour faire évoluer les choses. Ce qu’on fait dans la thèse, c’est un modèle qui s’appelle dyMEMDS, qui permet de comparer des scénarios de transition énergétique entre eux, et de voir s’ils sont cohérents. Il permet de reproduire toutes les infrastructures (panneaux solaires, pipelines, raffineries, bâtiments, routes…) en faisant évoluer les dynamiques dans différentes régions du monde. On peut voir comment évoluent les besoins en matières premières selon la période. On a construit un outil qui a demandé beaucoup de temps, que ceux qui élaborent des scénarios ne peuvent pas construire faute de temps et de moyens. Une fois qu’il sera publié, il pourra être utilisé par pas mal de monde, pour évaluer ou construire des scénarios. On crée des outils qui permettent de mieux informer les scénarios de transition.
NB : Les temps de la recherche ne vous paraissent-ils pas trop longs, au regard de l’urgence climatique ?
LD : c’est une bonne question, tout dépend de ce que tu vises. Pour essayer de sauver les meubles, la recherche peut être une première étape. Mais si tu veux changer le monde en 10-15 ans, je ne suis pas très optimiste. Est-ce que c’est la recherche qui, au niveau personnel et sociétal, aboutira au plus d’impact ? Je suis dans l’incapacité de répondre à cette question. Personnellement, c’est le moyen qui me convient le mieux.
AB: Je mettrais un mot : frustrant. Les travaux de recherche, c’est en trois ans, on a envie de faire bouger les choses très rapidement mais c’est simplement pas comme ça que ça marche
Des murs politiques et académiques
“On a un peu de la peine à pousser les murs de cette communauté scientifique établie, qui peut devenir un frein à la dissémination des savoirs.”
NB: Quels sont les leviers et les freins de votre démarche ?
LD : Je dirais qu’il y a trois piliers : premièrement la rigueur, c’est-à-dire, la robustesse et la justesse de nos travaux; ensuite, la dissémination et vulgarisation aux politiques ; et le troisième c’est la volonté politique. On y revient toujours, mais c’est le dernier obstacle. On peut espérer assurer les deux premiers, mais pour le dernier, y’a un moment où on a plus les cartes en main, c’est plus le rôle du scientifique de décider. On peut seulement pousser avec des actions militantes pour essayer d’influencer ce dernier levier.
BA : Par rapport aux freins, la question des financements est importante. Pour les thèses c’est déjà difficile, parce que pour avoir des financements publics des universités il faut avoir un super dossier. Et la thèse Cifre, c’est via les entreprises, qui ne s’intéressent pas forcément à ces questions-là. J’ai de la chance d’être financé par le Shift, car mon projet est vraiment axé sur la transition. On est peu nombreux à avoir des financements comme ça. Pour les perspectives professionnelles dans la recherche, c’est un parcours du combattant pour imaginer avoir à 35 ans un poste. Les financements sont basés sur des projets, sur lesquels on a peu de marge de manœuvre.
AB : ce que je rajouterais, sur la question du financement, c’est que comme il n’y a pas de gouvernance mondiale, personne n’a d’intérêt financier à se poser la question de réfléchir de manière systémique. Et les thèses Cifre n’ont pas d’intérêt non plus à financer ça, elles s’intéressent à ce qui peut rapporter directement aux entreprises.
LD : Le monde de la recherche est vraiment très conservateur. Je pensais qu’il y aurait plus de place pour l’innovation, dans le bon sens du terme, pour des sujets innovants, mais en fait absolument pas. Pour les bourses de thèse, pour publier des articles, pour organiser une conférence, il y a des freins. Ce que tu cherches à faire ou publier reste marginal, et peut faire peur quand tu dis les choses avec rigueur. Par exemple, j’ai eu un peu de mal à faire publier mon article sur le pic pétrolier, et c’est l’éditeur qui a le droit de vie ou de mort sur mon papier. On a un peu de la peine à pousser les murs de cette communauté scientifique établie, qui peut devenir un frein à la dissémination des savoirs. C’est pour ça d’ailleurs qu’on a souhaité organiser la conférence. Après, ces dernières années, il y a eu énormément de vulgarisateurs qui ont émergé. C’est un soulagement pour les scientifiques, d’être en contact avec des personnes comme ça. Elles peuvent diffuser des articles vulgarisés au grand public. Avant c’était assuré par les maisons d’édition scientifiques, maintenant, elles se contentent juste de prendre l’argent et d’envoyer les mails aux relecteurs. C’est une bonne chose d’avoir des personnes qui diffusent ces messages.
Militer par sa recherche
“Sur le temps où je peux travailler, je trouve que je suis plus efficace pour la thèse que pour les associations”
NB : Avez-vous plutôt l’impression d’agir dans votre rôle de membre de la communauté scientifique, ou agissez-vous en dehors de ce rôle ?
AB : Je continue d’être pas mal actif, et de garder le contact avec les assos qui existent, qui font des choses pour pouvoir leur amener ces sujets-là. Je le fais surtout au travers de discussions, où j’essaie d’amener des connaissances. Je pense continuer en thèse et garder cette optique là, c’est-à-dire continuer à m’investir en dehors de la thèse.
BA : Depuis que je suis en thèse, j’ai un peu lâché les associations. On a beaucoup de travail, un nombre incalculable de choses à étudier, et sur mon temps où je peux travailler, je trouve que je suis plus efficace pour la thèse que pour les associations. Vu que c’est une collaboration avec le Shift, y’a une partie de mes missions qui se font directement pour le Shift, pour la vulgarisation. Ça me permet de valoriser ça dans les publications du Shift, lues par les décideurs, mais aussi de plus en plus par le grand public, ce qui est assez motivant, sans avoir à faire l’effort de communication par moi-même. Mais c’est une configuration assez particulière. En général, en thèse, tu publies 1, 2 ou 3 articles, lus par 10 personnes dans le monde.
Une fuite ingénieure qui doit rester marginale
NB : Est-ce que cette voie serait généralisable pour les ingénieurs qui veulent changer le système de l’intérieur ?
LD : Comme je disais, pour avoir des bourses de thèses, il faut avoir un bon dossier, et il faut surtout être prêt à se lancer dans cette aventure. Ça peut être épuisant psychologiquement sur plusieurs aspects, sur la quantité de travail, et tout le panel de tâches qui s’offrent à toi. En particulier si ton sujet est anxiogène, ça peut être dur, c’est déjà arrivé que des doctorants fassent des poussées d’éco-anxiété à cause de leur sujet. Mais la recherche, c’est une voie qui gagnerait à être plus soutenue. Elle peut apporter une vraie satisfaction aux personnes qui s’interrogent sur l’impact de leur vie professionnelle. Du côté militant, je ne suis plus militant dans des associations depuis que j’ai changé de ville. J’exprime maintenant mon militantisme par mon boulot scientifique, qui avant était une passion. Avant, je lisais des études sur les modèles globaux, l’anthropocène, et maintenant je suis payé pour le faire, mais aussi pour les améliorer et communiquer sur ces modèles. En France, ces débouchés restent assez fermés. A l’EPFL, c’est beaucoup plus courant, il y 25% des étudiants en master qui font une thèse.
BA : En fait, ça dépend vraiment des écoles. Je suis dans une école où il y avait énormément de doctorants. Je dirais aussi que ce n’est pas généralisable, parce qu’il faut des ingénieurs qui font un travail d’ingénieur et pas de recherche. Le problème c’est aussi quoi faire après la thèse. Des post-doctorats il y en a quelques-uns, mais des postes de chercheur, il y en a très peu. Quand on est ingénieur, on peut se reconvertir, mais quand on vient de la fac et qu’on a que ça comme débouché, c’est plus dur.
AB : Le problème actuellement est qu’il y a peu de débouchés pertinents, il y a un décalage entre les compétences et les métiers. Quel que soit le contexte on aura besoin d’électronique, de réseaux électrique, on aura besoin de ces compétences techniques, mais actuellement les métiers qui mobilisent ces compétences sont des voies ne les utilisent pas forcément à bon escient. Sur la thématique de changer le système de l’intérieur, il faudrait arriver à changer les métiers tels qu’ils sont aujourd’hui, pour mettre les compétences utiles dans un modèle de société souhaitable.
BA : Je pense qu’on est très vite amené à ne pas avoir envie de faire de travail technique, quand on se met à critiquer le progrès, etc. Mais je pense aussi qu’il faut des ingénieurs pour accomplir ce travail technique, et que le progrès technologique a quand même un rôle important à jouer dans les années à venir. Ce qu’on reproche, c’est le fait de dire que la technologie va nous sauver, et que ça devient un prétexte pour ne rien faire, et oublier la sobriété. C’est sûr qu’il faudra faire beaucoup de sobriété, mais si on peut faire des progrès en même temps, sur les énergies renouvelables ou les Low Tech par exemple, ce sera toujours un gain en qualité de vie.
****
Propos recueillis et retranscrits par Nicolas B, pour le projet Livre d’Ingénieur·es Engagé·es
Merci à Baptiste, Louis et Antonin pour leurs réponses, et merci aux relecteur·ices attentif·ves du projet Livre.
Notes
[1] Institut des Sciences de la Terre.
[2] Une thèse Cifre est une thèse en partenariat avec une entreprise intéressée par les résultats qui apporte des financements, et un laboratoire qui encadre la partie scientifique.
[3] Soutenabilité, Territoires, Environnement, Économie et Politique.
[4] Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique.
[5] Démarche qui vise à encourager l’entrepreneuriat social, c’est à dire ayant des impacts positifs sur la société.
[6] Ecole de l’énergie, du numérique, de l’environnement et des transports du futur à Toulouse.
[7] Modèles qui visent à simuler des interactions systémiques à grande échelle (entre par exemple, climat, ressources, économie, …) afin d’anticiper le futur de nos sociétés.
[8] C’est à dire, la manière dont les choix méthodologiques faits pour ces modèles influence les connaissances qu’on peut en tirer.
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.