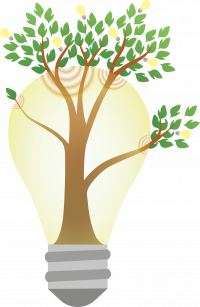L’économie contre la biosphère : déconstruction du greenwashing dans les métiers d’ingénieur·e
Cet article fait partie d’une série traitant sur les leviers d’action de l’ingénieur·e au sein du système, dont les réflexions ont été initiées lors du café-débat ayant eu lieu sur le Discord Ingénieurs Engagés le 09/04/2020.
Article 2 : Ingénieur·e engagé·e en entreprise – approche stratégique d’une posture dissonante
Article 3 : Ingénieur·e engagé·e en entreprise : quelle marge de manœuvre pour agir ?
Article 4 : Sortir de la voie royale
Auteur : Nicolas B
Relecture : Groupe Montrer les Possibles
Introduction
« Plutôt penser le changement que de changer le pansement » [1]
Ce slogan est devenu le mot d’ordre d’une partie de la population prête à s’engager, et notamment dans son activité professionnelle, pour “changer le système”, face aux impasses écologiques et sociales dans lequel il se trouve. Un changement, certes, mais lequel ? Il est nécessaire de définir clairement les ambitions que l’on donne à cette transition, surtout si l’on souhaite justement s’assurer que l’on dépasse la logique du “pansement”. Ceci est particulièrement vrai dans le monde de l’entreprise.
En effet, on constate aujourd’hui d’ores et déjà des mutations plus ou moins profondes liées au travail de réflexion sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et les objectifs de Développement Durable, parfois intégrés explicitement dans le secteur privé. Dans la forme en tout cas, l’entreprise sait se donner une conscience, et se mettre “au vert”. Aujourd’hui, la difficulté n’est plus de trouver une entreprise qui affiche officiellement son engagement pour l’écologie, mais de trouver celles pour lesquelles cet engagement s’accompagne d’actions effectivement vertueuses. Certain·es se demanderont même si le simple fait de faire partie du système capitaliste ne s’oppose pas précisément à la transition écologique.
Pour parler de cela, nous devons faire un détour pour nous intéresser de près à ce qu’est le greenwashing. Cet argument épouvantail agité dès les premières heures de la lutte écologique comme un avertissement prend un nouveau sens lorsque la société entière se prétend écologique, sans pour autant que rien ne change. Comment décrire ce qu’est aujourd’hui le greenwashing, et comment celui-ci se traduit dans les emplois d’ingénieur·es ? Comment trouver sa voie dans un monde qui n’a de vert qu’une maigre couche de peinture sur des rouages toujours plus destructeurs ?
L’écoblanchiment
Le mot “greenwashing” est issu de la fusion de deux mots anglais : “green” et “brainwashing”[2][3]. Le premier renvoie au vert, c’est-à-dire le symbole de l’écologie, tandis que le second signifie littéralement “lavage de cerveau”. Le terme apparu dès les années 90 est passé dans le vocabulaire courant, et a même été traduit en français par “écoblanchiment”. Il est très fréquemment adressé aux entreprises (mais aussi aux politiques publiques) pour dénoncer l’incohérence entre leurs messages environnementaux et leurs actions destructrices. Cette logique est exacerbée dans l’image publicitaire qu’elles véhiculent sur elles-mêmes ou sur leurs produits toujours plus verts[4]. On trouve également la notion symétrique de socialwashing pour dénoncer les mensonges concernant le respect des droits humains.
Une notion floue…
Si certains discours relèvent sans équivoque de la fraude (nous pouvons citer par exemple le fameux dieselgate[5] de Volkswagen), d’autres sont plus ambigus. Que penser par exemple des publicités pour des voitures thermiques écologiques ? Le système de transport basé sur le véhicule individuel est, en soi, une aberration responsable à lui seul d’environ 20%[6] des émissions de gaz à effet de serre en France. Réduire la consommation de carburant des véhicules peut, certes, conduire à une réduction relative des émissions, mais tant que la persistance de ce modèle n’est pas remise en question, aucun progrès ne sera fait (et nous ne parlons même pas de l’effet rebond, qui concerne également les véhicules électriques [7]). Que penser également de produits “bio” qui contiennent malgré tout de nombreux additifs ou composés nocifs pour la santé [8]? Ou de l’abus de la mention “naturel” sur certains produits [9]?
Nous voyons donc que les lignes qui dessinent ce qui relève ou non du greenwashing sont floues… et surtout dépendent de chacun·e. Malgrés cela, certains acteurs ont tenté d’identifier les pratiques les plus courantes dans le registre de la consommation. Nous pouvons par exemple citer le think tank britannique Futerra (2008)[10] et l’Agence française de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (Ademe) [11]. Ces guides d’autodéfense à l’usage des consommateur·ices ne nous aident cependant pas forcément à y voir plus clair lorsque l’on souhaite passer de l’autre côté de la barrière, en tant que producteur·ices. Pour examiner cela, nous proposons de redéfinir ce qu’est le greenwashing, de manière générale et actualisée.
Durabilité faible / Durabilité forte
Lorsque l’on dépasse l’échelle du produit ou service, nous nous posons la question de comment distinguer les “bonnes” politiques environnementales, qu’elles soient publiques ou privées, des politiques de greenwashing. L’ambiguïté que nous avons relevée dans la définition de greenwashing relève probablement des différentes interprétations de l’écologie qui existent. Si certain·es se satisfont des discours sur la croissance verte et ne seront pas choqué·es par notre exemple de voiture écologique, d’autres dénonceront tout message écologique des entreprises tant que celles-ci restent la source de dégradations environnementales. Un concept phare pour établir ces définitions de l’écologie est de distinguer la durabilité faible de la durabilité forte.
Le développement durable et ses critiques
Critiqué dès ses premières années, le concept de développement durable (DD) exposé dans le rapport Brundtland [12] a très vite révélé des limites. Ne remettant pas en cause la nécessité de croissance malgré les critiques émergentes [13][14], il place au contraire l’impératif économique sur le même plan que l’impératif environnemental et social. Le discours économique dominant est en effet que l’économie se régule elle-même (la fameuse “main invisible du marché”), et notamment qu’elle est capable de corriger toute seule les dégâts qu’elle engendre. De nombreux concepts et outils économiques, comme par exemple les marchés du “droit à polluer”, ou l’internalisation des “externalités négatives”[15] ont alors émergé en tentant d’inclure, au sein du système économique, des mécanismes permettant d’améliorer cette régulation environnementale. Mais ces mécanismes admettent implicitement une hypothèse : celle que le “capital naturel” peut être remplacé par du “capital humain”. Autrement dit, il n’est rien d’utile à l’Homme dans la biosphère qui ne puisse être remplacé par le fruit de l’ingéniosité humaine. La pollution peut être réparée, les services écosystémiques remplacés par du travail[16], le changement climatique peut être corrigé (ou alors, nous pourrons nous adapter à un nouveau climat). C’est ce qui a été appelé durabilité faible[17], en opposition à une durabilité forte selon laquelle il est nécessaire de préserver le capital naturel plutôt que de chercher à le remplacer. La durabilité forte intègre qu’il existe des limites fondamentales à ne pas dépasser (nous pouvons par exemple nous référer aux limites planétaires[18]), ce qui entre mathématiquement en opposition avec l’idée d’une croissance infinie. Ces derniers temps, le concept d’économie circulaire[19] a remplacé celui de développement durable, mais ne semble pas pour autant remettre fondamentalement en cause la priorité sur une durabilité faible[20].
Les indicateurs d’une durabilité faible
Dès lors que la durabilité forte devient l’objectif écologique, peu de discours actuels semblent réellement convaincants. Ils sont d’ailleurs aussi bien partagés par la sphère privée que la sphère publique, qui n’incite en rien les acteurs économiques à remettre en question la destruction du capital naturel. Une première étape pour permettre aux entreprises d’agir utilement pour la durabilité forte serait de revoir les métriques d’évaluation environnementale, et de redéfinir les indicateurs et objectifs, pour que la préservation de la biosphère puisse être jugée prioritaire à celle de l’économie. Rappelons qu’aujourd’hui, le seul et unique indicateur macroéconomique est le PIB (Produit Intérieur Brut), qui n’est absolument pas représentatif de la qualité de vie et encore moins de la durabilité des sociétés[21]. Ce changement dépend de la capacité des acteurs institutionnels à faire évoluer les politiques environnementales, mais nous nous intéresserons dans un article ultérieur à la manière de faire évoluer ces métriques.
Les impératifs économiques des entreprises
Un des principaux freins à la recherche d’une durabilité forte est le fonctionnement actuel du système économique. Nous décortiquons dans cette partie les principaux problèmes du modèle économique dominant.
Libéralisme et financiarisation
Le libéralisme économique consiste à éliminer le plus de barrières possibles au commerce, de manière à ce que l’économie mondiale ressemble au mieux à une situation de concurrence parfaite qui serait (selon cette théorie) bénéfique pour tout le monde. Cette doctrine économique, se fondant sur des travaux d’une rigueur douteuse et sur des préceptes démentis[22] a malgré tout guidé toutes les institutions mondiales depuis la fin du XXe siècle, dans une économie qui s’est financiarisée, c’est-à-dire que le secteur financier est devenu prépondérant, notamment au travers du système actionnarial. Les actions des entreprises, au sens premier comme au sens financier, ne leur appartiennent en réalité que très peu. Ce sont en effet aujourd’hui les actionnaires qui ont la mainmise sur les politiques des entreprises, au travers de la pression constante qu’ils imposent afin que celles-ci génèrent toujours plus de profits. Si les entreprises gagnent de plus en plus de pouvoir face aux États, elles en perdent face à leurs actionnaires, devant lesquels elles doivent justifier de résultats croissants, permettant la croissance des profits et donc des dividendes reversés.
Quel actionnaire se satisferait dans ce système de dividendes en indicateurs de biosphère ? On peut voir là une opposition fondamentale entre l’actionnariat propre aux entreprises privées (et ses besoins) et la biosphère : alors que les résultats des entreprises sont évalués chaque trimestre, l’approche de la durabilité forte consiste au contraire à prioriser à long terme. Les marchés boursiers (dont le CAC40 est, par exemple, un indicateur[23]) ont surtout pour objectif de protéger les actionnaires et investisseurs. Peu importe le niveau de problématiques sociales et environnementales que l’on souhaite y injecter[24], le seul indice de fiabilité des données financières publiées par les entreprises reste comptable et économique. N’importe quel directeur·ice financier n’a qu’une peur, c’est de se faire retoquer sur son compte de résultat ou son bilan, mais le prix à payer en dégradations environnementales ne l’empêchera pas de dormir la nuit.
Changer pour que rien ne change
Ces impératifs de croissance se traduisent par un système productiviste, qui a pour vocation de produire toujours davantage (peu importe si cette production est utile ou non du moment qu’elle se vend), et dont les conséquences néfastes sur l’environnement augmentent exponentiellement avec leur activité. Car malgré les beaux discours sur la croissance “verte”, qui expliquent qu’à terme une augmentation de la richesse entraînera une diminution des impacts écologiques[25], aucun découplage n’a encore été observé à ce jour [26][27]. Autrement dit : les marchés appellent à une croissance, qui est couplée à une production, qui impliquent une pollution. CQFD.
Les entreprises, dans ce contexte mondial enjolivé par des objectifs durabilité faible (développement durable), semblent donc condamnées à ne pouvoir poursuivre que des politiques environnementales qui relèvent du greenwashing. Être vertueuses en apparence, sans rien changer aux problèmes engendrés (voire, en les aggravant). Quelle crédibilité aurait un groupe, ouvertement néfaste pour l’environnement (le secteur pétrolier par exemple, ou alors l’aviation), s’il affichait comme objectif de cesser purement et simplement son activité (ce qui, au regard des nécessités environnementales, serait le meilleur choix) ? Mais cette contradiction n’empêche pas les entreprises de faire des annonces grandiloquentes concernant leurs actions en faveur de l’environnement.
S’acheter une conscience
Il existe dans la société actuelle de puissantes forces qui incitent les entreprises, du moins en apparence, à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Loin de les voir uniquement comme des contraintes, les entreprises peuvent en faire de réelles stratégies de marketing ou de développement. C’est d’ailleurs précisément l’ambition que traduit la notion de développement durable : trouver de nouvelles opportunités de faire des affaires grâce à l’écologisation de la société.
Les règles
La plupart des principaux pays pollueurs (en premier lieu, les puissances occidentales) sont dotés d’institutions destinées à réguler les externalités négatives des entreprises : normes de qualité, de sécurité, taxes, etc. Comme nous l’avons déjà abordé, ces institutions poursuivent aujourd’hui une durabilité faible, ne remettant pas en cause le besoin de croissance des entreprises. Les normes de plus en plus contraignantes forcent simplement ces dernières à respecter des cahiers des charges de plus en plus drastiques concernant leurs impacts environnementaux, bien que ces contraintes localisées amènent plus souvent un déplacement des problèmes qu’une résolution. Dans un climat libéral, la légitimité des États à légiférer sur la question environnementale est d’ailleurs souvent contestée.
Les stratégies RSE
Néanmoins, cette pression grandissante des institutions politiques ainsi que de la société civile amène plus en plus d’acteurs privés à reconnaître leur part de responsabilité dans les enjeux de société. La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est un outil qui permet aux entreprises d’afficher leur attitude volontariste concernant ces questions. Nombreuses sont les entreprises qui, par réelle prise de conscience ou par mimétisme (voire par nécessité compétitive) se dotent d’une telle charte. Mais ces objectifs RSE doivent bien entendu se conformer aux impératifs des marchés abordés ci-dessus. Comme une couche de vernis, ils ne pourront pas remettre profondément en question l’utilité et la pertinence des activité des entreprises au regard des enjeux globaux. Celles-ci se dotent d’indicateurs pour en faire une vitrine, omettant de mettre en perspective ces “progrès” avec le reste des nuisances générées par leurs activités, croissantes. Il ne faut bien entendu pas caricaturer les politiques RSE des entreprises, mais il ne faut pas non plus croire qu’il s’agit d’un dispositif réellement engageant, ni qu’il témoigne d’une transition profonde. Il s’agit d’une adaptation contextuelle aux normes d’acceptabilité d’une époque qui place l’environnement comme l’une des préoccupation de plus en plus centrale[28]. Un exemple d’incohérence flagrante : le groupe Disney se hisse au 3e rang de la réputation RSE pour l’année 2019[29], et affiche même ouvertement son engagement croissant pour l’environnement[30]. Pendant ce temps, la société acquièrent des îles aux Bahamas afin d’y construire de gigantesques complexes touristiques, une aberration consternante selon tout point de vue (destruction de la biodiversité, émissions de GES, destruction du paysage et des communautés…)[31]. Que penser également du groupe LEGO, positionné 2e dans le même classement, encensé par les médias pour sa décision de produire des briques biosourcées d’ici 2030[32] alors que le plastique (biosourcé ou non) reste une des principales causes de pollution des milieux naturels ? Nous pourrions allonger la liste, mais la réalité est que l’hypocrisie est systémique. En observant les actions globales des entreprises, et pas simplement celles qu’elles mettent en avant dans les communiqués de presse, les masques tombent. Difficile de ne pas voir la RSE comme un simple discours commercial, promotionnel, visant à acheter une conscience aux responsables de la pollution.
Le mécénat
Un autre moyen de s’acheter une image vertueuse en consacrant l’essentiel de son activité à des activités destructrices, peut-être encore moins subtile, est le mécénat. A ce titre, nous pouvons observer le culture de la philanthropie des GAFAM. Mais cette charité est loin d’être désintéressée. L’attachement de Google pour l’éducation n’aurait-il pas, par exemple, un lien avec son appétit mal dissimulé pour le marché de l’Education Nationale[34] ? Nous pouvons aussi faire référence à la fondation Bill Gates qui consacre une infime partie de ses ressources à des actions humanitaires, faisant fructifier le reste sur des marchés financiers[35].
L’ère de la responsabilité
Toutes deux volontaristes, les démarches de mécénat et de RSE traduisent cependant deux états d’esprit bien différents. L’intégration de plus en plus généralisée de politiques RSE pourrait bien signifier un transfert de responsabilité aux yeux de l’opinion publique. Afin de se montrer honnêtes, les multinationales ne doivent plus simplement montrer leur engagement pour une cause “quelconque”, mais pour les dommages doivent réparer qu’elles engendrent directement, dont elles sont responsables. Dans tous les cas, comme nous l’avons vu, ces politiques sont au mieux une manière de détourner l’attention, et au pire une hypocrisie servant un objectif autre, dissimulé, et beaucoup moins vertueux.
Définir le greenwashing
Dans un contexte d’urgence climatique, le corps scientifique souligne la nécessité d’un changement radical de nos modes de vie[36]. Accepter de revendiquer une durabilité faible revient également à accepter de sacrifier la biosphère pour la prospérité humaine, sans garantie que nous parvenions in fine à survivre à sa destruction.
Afin d’être en cohérence avec les enjeux actuels, nous proposons une définition radicale du greenwashing, dans le sens où elle souhaite s’attaquer à la racine des problèmes environnementaux : notre mode de production. Voici la définition que nous proposons :
Comportement promotionnel qui vise à user d’arguments écologiques (vérifiés ou non) sans chercher à s’intégrer dans une logique de durabilité forte. Cela implique notamment les discours qui ne remettent pas radicalement en cause notre mode de vie, de production, de consommation.
Cette définition permet de recouper de manière satisfaisante les définitions précédemment établies, car elle englobe tout argument commercial écologique destiné à encourager la consommation de masse irréfléchie. Elle permet également de s’attaquer aux entreprises qui se couvrent de vert par des actions (réelles) de façade, sans vraie remise en question de leurs activités.
Comme nous le détaillerons dans la suite de l’article, elle n’a pas vocation à être un jugement péjoratif implacable. Notre définition correspond plus à un signal de danger, constant, qu’à une ligne rouge absolue.
Ingénieur·e en greenwashing
Si les discours pro-écologie des entreprises visent avant tout à convaincre les consommateur·ices de continuer à acheter leurs produits et services (ou même d’en faire un argument de démarcation) on peut considérer qu’ils s’adressent également à la nouvelle génération de travailleur·ses, de moins en moins enclin·es à accepter de participer à la destruction des écosystèmes. Nous pouvons donc également parler de greenwashing lorsque les entreprises se montrent comme vertueuses dans leurs offres d’emploi, ou dans les salons de recrutement. Parés de notre définition, nous pouvons alors détailler qu’est ce qui relève de du greenwashing au sein des entreprises, et en quoi les actions des ingénieur·es participent à cette stratégie.
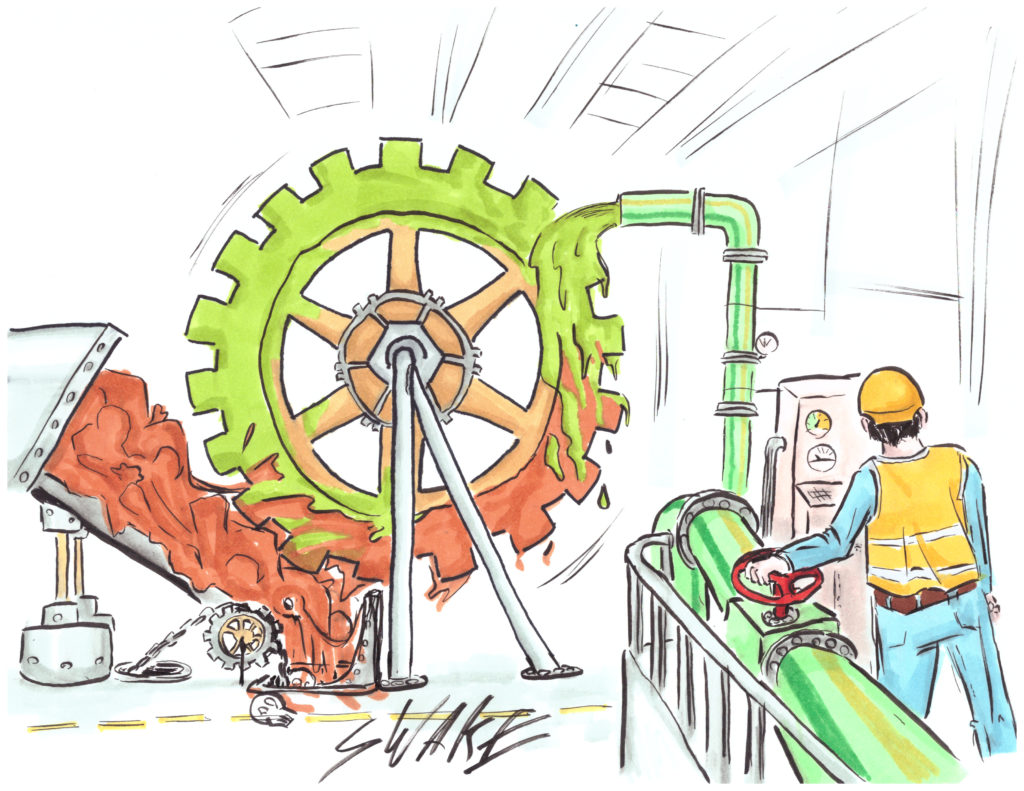
L’entreprise faussement éthique
Si l’on recherche avant tout à rejoindre une entreprise pour son éthique environnementale et sociale, il ne suffit pas de s’en tenir à son discours officiel. Il est nécessaire de s’informer en profondeur sur les actions réelles de cette entreprise. Une petite astuce : taper “Nom de l’entreprise” + “Scandale” dans un moteur de recherche peut s’avérer fort instructif. Certaines associations s’attachent à dévoiler les mensonges et hypocrisies des entreprises, comme par exemple en décernant un « prix pinocchio »[37]. L’association Public Eye montre par exemple comment l’entreprise Zara se pare d’un côté d’une image écologique et vertueuse, mais dont les actions sont de l’autre côté, désastreuse d’un point de vue social et environnemental dans les pays du Sud. Cet exemple est très illustratif du double visage de certaines entreprises. [38]
Il est également possible d’avoir une réflexion critique sur les entreprises indépendamment des discours officiels (positifs ou négatifs). L’on peut par exemple se demander en quoi une entreprise qui se revendique particulièrement éthique diffère des autres entreprises du secteur dans lequel elle intervient. Cet aspect éthique relève-t-il réellement du cœur d’activité de l’entreprise ? Ce cœur d’activité lui-même n’est-il pas la source d’un problème environnemental majeur ? De manière générale, développer sa culture sur les enjeux sociaux et environnementaux permet souvent d’affiner son esprit critique et de déceler les hypocrisies derrière les messages des entreprises. Attention néanmoins à vérifier les sources dans les deux sens et ne pas céder à ses biais de confirmations[39].
Le produit / service faussement vertueux
Certain·es préfèrent s’intéresser plus à la mission qui leur est confiée qu’à l’éthique de l’entreprise. En effet, il est tout à fait envisageable d’avoir une activité “bonne” au sein d’une structure “mauvaise”. Il existe par exemple, chez Total, des activités liées aux énergies renouvelables ou à l’efficacité énergétique. De nombreuses entreprises font des études en écoconception, ou des analyses de cycle de vie de leurs produits. Nous avions exposé dans un autre article consacré aux Low-Tech la difficulté d’intégrer les problématiques environnementales dans l’entreprise capitaliste[40]. Si les incohérences sont déjà visibles dans le mouvement Low-Tech, elles sont exacerbées par l’entreprise et les produits “classiques” a fortiori dans celles qui tiennent un double-discours. Si les missions techniques peuvent sembler intéressantes, il ne faudra souvent pas creuser beaucoup pour comprendre l’absurdité de ce rôle, et du fait qu’il participe au greenwashing de l’entreprise (voir point ci-dessous). Se satisfaire de ces métiers de surface pour leurs valeurs intrinsèque est donc un risque de perte profonde de sens en lien avec de nouvelles prises de conscience.
Participer au greenwashing
Certains postes offrent à l’ingénieur·e un rôle particulier de réflexion à la stratégie environnementale des entreprises, où à la mise en œuvre de ces stratégies. Cela peut par exemple passer par des emplois en lien avec les normes ISO9001 (efficacité énergétique), ISO14001 (management environnemental), ISO26000 (RSE). Si la mise en application de ces normes peut réellement apporter des améliorations concrètes et immédiates, il est cependant nécessaire de relativiser leur impact. Comme nous l’avons exprimé dans le paragraphe sur les stratégies RSE, en aucun cas celles-ci ne se placeront en opposition avec l’intérêt premier de l’entreprise, le chiffre d’affaires. Dans certaines circonstances, il pourra même s’agir d’outils permettant à l’entreprise de renforcer son argumentation quant à ses efforts écologiques, et donc participer, directement ou indirectement, volontairement ou non, au greenwashing de l’entreprise. Ces postes, qui permettent aux entreprise de se doter de leur “caution” environnementale, peuvent être beaucoup moins intéressant qu’ils n’y paraissent. On deviendra vite la personne sur qui retombe tout ce qui se rapporte de près ou de loin à l’écologie, mais sans vrai pouvoir de changement. Si il est aujourd’hui indispensable pour les entreprises d’avoir un·e responsable DD/RSE, il n’est absolument pas garanti qu’il·elle ait un champ d’action réel : sa mission peut très bien se limiter à éviter les gobelets jetables et mettre des autocollants pour éteindre les lumières.
Vendre la planète
La pire position dans laquelle puisse se retrouver une personne qui souhaite sincèrement améliorer la situation est celle de la malhonnêteté explicite. Fabriquer des arguments commerciaux injustifiés, falsifier des résultats, mentir lors de présentations, ou encore faire des concessions dramatiques au nom du profit… Si ces actions malhonnêtes (du moins intellectuellement), voire frauduleuses ne sont probablement pas (et nous l’espérons) la norme au sein des entreprises, elles existent et sont régulièrement documentées. L’ingénieur·e y joue souvent un rôle clé. Dans cette situation, la seule arme qui reste parfois pour garder l’estime de soi est de devenir lanceur·se d’alerte, mais cette position peut placer dans une grande souffrance. Si nous relativisons, dans le paragraphe suivant, l’attitude que l’on peut avoir face au greenwashing, il est nécessaire d’être lucide sur ces questions, et de quitter le navire avant de devenir fou·folle (ou alors simplement ne pas embarquer si l’on a des doutes).
Accepter ou refuser le greenwashing ?
Il sera difficile à l’ingénieur·e engagée·e qui souhaite intégrer le système pour le faire changer de l’intérieur, de ne pas accepter dans une certaine mesure les discours de greenwashing des entreprises. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faut fermer la porte à tous les emplois qui ne sont, soit pas dédiés à la transition écologique, soit des offres greenwashées.
Faire des concessions…
En effet, nous l’avons vu, l’entreprise est aujourd’hui ancrée dans une logique de durabilité faible. Intégrer l’entreprise signifie intégrer, qu’on le veuille ou non, cette logique. Nous n’affirmons pas qu’il n’existe pas, à la marge, des postes réellement vertueux en entreprise, ou qu’un poste qui n’est pas entièrement dédié à l’écologie soit par essence néfaste. Nous n’affirmons pas non plus que la définition que nous proposons pour nommer le greenwashing doit être érigée comme valeur morale absolue. En tant que mensonge, le greenwashing peut être jugé non en tant qu’acte répréhensible en soi, mais plutôt remis en perspective avec les conséquences qu’il entraîne (pour l’entreprise et pour le·la salarié·e). C’est d’ailleurs souvent cette logique conséquentialiste (qui analyse les conséquences) qui guide les pas de celles et ceux qui acceptent, malgré cette lucidité, de se frotter au monde de l’entreprise.
Car si le greenwashing a une connotation clairement négative dans nos imaginaires, cela ne signifie pas qu’il soit impossible de composer avec dans son activité professionnelle. La réelle raison qui doit nous pousser à accepter ou non un emploi est l’objectif que l’on se donne au travers de cette mission. En tant qu’ingénieur·es engagé·es, l’omniprésence du greenwashing nous décevra souvent quant à la réalisation de nos valeurs au travers des mission en elles-mêmes. Mais il peut exister de nombreuses autres raisons, en accord avec nos valeurs, d’accepter une mission (même en la sachant décevante). Un poste technique peut par exemple nous permettre de monter en compétence sur des thématiques cruciales (énergies renouvelables, calculs d’impacts environnementaux, …), grâce à l’expertise que les grosses structures acquièrent, malgré elles, sur ces questions. De plus, ces postes peuvent permettre de contribuer aux efforts des entreprises, et donc fournir un résultat sensible qui n’est pas toujours dénué de sens. D’autre part, les postes à responsabilité peuvent permettre d’espérer impulser des changements stratégiques au sein de l’entreprise. Par ailleurs, il est tout à fait envisageable qu’un poste qui ne soit pas explicitement dédié à l’écologie nous permette de faire vivre nos valeurs au sein de l’entreprise (et peut d’ailleurs même être un levier de légitimité). Nous reviendrons dans un deuxième article sur les actions et postures possibles pour l’ingénieur·e dans l’entreprise, mais également du “système” en général.
…mais être lucide
Même si l’on part avec la conviction qu’il est possible de trouver dans le monde classique de l’entreprise une place qui nous permettra d’exprimer nos valeurs, mieux vaut partir armé·e de lucidité dans cette aventure. La première chose est donc de se résoudre au fait suivant : une écrasante majorité des postes en entreprise qui semblent répondre aux enjeux sociétaux seront empreints, plus ou moins consciemment, plus ou moins en profondeur, d’une dimension de greenwashing. Il faut être lucide car découvrir, une fois inséré·e dans ce milieu, que nos actions n’ont pas l’effet escompté (voire contribuent à détériorer la situation), peut provoquer les pires chocs et pertes de sens. Mieux vaut s’en rendre compte avant, et accepter ou non les postes, en connaissance de cause.
Nous avons dépeint toutes les actions du monde capitaliste en faveur de l’environnement comme intrinsèquement mensongère (par la logique croissanciste qui régit précisément ce monde capitaliste), mais ce point de vue peut être nuancé. Il appartient à chacun de se faire sa propre conception de ce qu’est le greenwashing. Un des défis sera, pour ces ingénieur·es “infiltré·es”, de conserver leur esprit critique au sein de ces structures, et une certaine lucidité sur l’impact réel de leurs actions.
Conclusion
Dès lors que l’on accepte de considérer une définition sérieuse du greenwashing, l’intérêt réel des postes d’ingénieur·es au sein monde de l’entreprise peut sembler voler en éclat. C’est d’ailleurs un des facteurs à l’origine de la perte de sens des jeunes ingénieur·es. Quoi que fassent les entreprises, quelles que soient les missions “vertes” (ou non) offertes aux ingénieur·es, elles ne peuvent simplement pas, dans la logique actuelle, dépasser la durabilité faible, cosmétique. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il faille les fuir et rejeter unilatéralement ce greenwashing, qui a d’ailleurs des niveaux d’intensité divers. Ce qu’il faut avant tout c’est être lucide, et voir le mensonge là ou il est, pour pouvoir décider de si l’on est prêt·e à l’accepter ou non. Si l’on sait à l’avance ce qui nous attend, on peut s’y préparer, plus que si la vérité nous tombe dessus comme une douche froide après plusieurs années d’illusions.
La question qui se posera ensuite est la suivante : de quelle marge de manœuvre dispose-t-on alors en tant qu’ingénieur·es au sein de ce système pour faire évoluer les entreprises vers une logique de durabilité forte ? Le deuxième article de cette série exposera ainsi les opportunités de l’ingénieur·e au sein de l’entreprise (et du système en général), qu’il ou elle participe ou non au greenwashing de celle-ci.
****
Cette œuvre (texte et illustration) est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.
Notes et références
[1] Citation attribué à Francis Blanche, humoriste et acteur du XXe siècle
[2] Voir l’article Wikipédia à ce sujet https://fr.wikipedia.org/wiki/Greenwashing
[3] (en) Greenwashing, Merriam-Webster https://www.merriam-webster.com/dictionary/greenwashing
[4] Pub.be, 18/02/2019, Les nouvelles formes de Greenwashing, rencontre avec Kathrin Hartmann, disponible sur https://pub.be/fr/les-nouvelles-formes-de-greenwashing-rencontre-avec-kathrin-hartmann/
[5] Scandale lié à la falsification des tests d’émissions de pollution des voitures Volkswagen, révélé en 2015. Plus d’informations sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Volkswagen
[6] Selon les chiffres de l’Ademe disponibles sur https://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/chiffres-cles-observations/chiffres-cles, les voitures particulières (diesel + essence) représentent 56% des émissions liées au transport routier, représentant lui-même 39% des émissions totales de GES
[7] Damien Detcherry, sur Atterrissage.org, 06/03/2018, Quelles Technologies pour une société durable , https://atterrissage.org/technologies-societe-durable-65514b474700
[8] Voir à ce sujet le dossier spécial du magazine Que Choisir https://atterrissage.org/technologies-societe-durable-65514b474700
[9] Le sophisme de l’appel à la nature, consistant à dire que « tout ce qui est naturel est bon », est très présent dans les mouvements écologique. Pour un peu d’hygiène mentale, voici une page de blog constructive : https://menace-theoriste.fr/appel-nature/
[10] (en) Futerra, The Greenwashing Guide, disponible sur https://fr.slideshare.net/patsario/futerra-greenwash-guide
[11] Ademe, 2012 Guide des allégations environnementales (mis à jour en 2019), disponible sur https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/brochures/2012/Guide_allegat_environ_fr_2012.pdf
[12] Rapport de la commission mondiale sur le développement et l’environnement de l’ONU, Notre Avenir à Tous (Our Common Future), 1989, disponible en pdf sur : https://www.pfi-culture.org/wp-content/uploads/sites/1052/2016/04/1987rapportbrundtland.pdf
[13] (en) Georgescu-Roegen, 1971, The Entropy Law and the Economic Process.
[14] (en) Meadows et al. 1972, The Limits to Growth
[15] Les externalités négatives correspondent aux dégâts engendrés par les entreprises sans que ceux-ci ne soient pris en compte dans le coût de production. Il est en principe gratuit de polluer un lac, ou de faire travailler des enfants plutôt que des adultes.
[16] Avec une pensée pour l’exemple emblématique et symptomatique des ouvriers chinois pollinisant à la main leurs arbres, illustré dans l’article du journal Le Monde du 23/04/2014, Dans le Sichuan, des « hommes-abeilles » pollinisent à la main les vergers (disponible sur https://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/23/dans-les-vergers-du-sichuan-les-hommes-font-le-travail-des-abeilles_4405686_3244.html)
[17] (en) Neumayer (2010) Weak versus Strong Sustainability:Exploring the Limits of Two Opposing Paradigms
[18] (en) Steffen et al. (2015) Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet, DOI: 10.1126/science.1259855
[19] Concept promu notamment par la Fondation Ellen Mac Arthur : https://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/economie-circulaire/concept
[20] Promouvoir un fonctionnement circulaire de l’économie peut sembler marquer un changement significatif d’objectif, vers un objectif de durabilité plus forte. Cependant, il intègre aussi bien la logique néolibérale décrite dans le paragraphe suivant. voir (en) D’Amato et al (2017). Green, circular, bio economy: A comparative analysis of sustainability avenues. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.09.053
[21] C’est d’ailleurs plutôt l’inverse. Voir la vidéo DataGueule (2016), pour une bonne synthèse : Le PIB, cette fausse boussole, disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=4-V4SFp5S-k
[22] (en) Keen (2011), Debunking macroeconomics. Voir aussi (en) Blackford (2017) Economists Should Stop Defending Milton Friedman’s Pseudo-science, disponible sur https://evonomics.com/economists-stop-defending-milton-friedmans-pseudo-science/
[23] Plus d’information sur cet indice : https://fr.wikipedia.org/wiki/CAC_40
[24] On peut notamment penser à la logique du “triple bottom line”, proposant d’évaluer les entreprises en dressant un trible bilan : social (Poeple), envrionnemental (Planet) et bien sur, économique (Profit). Voir (en) Elkington, 1998, Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business
[25] (en) Stern (2004), The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve. DOI: 10.1016/j.worlddev.2004.03.004
[26] Jancovici (2015), Dormez tranquilles jusqu’en 2100
[27] European Environmental Bureau (2019), Decoupling Debunked, disponible sur : https://eeb.org/library/decoupling-debunked/
[28] Gaëtan Ekszterowicz, sur Medium (28/02/2018), RSE – Entre bullshit com’ et vrais engagements, disponible sur https://medium.com/@geksz/rse-entre-bullshit-com-et-vrais-engagements-819100994941
[29] Clément Fournier, sur Youmatter, Les entreprises avec la meilleure réputation RSE en 2019 : le top 10, disponible sur https://youmatter.world/fr/reputation-rse-classement-entreprises-2019/. Notons que cet article souligne lui-même le manque de pertinence de l’indicateur en question : la « réputation RSE ». On retrouve là le symbole d’une RSE qui a pour simple objectif la communication, au dépends ne serait-ce que d’une analyse comparative chiffrée.
[30] Androland.com, 26/07/2018, Disney renforce son engagement pour la protection de l’environnement, disponible sur https://www.androland.com/disney-renforce-son-engagement-pour-la-protection-de-l-environnement-956.html
[31] La voix du nord, 27/12/2019, Bahamas: Disney se paie une deuxième île et tant pis si ça dérange Nemo, disponible sur https://www.lavoixdunord.fr/686452/article/2019-12-27/bahamas-disney-se-paie-une-deuxieme-ile-et-tant-pis-si-ca-derange-nemo
[32] Le Parisien, 11 mars 2020, Environnement : Lego se met au vert, disponible sur http://www.leparisien.fr/environnement/environnement-lego-se-met-au-vert-11-03-2020-8277192.php
[33] Amandine Legrand, sur Admical.org, La philantropie des GAFA, entre engagement individuel des fondateurs et mécenat d’entreprise, disponible sur http://admical.org/expertise/la-philanthropie-des-gafa-entre-engagement-individuel-des-fondateurs-et-mecenat
[34] François Jarraud, sur cafepedagogique.net, 16/05/2017, Numérique : Le ministère ouvre l’Ecole à Google ? , disponible sur //http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/05/16052017Article636305160274839331.aspx
[35] Sur le paradoxe du philanthrocaptialisme, voir la vidéo de DataGueule, 2020, Philanthropie : Le capital se fout de la charité, disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=GT0XkfEB5T8. La partie sur la fondation Bill Gates démarre à 2’25.
[36] GIEC, 2019, Rapport spécial sur le réchauffement à 1.5°C, disponible (en) sur https://www.ipcc.ch/sr15/
[37] Site internet Prix Pinocchio : https://www.prix-pinocchio.org/
[38] Public Eye, 2019, Le véritable prix d’un pull Zara, disponible sur https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/vetements/veritable-prix-pull-de-zara. Voir également pour l’aspect environnemental l’article du Courrier Internationel (13/10/2016) Enquête. H&M, Zara, Topshop : la “fast fashion”, un fléau écologique, disponible sur https://www.courrierinternational.com/article/enquete-hm-zara-topshop-la-fast-fashion-un-fleau-ecologique
[39] Le biais de confirmation consiste à croire une information simplement parce qu’elle va dans le sens de nos convictions.
[40] Ingénieurs Engagés, 2019, Low-Tech : Le paradoxe de l’entrepreneuriat, disponible sur https://ingenieurs-engages.org/2019/12/low-tech-le-paradoxe-de-lentrepreneuriat/