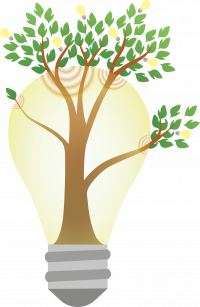Sortir de la voie royale
Cet article fait partie d’une série traitant sur les leviers d’action de l’ingénieur·e au sein du système, dont les réflexions ont été initiées lors du café-débat ayant eu lieu sur le Discord Ingénieurs Engagés le 09/04/2020.
Article 2 : Ingénieur·e engagé·e en entreprise – approche stratégique d’une posture dissonante
Article 3 : Ingénieur·e engagé·e en entreprise : quelle marge de manœuvre pour agir ?
Article 4 : Sortir de la voie royale
Auteur : Nicolas B
Relecture : Groupe Montrer les Possibles
Note : La série de témoignage “Changer le Système de l’Intérieur” (CLSI pour les intimes), publiée récemment sur le site d’Ingénieur·es Engagé·es, avait pour but d’inspirer et renforcer cet article au travers d’expériences multiples vécues par des personnes engagées. Vous retrouverez des liens vers ces témoignages dans ce texte, proche des parties auxquelles ils ont le plus contribué.
Note 2 : Si vous avez une expérience dont vous souhaitez également témoigner pour compléter cette série, n’hésitez pas à vous rapprocher du projet Livre ! 😉
Introduction
Les développements faits dans les trois articles précédents portent essentiellement sur les entreprises, et en particulier les “grandes” entreprises. Celles-ci sont en effet une voie d’orientation privilégiée pour les ingénieur·es, où ils·elles trouvent l’assurance d’un bon salaire et d’une reconnaissance sociale. Mais ce débouché est loin d’être le seul auquel ouvre le diplôme. Nous nous intéresserons donc dans ce dernier article sur les autres voies professionnelles parfois moins visibles qui s’offrent aux ingénieur·es souhaitant changer le système, et sur leur marge de manœuvre qu’elles offrent.
Toutes les entreprises se valent-elles ?
Fer de lance de l’idéologie néolibérale, les entreprises sont également un bouc émissaire fréquent dans les milieux contestataires du capitalisme. L’entreprise serait-elle donc par essence mauvaise ? Si nous avons largement développé dans les articles précédents sur les travers existant dans le système actuel, nous avons laissé de côté des situations où l’entreprise pourrait effectivement être vertueuse. Une telle situation reviendrait alors non plus à chercher à transformer l’entreprise de l’intérieur en tant que système, mais de transformer le système de manière générale par le moyen de l’entreprise.
Une (entre)prise sur la société
L’action des entreprises a un impact déterminant sur l’organisation de la société. Une société qui fournit un service de livraison à domicile au travers de personnes qui se déclarent auto-entrepreneurs·euses favorise à la fois ce modèle salarial précarisé et oppressant, tout en entérinant un rapport de domination entre ceux·celles qui livrent et ceux·celles qui commandent. Un groupe industriel qui a massivement investi pour développer une technologie particulière va déployer des moyens financiers pharaoniques pour que cette technologie se déploie le plus possible, à la fois en l’imposant comme une nécessité aux yeux des consommateurs par la publicité, et en faisant pression sur la rédaction de lois pour qu’elles lui soient favorables[1]. Mais à contrario, une entreprise qui propose sur le marché des produits dont la conception a été pensée dans les moindres détails pour répondre à un cahier des charges environnemental offre aux consommateurs la possibilité de continuer à répondre à leurs besoins en réduisant leur impact. Ou encore, une entreprise construite de manière à offrir un espace démocratique et respectueux envers l’ensemble de ses salarié·es offre un modèle alternatif concret aux rapports de domination qui y prennent habituellement place. L’entreprise est avant tout le reflet d’une volonté politique, celle des personnes qui la gouvernent. Elle n’agit pas d’elle-même, livrée à la “main invisible” du marché, elle suit l’application d’une stratégie déterminée, pour assurer avant tout sa survie[2], et généralement la satisfaction de ses dirigeant·es ou ses actionnaires. Mais détourner cette stratégie et cette volonté vers une cause porteuse de sens est bel et bien une possibilité qu’il ne faut pas négliger.
Une pierre angulaire qui doit rester humble
Peu importe le secteur où l’on se situe professionnellement, il existe d’autres manières de faire, des leviers d’amélioration, des enjeux majeurs. En agriculture, le développement de modèles qui s’affranchissent de la dépendance dans les énergies fossiles et garantissent le maintien de la biodiversité des sols et de l’environnement. Dans le bâtiment, le développement de nouvelles techniques de constructions plus sobres, et de nouveaux matériaux. Dans l’énergie, le développement et le déploiement de technologies renouvelables et durables. Dans l’informatique et le numérique, la modération de la course à la high-tech pour s’orienter vers des outils robustes, nécessaires, et utiles à la transition. Dans la fabrication de produits, la recherche continue d’alternatives moins impactantes. Des changements majeurs sont nécessaires partout et en même temps. Et dans chacun de ces métiers, il y a besoin d’ingénieur·es : des besoins de calculs, d’expérimentations, de dimensionnement, de mesure de l’efficacité et des impacts, d’amélioration, d’optimisation. Cela demande parfois un haut niveau de connaissances ou de technicité, un vaste réseau social, des capacités de travail et d’investissement importantes. De fait, les ingénieur·es disposent de ces qualités et peuvent donc être des pierres angulaires de ces changements. Et seules des personnes ayant une conscience aiguë des impacts de chacune de ces activités peut identifier les marges d’amélioration environnementales et les moyens de les mettre en œuvre. Il ne faut néanmoins pas oublier que cette position privilégiée est acquise aux dépens de classes sociales moins favorisées, et que les études d’ingénieurs ont une forte influence sur la vision du monde de leurs élèves – ceux·celles-ci étant amené·es à se considérer comme une élite, s’élevant au dessus des masses car ils·elles détiennent un savoir technique qui est indiscutable. C’est pourquoi même dans cette démarche, les ingénieur·es ne doivent pas oublier de rester humbles et ouvert·es au monde social qui les entoure.
Témoignage 1 : Et si même les banques pouvaient changer
L’autonomie, première nécessité
Pour mettre en œuvre ces nouvelles perspectives, la condition nécessaire est de pouvoir choisir, au sein de ces différents secteurs, quelle voie suivre et quelle voie ne pas suivre. En d’autres termes, cela nécessite d’avoir de l’autonomie sur la manière de réaliser son métier : une autonomie qui permette d’intégrer pleinement tous les enjeux environnementaux. Cette autonomie est loin d’être acquise, et doit se situer tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des salarié·es de cette entreprise.
Deux niveaux d’autonomie
Le premier niveau d’autonomie doit se situer entre l’entreprise et les composantes toxiques de la société qui l’encouragent à perpétuer le système insoutenable ou à faire du greenwashing[3]. Si chaque entreprise est très fortement liée à de nombreuses parties prenantes (fournisseurs, clients, concurrents…), et n’est de fait pas indépendante, elle n’est pas nécessairement vouée à subir ses choix. Une entreprise réellement éthique doit avoir conscience de sa raison d’être, c’est-à-dire de l’utilité qu’elle apporte à la société. Elle doit également avoir toute la latitude possible pour se donner les moyens d’atteindre cette raison d’être, et notamment ne pas être liée à un impératif de rentabilité imposé par la logique actionnariale.
Au-delà de cet objectif vertueux, un deuxième niveau d’autonomie semble désirable entre les salarié·es et la direction de l’entreprise. Car malgré une excellente raison d’être, une entreprise tyrannique ne saurait être un cadre vertueux pour exprimer un engagement. Ouvrir la gouvernance de l’entreprise à tous les collaborateurs, c’est reconnaître que chaque personne a un avis pertinent, et lui donner le pouvoir de s’exprimer. C’est également faire en sorte que les aspirations individuelles puissent, dans le cadre des missions de l’entreprise, être accomplies (à condition de ne pas s’opposer à la raison d’être), et donc donner toute la marge de manœuvre possible aux personnes les plus engagées.
Dans Reinventing Organizations[4], Laloux expose comment les organisations (dont les entreprises) peuvent se doter d’une telle raison d’être, et les moyens dont elles doivent se doter pour l’accomplir. L’auteur suggère que seuls des modèles de gouvernance partagée des entreprises sont à même de garantir le maintien d’un cap collectif, notamment grâce au modèle holacratique[5]. Certaines structures d’entreprises sont particulièrement propices pour que puissent s’exprimer ces deux niveaux d’autonomie. C’est notamment le cas des Sociétés Coopératives de Production (SCOP) dans lesquelles les salariés sont actionnaires majoritaires et ont donc un réel pouvoir de décision[6], ou des Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) qui sont assignées à une mission d’intérêt public.
Témoignage 2 : Transformer un secteur par l’exemple
Pas de recette magique
Si ces conditions d’autonomie sont nécessaires, elles sont loin d’être suffisantes. Car l’autonomisation des individus est toujours à double tranchant : elle augmente la responsabilité individuelle, et potentiellement le niveau d’implication attendu. Ainsi, ces nouvelles formes de travail démocratiques, ou favorisant le bien-être des salarié·es dessinent parfois les barreaux de systèmes d’oppression encore plus pervers que le salariat hiérarchique classique dans lequel n’est attendu rien d’autre que la mission décrite sur la fiche de poste[7]. Inversement, une structure classique d’entreprise ne garantit pas non plus un fonctionnement tyrannique et totalement déconnecté des enjeux sociaux et environnementaux. Dans ce second cas, la bonne volonté de l’entreprise repose uniquement dans la proactivité des personnes qui la dirigent. Celles-ci peuvent tout à fait avoir une vision sincère et éthique du travail et de l’environnement, mais cela pourra à tout moment basculer dans des logiques différentes. Le statut d’une entreprise ne garantit donc en rien la vertu de son action, chaque situation doit être examinée au cas par cas avec le regard attentif d’un esprit critique aiguisé.
| L’Économie Sociale et Solidaire Un secteur qui prône par essence l’utilité sociale avant la performance économique est celui de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)[8]. Il englobe des structures économiques qui par leur nature n’ont pas vocation à chercher un fort niveau de profitabilité. C’est également un secteur qui emploie de manière privilégiée les personnes qui ont des difficultés à trouver un emploi dans l’entreprise classique : personnes en situation de handicap, personnes très éloignées de l’emploi ou sortant de prison… Le secteur associatif est également un pilier de l’économie sociale et solidaire. En effet le travail associatif n’est pas exclusivement bénévole, et offre dans de nombreux cas des postes permanents à des salarié·es. Si certaines associations ont un rôle social qui s’éloigne de l’ingénierie, il existe en revanche tout un secteur économique associatif qui se positionne sur des questions techniques d’intérêt pour les ingénieur·es. La structure associative peut ainsi être le choix délibéré de porteur·euses de projets afin d’assurer par exemple que leurs activités restent à but non lucratif, et d’ouvrir la gouvernance à des tierces personnes. On peut par exemple citer l’entreprise associative Solagro qui promeut la transition énergétique et agricole. Si l’ESS regroupe un ensemble de structures qui semblent attrayantes pour les personnes en recherche de sens, elle n’est encore une fois pas une recette magique systématique. Certaines d’entre elles peuvent se contenter malgré les apparences de chercher à maximiser les rentrées d’argent et minimiser les sorties en faisant fi des questions sociales et environnementales. D’autres peuvent être limitées par le système économique actuel et ne pas faire assez de chiffre d’affaires pour rémunérer leurs employé·es au même niveau que les entreprises « classiques ». C’est donc encore une fois au cas par cas qu’il faudra juger. |
L’entrepreneuriat comme un moyen de créer les alternatives
Le monde des entreprises existantes ressemble vite à une jungle dans laquelle il est difficile de faire la part des choses entre la communication et les engagements réels. Le greenwashing ou la dépendance envers des multinationales peu éthiques n’est jamais très loin. De plus, le nombre de places disponibles dans des entreprises éthiques peut sembler très limité au regard de la demande d’engagement des ingénieur·es. Celles-ci sont souvent moins visibles que les grosses entreprises, et n’ont pas systématiquement vocation à s’agrandir. D’ailleurs, il n’existera probablement jamais d’entreprise parfaite, toute entreprise aura des défauts – le premier pouvant être la localisation géographique éloignée de son territoire de résidence. Au vu de cela, l’entrepreneuriat peut alors apparaître comme la solution. Celui-ci est l’assurance d’une liberté maximale sur tous les choix faits, et ouvre complètement le champ des possibles. Dans un monde en transition, énormément de nouvelles choses sont à inventer. De plus, dans une vision qui décentralise le pouvoir de l’entreprise, il est impératif qu’il existe un nombre et une variété importante d’acteurs au service de cette transition. Cela implique donc de multiplier les aventures entrepreneuriales à une échelle humaine. Néanmoins, c’est également un des modèles les plus exigeants et les plus incertains, qui maximise également la précarité (jusqu’à ce que le modèle économique se pérennise, du moins). Nous ne développerons pas ce thème plus longuement dans cet article, mais rappelons que nous avions déjà évoqué dans un précédent les limites que rencontre ce modèle lorsqu’il se confronte à des logiques environnementales. Pour résumer le propos de ce chapitre, il ne suffit pas d’entreprendre dans une voie qui nous semble vertueuse pour s’assurer que notre effet sur la société est positif[9].
| Les CAE : un modèle d’auto-entrepreneuriat coopératif Une des manières de réduire l’isolement lors de l’entrepreneuriat est de se joindre à une coopérative d’activité et d’emploi. Il s’agit d’une structure dans laquelle chaque personne est salariée, et auto-entrepreneuse. La structure assure les fonctions classiques des entreprises (RH, juridique, …) et laisse à chacun le soin de développer son activité. En échange, les personnes contribuent à la structure via leur chiffre d’affaires. Elles ont également un modèle de gouvernance démocratique qui donne voix à tous les auto-entrepreneurs. Ce système est donc un compromis idéal entre le besoin de stabilité et l’autonomie souhaitée pour développer une activité. Néanmoins, dans ce modèle comme pour toutes les formes d’entrepreneuriat, beaucoup d’entrepreneur·es vivent du chômage, ou de travail salarié à temps partiel, pendant 1 à 2 ans (minimum) avant de pouvoir se rémunérer. Ce sont d’ailleurs ces mêmes droits au chômage qui s’effritent au fil des réformes[10]. |
Témoignage 3 : Développer son activité en CAE
Un levier d’action de l’entreprise autonome : le lobbying
Le travail dans une entreprise éthique, qu’elle soit issue de son propre chef ou non, permet en principe que les actions faites au travers de l’activité professionnelle aient une répercussion positive sur la société. Fournir de nouveaux biens, nouveaux services, nouvelles expertises, qui sont en accord avec les impératifs environnementaux, et nécessaires à la transition. Mais un autre pouvoir réside également dans toutes ces activités qui font partie du système mais y sont relativement marginales : celui d’exemplarité et de lobbying. En s’implantant, en développant leurs outils et leurs normes de travail, en développant leurs réseaux et leurs expériences réussies, toutes ces entreprises contribuent à la construction de nouveaux récits. Elles permettent de mettre sur le devant de la scène des alternatives, permettent d’alimenter des réflexions politiques grâce à de nouvelles connaissances, et intègrent peu à peu des cercles d’action beaucoup plus traditionnels. Elles peuvent ainsi diffuser une vision alternative, en tissant des partenariats avec les grandes entreprises pour sous-traiter certaines de leurs activités, ou encore en fournissant de nouveaux référentiels pour la commande publique. Il est par exemple possible, en marge de l’activité strictement professionnelle et rémunérée, de mettre à profit l’expérience acquise pour outiller des collectifs, des associations, et produire de la documentation technique visant à diffuser ces alternatives.
Deux voies de lobbying : Think Tanks et Cabinets de Conseil
Il existe des types d’entreprises qui se prêtent particulièrement à ces actions de lobbying. C’est le cas par exemple des cabinets de conseils. Si ceux-ci ne sont que très rarement orientés exclusivement sur des questions environnementales, ils ont un rôle clé dans le monde économique. En effet, une des tendances générales est l’externalisation et la sous-traitance de certaines tâches par les plus grosses entreprises et leurs succursales. Cela leur permet pragmatiquement de réduire au maximum le nombre d’employé·es permanent·es en faisant régulièrement appel à des expertises externes sur des sujets précis. Ces prestations peuvent non seulement être un moyen efficace d’impulser des changement au sein des entreprises (parfois plus efficace qu’en tant que salarié·e de cette entreprise), mais donnent également libre cours au cabinet de conseil ou d’expertise pour promouvoir sa manière de voir les choses – du moment que d’autres acteurs sont prêts à s’offrir cette expertise. C’est notamment par ce biais que le cabinet Carbone 4 s’est donné pour mission de transformer de l’intérieur les plus grandes et plus contestables entreprises. Comme nous le montre cet exemple, ce niveau d’action nécessite un certain niveau de compromis, voire de compromission, car pour travailler avec des entreprises classiques il faut savoir adopter leur langage et leurs objectifs.
Parallèlement à cela, il faut citer un type de structure qui a une marge d’action particulière : les think tanks. De manière générale, ceux-ci ont un rôle clé dans l’alimentation des réflexions politiques, en fournissant des analyses et des recommandations pour les décideurs. Ces dernières années ont vu émerger un certain nombre de structures prenant le devant de la scène sur la thématique de la transition, dont les plus connues sont sans doute les associations Négawatt et The Shift Project. La première, par exemple, met régulièrement à jour des scénarios de transition énergétique que peuvent s’approprier les citoyens et les décideur·euses[11]. Quant à la seconde, on peut citer, entre beaucoup d’autres actions, leur proactivité dans la transformation des enseignements pour y incorporer les enjeux énergie et climat[12].
La voie du secteur public
La principale alternative pour les ingénieur·es qui ne souhaitent pas se diriger vers le secteur privé est celle souvent méconnue du secteur public. Celui-ci s’affranchit en principe de toute recherche de profit, et place l’intérêt général comme central. Cette philosophie peut se traduire dans le fait d’avoir le “sens du service public”. En réalité, les aménagements publics étaient historiquement confiés aux ingénieurs issus de grandes écoles : les mines, les ponts et chaussées,…. Cette compétence est progressivement passée aux mains du privé, mais elle peut toujours revenir dans le public pour mieux servir le bien commun.
Les services environnementaux
De fait, la puissance publique gère un nombre important d’activités liées à la préservation de l’environnement. Deux exemples immédiats sont le secteur de l’eau et celui des déchets. Les collectivités – à divers échelles, selon les enjeux – ont la responsabilité de l’approvisionnement en eau des habitants, de l’assainissement des eaux usées, et de la gestion des déchets municipaux. Ce sont des secteurs qui sont parfois externalisés mais qui nécessitent souvent une compétence technique de la part des acteurs publics. Le monde de l’eau implique particulièrement ces experts techniques, parmi lesquels les ingénieur·es figurent en bonne place.
Au niveau environnemental, il existe également différentes agences publiques à des échelles nationales ou régionales qui se positionnent explicitement sur ces questions, et interagissent avec les acteurs publics et privés. L’Ademe, le Cerema, l’ONF, mais également tous les organismes de contrôle de la pollution (DREAL, ARS…) sont des organismes dans lesquels une expertise technique est nécessaire.
Les différents services publics employant des personnels techniques sont également des lieux propices pour la mise en application de logiques éthiques et environnementales. Moins limitées par la contrainte du profit et la frilosité des entreprises, les personnes intervenant dans le public peuvent plus facilement justifier des propositions de modification des modes de fonctionnement qui sont aujourd’hui peu vertueux. Cela est notamment encouragé par l’exemplarité que se doit de montrer le secteur public sur ces questions afin d’être cohérent avec les discours politiques environnementaux.
Témoignage 4 : Travailler à la protection du milieu aquatique
Agir au cœur de l’action dans les collectivités territoriales
Au plus proche de la vie politique locale, les collectivités territoriales, communes, ou communautés de communes ont également besoin de compétences techniques. Dans ces postes qui sont de plus en plus ouverts aux personnes n’ayant pas le statut de fonctionnaire, alors dites ‘contractuelles’ (voir encadré), il existe une grande autonomie pour être proactif·ve dans la réalisation des projets. Souvent peu nombreux·ses, les conseiller·es techniques ont un vrai pouvoir de cadrage dans les projets locaux et peuvent y inculquer leurs valeurs environnementales. Malgré tout, ces projets resteront néanmoins ultimement soumis à la volonté politique des personnes élues.
| Le statut ambivalent de fonctionnaire Si le statut de fonctionnaire est souvent critiqué par les personnes ne l’ayant pas comme la garantie de la sécurité de l’emploi et une position privilégiée, la réalité est assez différente. Il existe un statut d’ingénieur de la fonction publique. Celui-ci s’obtient grâce à un concours, mais n’offre pas la garantie d’être affecté à une mission qui nous intéresse, en plus d’imposer un salaire bien inférieur – car indexé sur un indice – que des contractuels faisant la même mission. La progression des salaires des fonctionnaires est d’ailleurs alignée sur cet indice, qui a été gelé depuis plusieurs années pour des raisons politiques de limitation de la dépense publique. Si la ‘titularisation’ – l’obtention du statut – offre la possibilité d’avoir des missions variées, elle n’est en rien la garantie d’une sérénité, dans un monde où les moyens sont en constante baisse et où les logiques managériales de plus en plus fréquentes. Les personnes non titulaires sont dites ‘contractuelles’. Elles font peu ou prou le même métier que les premières, mais ont un contrat à durée limitée – qui peut en pratique être amené à se renouveler assez longtemps. Véritables intérimaires et pièces de rechange du service public, les contractuels ont ainsi plus de liberté de changer de carrière, et de choisir leur mission, et souvent même un salaire supérieur aux titulaires pour une même mission – ce qui contribue également à dégrader l’ambiance de travail dans la fonction publique. Ces avantages sont contrebalancés par le fait que leur mission puisse prendre fin sans leur laisser d’opportunités. |
Témoignage 5 : Conseiller une collectivité
Le monde de la recherche
Enfin, une voie particulière qui s’offre aux ingénieur·es est celle de la recherche, à laquelle ils·elles peuvent avoir accès sous condition d’avoir effectué un stage en laboratoire durant leurs études (ou de se réorienter vers un master en fin de cursus). La première étape de ce parcours est le doctorat qui s’effectue normalement en trois ans. Selon le domaine, cette étape peut permettre non seulement d’approfondir ses connaissances sur les sujets porteurs de sens, mais également de devenir acteur·ice de l’évolution des connaissances sur ces sujets, en y inculquant sa propre vision. C’est une liberté extrêmement forte, même si la temporalité et la difficulté de l’exercice de la thèse peuvent être décourageantes.
La recherche est un monde d’autonomie ambivalente. Le·la chercheur·euse est en théorie très libre sur son activité de recherche. Il est ainsi possible d’investir des champs environnementaux pour approfondir les connaissances ou identifier de nouvelles solutions techniques. Poser les problèmes d’une nouvelle manière permet également de sensibiliser la communauté de chercheur·euses et de faire évoluer petit à petit les pratiques. Cependant, les chercheurs·euses sont extrêmement dépendants des financements qui leur sont accordés, qui sont loin d’aller toujours dans le sens de la sobriété et de la transition (comme le dénonce l’AtÉcoPol[13]). Cela est vrai a fortiori pour les thèses, qui sont souvent financées par les mêmes programmes. Celles-ci peuvent aussi être faites en partenariat avec des entreprises (Cifre) et dans ce cas souvent tournées vers le développement de technologies que l’on pourra ou non juger vertueuses.
Ainsi, au-delà d’un changement du système par la recherche, entreprise longue s’il en est (l’ordre de grandeur d’un projet est d’environ trois ans), il est également nécessaire d’entreprendre un changement au sein de ce monde. La communauté scientifique, si elle comporte certains membres très engagés, reflète aussi un fort conservatisme du fait qu’elle s’inscrit dans cette temporalité très longue. Au-delà des financements, il existe des mécanismes très peu vertueux au sein de la recherche (comme la logique du publish or perish[14]). En dehors de ces sentiers, des voies marginales de recherche existent mais sont très peu valorisées, même si elles peuvent être plus porteuses de sens : la recherche-action, la recherche indépendante…
La mission de recherche peut également être accolée à celle d’enseignement dans le supérieur, où il existe une marge de manœuvre qui peut être intéressante. Dans un contexte où il y a une prise de conscience générale sur la nécessité de changer les formations, les écoles sont de plus en plus ouvertes à de nouveaux contenus et de nouvelles méthodes pédagogiques. Cependant, la recherche est aussi un monde de précarisation, car s’il est possible de trouver des post-doctorats après la thèse, les postes permanents accessibles chaque année sont très rares. Comme partout, les injonctions à la productivité, la compétitivité, et la rentabilité pénètrent progressivement ce monde qui devrait pourtant être remis au cœur du débat démocratique[15].
Témoignage 6 : intégrer le monde de la recherche
Le couperet de la décision politique – Franchir la barrière ?
Dans le service public plus que n’importe où, la décision revient souvent à un acteur politique, sur des critères qui échappent parfois aux valeurs défendues personnellement. Afin de faire sauter ce barrage politique, certain·es pourront trouver intéressante la perspective de s’engager personnellement en politique pour promouvoir ses idées. Si cette voie peut en effet permettre d’étendre sa marge de manœuvre, elle requiert des compétences qui vont bien au-delà de la formation d’ingénieur. Par ailleurs, il ne faut pas non plus tomber dans le travers de croire que la technique est neutre et suffisante pour déterminer les tenants et aboutissants d’un programme politique. Un poste politique demandera nécessairement des compromis avec les réalités sociales, ainsi que les oppositions et soutiens potentiels.
Start’up Nation – les dégâts faits au secteur public
Si le secteur public a pour mission principale le service à la collectivité, cela ne le prémunit pas des travers du monde de l’entreprise classique. En effet, les politiques nationales tendent à sans cesse réduire les moyens et couper les budgets à tous les niveaux, ce qui engendre de nombreux effets néfastes. Les établissements publics comme les hôpitaux sont incités à équilibrer leur budget, alors que leur mission n’a pas vocation à être rentable. Le manque de moyen peut ainsi être une source de frustration, même dans les institutions qui ont pour but d’agir dans le bon sens. C’est ainsi que certaines personnes travaillant au Ministère de l’Écologie déplorent ne pas avoir les moyens nécessaire pour accomplir leurs missions[16].
Témoignage 7 : Défendre une vision environnementale du service public
| Refuser de parvenir ? Et si finalement aucune de ces solutions ne semble satisfaisante, que resterait-il pour trouver un sens à son action dans le monde ? Face à la gravité de la situation et l’absurdité du système économique dominant, la dernière solution peut alors sembler de fuir le système[17]. Abandonner son diplôme pour se tourner vers une activité manuelle, agricole, ou sociale. Se recentrer sur l’essentiel, bâtir du lien et de la résilience dans son environnement local, mais en dehors des structures classiques. Ce modèle, qui fait écho au “refus de parvenir”[18] peut être une réelle délivrance, mais ne sera pas développé dans cette série d’articles qui se concentre sur les possibilités d’actions auxquelles donnent accès le statut -et le privilège – d’ingénieur·e. Il ne s’agit pas de trancher le débat de savoir s’il est plus utile d’agir ou non en tant qu’ingénieur·e, mais plutôt d’explorer en profondeur un seul de ces aspects. |
Témoignage 8 : Chercher sa voie grâce au Service Civique
Conclusion : trouver une voie qui fait sens
Nous avons exposé dans ce dernier article un nombre important de leviers et de voies dans lesquelles il est possible de trouver du sens et espérer “changer le système”. Bien entendu, aucune n’est parfaite, nous avons tenté d’en exposer le plus honnêtement possible les limites. En guise de conclusion, il est impossible de pointer l’une ou l’autre de ces voies professionnelles. D’une part parce qu’il est réellement important de considérer chaque opportunité au cas par cas, en fonction de tous les éléments de contexte : activité de la structure, statut juridique, mode de gouvernance, mode de fonctionnement réel… D’autre part, parce que ce choix dépend avant tout de facteurs psychologiques et émotionnels propres à chacun·e. Il est en effet impossible d’agir si l’on est dans une situation dans laquelle on est en dissonance, mal à l’aise, en dépression… Avoir un environnement de travail (comprenant les valeurs de la structure et des missions) qui permette de s’épanouir est donc la première des nécessités pour envisager de changer le système. Chacun·e a ses forces et faiblesses, ses exigences, ses limites, des choses qui sont acceptables ou inacceptables, des besoins matériels ou immatériels… et c’est cette diversité qui permettra aux ingénieur·es engagé·es de se saisir de tous les interstices possibles pour faire vivre leurs valeurs à contre-courant d’un monde professionnel globalement assez hostile à leur engagement. La présence d’ingénieur·es engagé·es dans chacune de ces voies est sans doute la meilleure stratégie et la meilleure alternative envisageable pour engager un virage sociétal avec force. Il est nécessaire qu’il y ait, dans le monde public comme dans le monde privé, un maximum d’ingénieur·es qui comprennent les enjeux et les limites de leur modèle, et qui font tout leur possible avec la marge de manœuvre à leur disposition pour faire évoluer la situation.
****
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.
Merci à toutes les personnes qui ont accepté de partager leur expérience au travers des témoignages, ainsi qu’aux relecteur·ices attentif·ves du projet Livre.
Notes et références
[1] Voir notamment comment les lobbys industriels imposent leurs technologies au mépris des conséquences sanitaires ou environnementales. voir E.M. Conway, N. Oreskes, “Les Marchands de doute” (2014)
[2] Voir le 3e article de cette série https://ingenieurs-engages.org/2020/12/changer-le-systeme-de-linterieur-3/
[3] Comme nous l’avons largement développé dans le premier article https://ingenieurs-engages.org/2020/05/changer-le-systeme-de-linterieur-1/
[4] Laloux, 2014, Reinventing Organizations : Vers des communautés de travail inspirées
[5] Pour en savoir plus sur l’holacratie : https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/instaurer-une-gouvernance-ecologique-avec-lholacratie ; http://universite-du-nous.org/blog/. Note : malgré ses apparences très attrayantes, il est important de garder un certain esprit critique vis à vis de ces concepts. Les théories institutionnelles derrière ceux-ci, notamment celle de la spirale dynamique, sont plus que discutables.
[6] Voir cette vidéo récapitulative sur les SCOP : Mulch, Les Super-Entreprises https://www.youtube.com/watch?v=CHIUGpRL-ws
[7] Voir par exemple une vision critique dans cet article : Le Journal du Net, 2016, L’entreprise libérée, révolution ou imposture ?, disponible sur : https://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/1170678-entreprise-liberee/
[8] Voir les informations gouvernementales sur ce secteur pour plus de détails : https://www.economie.gouv.fr/cedef/economie-sociale-et-solidaire
[9] L’article à ce sujet : Nicolas B, 2019, Low Tech, le paradoxe de l’entrepreneuriat https://ingenieurs-engages.org/2019/12/low-tech-le-paradoxe-de-lentrepreneuriat/
[10] Paradoxalement, ces mesures sont prises au nom d’une idéologie politique qui sur-valorise les entrepreneur·euses, les présentant comme des héro·ïnes de la Start’up Nation.
[11] Le dernier scénario en date est disponible à l’adresse suivante : https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2022
[12] La synthèse de leurs actions à ce sujet est présentée sur cette page : https://theshiftproject.org/lavenir-de-la-planete-dans-lenseignement-superieur/
[13] L’atelier d’Ecologie Politique est un collectif de chercheur·euses engagé·es pour que la recherche reprenne en main les questions environnementales https://atecopol.hypotheses.org/
[14] Le Temps, 27/09/2017, «Publish or perish», quand la science met les chercheurs sous pression, disponible sur : https://www.letemps.ch/sciences/2017/09/19/publish-or-perish-science-met-chercheurs-pression ; et pour approfondir : Le Monde Diplomatique (décembre 2008), Comment devenir le chercheur du mois https://www.monde-diplomatique.fr/2008/12/JOURDE/16610
[15] Vision que porte notamment le collectif “Sciences Citoyenes” ; https://sciencescitoyennes.org/
[16] Reporterre, 06/04/2021, Au ministère de l’Écologie, les fonctionnaires souffrent et constatent leur impuissance, disponible surhttps://reporterre.net/Au-ministere-de-l-Ecologie-les-fonctionnaires-souffrent-et-constatent-leur-impuissance
[17] Paul P, 2021, Déserter L’ingénierie, https://ingenieurs-engages.org/2021/04/deserter-lingenierie/
[18] Sur l’origine de ce terme : https://journals.openedition.org/sociologie/3075. Voir aussi Socialter N° 46, juin 2021, Les cadres se rebiffent.