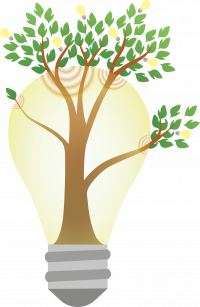Entretien avec Maxime Roul, en alternance à la Banque de France dans le pôle gouvernance stratégie et pilotage du Système d’Information
Cet article s’insère dans une série de témoignages en marge des articles « Changer le système de l’intérieur”. Ils ont pour but de donner la parole à des ingénieur·es qui ont des postes qui leur donnent une marge de manœuvre pour accomplir un changement.
“On prend tout le temps des décisions à partir d’indicateurs financiers. On peut pas avoir une bonne action en faisant comme ça.”
De l’informatique à la finance
NB : Bonjour Maxime, peux-tu commencer par me parler de ton parcours ?
MR : J’ai fait 5 ans en école d’ingénieur, avec classe prépa intégrée, axée sur les domaines de l’informatique et des mathématiques. C’était très général au début, et sur la fin, je me suis spécialisé en analyse de données, big data, etc. J’ai fait mon stage chez Enercoop, dans les énergies renouvelables. Je faisais pour eux de la prévision de la production hydraulique et éolienne à moyen terme. Aujourd’hui, je suis dans le domaine des systèmes d’information, parce que c’est ma formation, mais je veux m’en détacher pour aller vers la finance et l’économie. J’ai envie de comprendre comment le système fonctionne dans les sphères financières pour trouver des leviers d’action. En ce moment, je finalise mes études par une alternance à la banque de France, qui est un acteur économique assez fort.
NB : Comment s’est faite ta prise de conscience ?
MR : Ma prise de conscience, c’était pendant les études, mais pas grâce aux cours. J’ai notamment vu des vidéos sur internet parlant de l’effondrement. Aujourd’hui, c’est cette prise de conscience que je veux amener dans un projet d’entreprise : construire des projets pédagogiques de transition dans les cursus avec notamment des fresques du climat en introduction. De plus, j’ai des grands-parents qui sont agriculteurs et assez proches de la nature, ça favorise le fait de vouloir comprendre les choses. Je fais aussi partie du Bureau National des Étudiants Ingénieurs, et en ce moment sur notre événement annuel, on travaille sur l’éthique de l’ingénieur.
NB : Et l’alternance, pourquoi ce choix ?
MR : L’alternance, c’était d’abord un choix financier mais je trouve aussi que la préparation au monde professionnel est très bénéfique : on apprend en école, puis on va dans l’entreprise appliquer ces savoirs. Mon statut d’alternant me donne la possibilité d’être au cœur des nouvelles techno : big data, blockchain, on fait appel à moi assez facilement sur ces sujets-là. Mais c’est parfois difficile aussi vis-à-vis de mon service d’être au clair sur ma contribution. Comme je ne suis pas là une semaine sur deux, on me donne surtout des sujets ponctuels, et c’est pas toujours simple de participer aux réunions.
NB : Est-ce que ton poste est initialement fait pour un ingénieur ? D’ailleurs, quel avantage y a-t-il à être ingénieur pour le faire ?
MR : Oui totalement. Ça demande une autonomie énorme. Il faut voir quelles sont les évolutions possibles, voir quelles sont les stratégies cohérentes pour la Banque de France. Ça demande pas mal de recherches et d’analyse de données pour synthétiser ce qui existe, pour ensuite le faire remonter à la direction générale.
Changer les indicateurs pour changer les règles
“Si on oblige les entreprises à indiquer ce qu’elles consomment, ce qu’elles émettent, c’est un premier pas pour avoir de l’information et faire de la transformation”
NB : Comment ce poste te permet-il de changer le système ?
MR : Dans les grandes entreprises, c’est très difficile de faire changer les choses. On a tous un poste microscopique. On est 10 000 à la banque et 2 000 à la DGSI[1]. Ma fiche de poste n’était déjà pas très claire, il y avait des pistes qui étaient proposées au début de l’alternance. Quand je suis arrivé, on m’a proposé cinq missions et on m’a demandé sur quoi je voulais bosser. Mon service est très particulier, c’est un service très libre : j’avais une marge de manœuvre sur le choix des sujets sur lesquels travailler. Finalement, j’ai travaillé sur deux sujets : le premier, c’était la stratégie fournisseurs externes. On a fait une série de recommandations dont quelques-unes assez engagées, par exemple pour pousser les projets européens à lutter contre les GAFAM[2]. L’idée, c’est d’avoir des outils techniques et informatiques qui permettent d’assurer la souveraineté numérique à la France. Les projets qui concurrencent les GAFAM sont encore à l’état d’embryon, mais si des entités comme la Banque de France les poussent, ça pourrait marcher ! On émet quelques recommandations sur les indicateurs financiers des stratégies d’investissements. Après, au niveau de l’impact, on ne le connaît pas : ça dépend de qui verra notre travail. Aujourd’hui, je travaille sur un tableau de bord de la sobriété numérique. Je vais utiliser les indicateurs qu’on a, et essayer de les traduire en consommation d’eau, d’énergie, de métaux… pour faire des recommandations.
NB : Et est-ce que tu as vraiment une bonne marge de manœuvre pour créer ces indicateurs ?
MR : Honnêtement, oui. De là à ce qu’ils soient utilisés, je ne sais pas. J’ai la possibilité de le mettre en place, mais les données présentes sur internet ne sont pas géniales, il y a encore pas mal de travail à faire.
NB : Quel intérêt y a-t-il à agir dans une banque ?
MR : Je trouve que la BCE et la Banque de France peuvent vraiment être des moteurs des actions de transformation de la finance. Elles cotent les entreprises, leur donnent une note, et maintenant, elles intègrent aussi dans ces notes les problématiques environnementales. Sur le plan de relance, ces institutions guident les investissements. Leur principales actions, c’est de la régulation : elles établissent des normes. Si on oblige les entreprises à indiquer ce qu’elles consomment, ce qu’elles émettent, c’est un premier pas pour avoir de l’information et faire de la transformation. D’après moi, c’est l’information, et les taxes sur cette information, qui permettront de changer le système. C’est comme ça qu’on pourra avoir de nouveaux projets cohérents, parce qu’aujourd’hui, il y a un manque d’argent dans les dynamiques écologiques qui est problématique…
NB : Finalement, quelles sont les conditions pour que le changement puisse avoir lieu ?
MR : Déjà, c’est la mesure : il faut mesurer ce qui se fait, avec de vrais indicateurs pas seulement financiers. Dans mon service, au moins 75 % de nos indicateurs sont financiers, ce qui est un vrai problème. On prend tout le temps des décisions à partir d’indicateurs financiers. On ne peut pas avoir une bonne action en faisant comme ça. Je citerai un exemple de la supply chain dont j’ai eu écho récemment : on optimise les bateaux de transport en les surchargeant, et en cas de problème on jette les containers à l’eau. Là-dessus, on regarde si c’est rentable. On ne prend les décisions que sur la rentabilité. Amener de nouveaux indicateurs, c’est vraiment la base pour changer ce mode de fonctionnement.
Après, il faut pouvoir agir par rapport à ces indicateurs. Dans mes recherches, j’ai identifié deux actions. Premièrement, on peut transformer les modes de fonctionnement par des contraintes. Par exemple, vis-à-vis de la sobriété, on peut imposer de ne pas dépasser plus de 10 Go de stockage, pas plus de 10 applications, fixer un nombre maximal d’impressions… Ça peut aussi passer par la structure : donner une limite de bande passante pour pousser à optimiser les codes. Et il y a aussi l’aspect usage, c’est-à-dire faire en sorte que les gens connaissent les problématiques, et sachent comment et pourquoi changer leur comportement. Avec mon service, on amenait de nouvelles solutions tout le temps, mais on ne disait pas aux gens comment s’en servir. Et dans le monde du numérique, on sait qu’il y a un effet rebond énorme, parce qu’on ne forme pas les gens.
“On a des injonctions contradictoires : on veut la sobriété numérique, mais on leur dit aussi d’innover, avec des technologies plus polluantes”
NB : Est-ce que tu as rencontré des freins ?
MR : Pas vis-à-vis de mon service, étonnamment. Je me disais “ils vont pas trop vouloir” mais en fait, si. La sobriété numérique, ça fait partie de la stratégie de la Banque de France pour 2024. Donc ça implique d’explorer les actions qui sont en accord avec cette stratégie, j’ai eu la possibilité de le faire. Par contre, il y a un frein intéressant remonté par un de mes collègues : c’est qu’ils ont des injonctions contradictoires. On leur demande de la sobriété numérique, mais on leur dit aussi d’innover, avec des technologies plus polluantes, type cloud, blockchain… La blockchain, c’est le fait de copier de la mémoire sur un grand nombre d’ordinateurs. Ça permet d’être sûr de ne pas perdre l’information, mais on utilise énormément de ressources pour la stocker. Pour l’Intelligence Artificielle aussi, il faut utiliser plein de données en temps réel. Dans toutes ces technologies, il n’y a rien de sobre numériquement. Et on leur demande de faire les deux. Concernant les autres freins, il y a les indicateurs financiers, dont j’ai déjà parlé, mais aussi la mentalité, c’est-à-dire tout ce qui a été mis en place depuis 50 ans, voire plus. Il faut reconstruire la façon de penser des dirigeants.
Être acteur de son métier
NB : Quels conseils donnerais-tu à la nouvelle génération d’ingénieurs qui veut changer le système ?
MR : Je pense que j’aurais du mal à donner le conseil d’aller dans les grandes structures. Les dynamiques pour les entreprises passent par l’extérieur, notamment les cabinets de conseil en transition. Un certain nombre de cabinets de conseil viennent dans les entreprises. Ils sont beaucoup plus efficaces que lorsqu’elles travaillent sur les aspects environnementaux en interne : ils ne partent pas de zéro. Quand un cabinet externe a ses propres outils, ça a un côté plus efficace. Je ne conseillerais pas aux ingés de rentrer dans les grands groupes, mais plutôt de créer leur propre boîte, ou d’aller dans des petites structures qui ont cette liberté beaucoup plus grande, pour ne pas être contraints par la structure. Je pense qu’on valorise vraiment en entreprise le fait d’être proactif, de mettre en avant des solutions. Quand on amène les solutions, les gens nous suivent. J’ai toujours été acteur de mes études, j’ai décidé de ce que je faisais. Je pense qu’il faut aussi être acteur de son métier en entreprise : proposer directement les solutions, ne pas simplement se contenter de ce qui existe. On a des profils très recherchés. Il faut jouer là-dessus : on a des compétences intéressantes, pour ce qu’on veut en faire. On est vraiment capables de construire des choses nouvelles, d’avoir de bonnes idées.
NB : Existe-t-il des leviers particuliers au sein du secteur informatique ?
MR : Le secteur informatique, c’est celui qui recrute le plus. Dans notre école, il y a 100 % d’ingénieurs embauchés à la sortie. Il y a une marge de manœuvre énorme du fait qu’on est une ressource rare : on est capable d’imposer ses conditions. Les conditions de travail sont souvent aménagées pour nous, on a tout un réseau, des chasseurs de têtes, des “hapiness business manager”… Ça montre bien qu’on est capable d’imposer des conditions de travail. Pour des projets écologiques, on sera capable de pousser pour développer des projets qui ont du sens.
NB : Et au sein de la banque ?
MR : La banque a des choses à faire, et je pense qu’elle s’en préoccupe. Ça l’impacte directement qu’il y ait des problèmes économiques. Je pense que c’est le secteur, avec celui des assurances, qui a le plus d’argent à mettre dedans. Avec les impacts du changement climatique, ça peut leur faire perdre beaucoup d’argent. Ça peut être le secteur leader sur l’information : elles y mettent beaucoup d’énergie en ce moment. Les banques sont toujours les banques : on ne peut pas créer une banque comme ça : mieux vaut essayer de les sensibiliser, leur faire changer de direction.
NB : Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ?
MR : Un élément important, c’est la comptabilité carbone. C’est un outil qui est aujourd’hui demandé aux entreprises [3], et elles sont taxées à hauteur de 20 000 € si elles ne le font pas – ce qui est malheureusement dérisoire. Dans cette comptabilité, le scope 1 correspond aux émissions directes de l’entreprise (consommation électrique, outils, réseau de chaleur…). Le scope 2, c’est la prestation des prestataires énergétiques externes. Le scope 3 est le plus intéressant, mais on ne le calcule pas souvent. Il englobe les fournisseurs extérieurs, et tout ce qui gravite autour des entreprises. C’est important de généraliser cette mesure, ça permet de comprendre l’impact de l’activité sur le reste de l’écosystème de l’entreprise. Si toutes les entreprises réalisaient leur bilan carbone en prenant en compte le scope 3, on pourrait voir comment les changements menés par les entreprises impactent toutes les autres, et quels sont les vrais leviers pour changer le système.
****
Propos recueillis et retranscrits par Nicolas B dans le cadre du projet Livre d’Ingénieur·es Engagé·es
Merci à Maxime pour ses réponses, et merci aux relecteur·ices attentif·ves du projet Livre.
Notes :
[1] Direction générale des services d’information
[2] GAFAM : désigne les grosses multinationales du numérique qui ont une position dominante sur internet : Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.
[3] Depuis le Grenelle de l’Environnement de 2007, les entreprises de plus de 500 salariés ont l’obligation légale de réaliser un bilan de leur émissions de gaz à effet de serre (BEGES) de scope 1 et 2. Le Bilan Carbone est un nom déposé par l’Association Bilan Carbone pour une des méthodes de calcul de ce BEGES. Plus d’informations sur le site dédié de l’ADEME : https://www.bilans-ges.ademe.fr/
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.