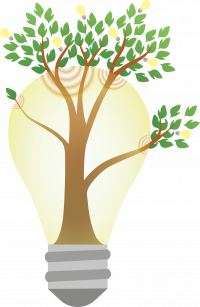Ingénieur·e engagé·e en entreprise – approche stratégique d’une posture dissonante
Cet article fait partie d’une série traitant sur les leviers d’action de l’ingénieur·e au sein du système, dont les réflexions ont été initiées lors du café-débat ayant eu lieu sur le Discord Ingénieurs Engagés le 09/04/2020.
Article 2 : Ingénieur·e engagé·e en entreprise – approche stratégique d’une posture dissonante
Article 3 : Ingénieur·e engagé·e en entreprise : quelle marge de manœuvre pour agir ?
Article 4 : Sortir de la voie royale
Auteur : Nicolas B
Relecture : Groupe Montrer les Possibles
Introduction
Nous avions vu dans notre premier article qu’il est difficile, voire impossible d’intégrer le monde de l’entreprise sans une part de greenwashing, que le poste soit dans un secteur “éthique” ou non. Cela signifie donc que, selon les sensibilités propres à chacun, la majorité des emplois classiques d’ingénieur·es peuvent être critiqués. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’aucun compromis ne soit possible. Notons que l’incompatibilité entre les engagements des individus et les postes en entreprises est largement subjective, et qu’il existe des situations ou le statu quo (c’est à dire pour l’ingénieur·e, l’emploi salarié en entreprise) ne représente pas une dissonance fondamentale.
Il est vrai que certain·es pourront trouver une place (temporairement ou définitivement) au sein de ce système, en accord avec leurs valeurs. Dans cet article, nous nous intéressons aussi à ceux et celles qui ne croient pas qu’une telle place puisse exister, l’idée sous-jacente est qu’il peut exister des raisons d’intégrer les entreprises même si l’on ne se reconnaît pas dans leurs valeurs. Car, admettons-le, c’est bien dans l’entreprise que l’ingénieur·e sera le plus confortable, si bien qu’il semble parfois ne pas y avoir d’autres voies possibles. Comment alors accepter de faire des compromis avec un monde qui semble opposé à ce que l’on défend ? Avant de comprendre de quelle nature peuvent être ces compromis, il convient de mieux comprendre quelle est leur place dans le monde économique. Quelle est la posture par défaut de l’ingénieur·e, sur laquelle il.elle pourra s’appuyer pour déformer son monde de l’intérieur ? Et comment parvenir à garder le cap au sein de cet univers avec des valeurs qui lui sont contraires ?
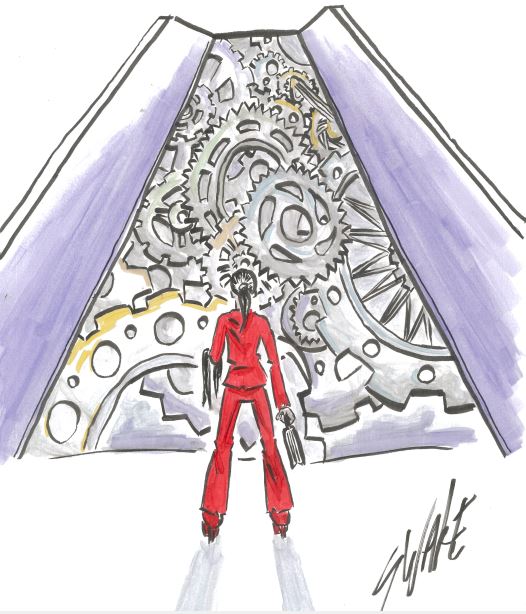
Note sur la portée de l’analyse
Il nous faut à ce stade expliciter la posture prise dans la suite de cette série d’article.
Il est intéressant dans l’absolu de s’intéresser aux nombreuses voies dont dispose l’ingénieur·e pour trouver du sens dans son activité. Néanmoins, nous souhaitons investiguer un type bien particulier d’action, celle qui vise, comme l’indique le titre de cette série, à changer le système de l’intérieur. Voici pourquoi nous exclurons de cette discussion les deux types de démarches suivantes, tout en reconnaissant qu’elles puissent également être une voie d’engagement :
- La démarche de fuir l’entreprise et rester indemne après une brutale perte de sens. Nous voulons plutôt explorer la marge de manœuvre dont dispose l’ingénieur·e engagé·e au sein du système dominant. Cela inclut la démarche de fuir l’ingénierie, en se reconvertissant par exemple dans un emploi non ingénieur. Car si ces métiers peuvent être épanouissants, ils ne mettent pas toujours à profit l’expertise technique et les compétences développées lors d’une formation d’ingénieur, ce qui en un certain sens pourrait être considéré comme du gâchis, au vu de l’urgence et de l’importance des enjeux (et également du coût que représente la formation d’ingénieur·e pour la société).
- La manière de trouver une place satisfaisante dans l’entreprise. Nous n’aviserons pas sur la démarche générale de chercher les emplois d’ingénieur·es “vertueux”. Cette démarche n’est bien sûr pas sans intérêt : certains pourraient réellement s’épanouir dans leur métier, y compris avec de fortes valeurs. Néanmoins, elle oublie une dimension fondamentale de l’ambition que l’on s’est donnée à l’origine : comment changer le système. Les emplois actuels dans l’entreprise (et nous reviendrons, dans un article ultérieur de cette série sur les emplois hors de l’entreprise) n’ont a priori pas pour vocation de changer le système. Ils font partie du système.
En d’autres termes, nous explorons dans cet article et le suivant en quoi l’ingénieur·e pourrait réellement se servir de sa position au sein de l’entreprise pour agir sur les problèmes, ce même s’il ne croit pas fondamentalement que le secteur privé puisse apporter des solutions aux problèmes environnementaux.
Ce qu’est un·e ingénieur·e
Pour bien comprendre la marge de manœuvre qu’offre la position d’ingénieur·e au sein du système, il est important de commencer par bien comprendre ce qu’est un·e ingénieur·e. Si ce métier correspond avant tout à une place privilégiée dans les organisations, il bénéficie d’une légitimité paradoxale que nous souhaitons décrire.
Un statut social valorisant
L’ingénieur·e en entreprise est placé sur un piédestal au sein de la société [1] [2]. C’est un poste qui offre à la fois une légitimité mais également un réseau social qui ne serait accessible nulle part ailleurs. Bien qu’une part de ce réseau se construise dès l’école, ce sera principalement par la “consommation” de son diplôme d’ingénieur qu’il sera possible de l’exploiter à son plein potentiel. La simple mention de son poste et de son école lui donne souvent la légitimité nécessaire pour entrer en contact avec ses pairs (même école, même métier… ou non) [3].
L’entreprise est également vecteur de crédibilité. Glorifiées au sein du système économique, les grandes entreprises sont de réelles nations au delà des États, et ouvrent à leurs employé·es un réseau international. Elles s’impliquent d’ailleurs beaucoup dans les formations d’ingénieur·es, siégeant dans les conseils d’administration et s’insérant au sein des enseignements et des projets étudiants. Nous pouvons retrouver par exemple ce syndrome d’ingérence dans l’intérêt que porte en ce moment l’entreprise Total pour l’école Polytechnique [4].
Une position paradoxale
Malgré ce statut social valorisant, l’ingénieur·e est à une position intermédiaire et paradoxale au sein de l’entreprise. Il·elle génère souvent des sentiments contradictoires : apprécié·e de sa hiérarchie, et méprisé·e par ses subordonné·es (bien que la situation soit loin d’être toujours aussi caricaturale, et nous nuançons celle-ci en fin de partie).
Domination de classe
Très souvent issu·e des classes favorisées, il ou elle a effectué des études longues, permises notamment par le capital culturel, social et financier transmis par sa famille. Il existe bien entendu des personnes qui ont bénéficié de l’ascenseur social, mais les chiffres dans les écoles et les entreprises montrent que cette population est minoritaire [5]. Quoiqu’il en soit, ces transfuges de classe sont passé·es par le même cursus de formation, les rendant malléables et perméables aux intérêts du monde économique. Cette caractéristique fait de l’ingénieur·e un·e représentant·e de “l’élite” de la société, c’est à dire la classe dominante. À ce titre, ils·elles partagent les codes, le langage et la culture des grand·es chef·fes, et peuvent même être amenés à le devenir. Cette proximité intellectuelle et sociale les rapproche naturellement de la hiérarchie, autant qu’elle les éloigne des ouvrier·es et technicien·nes.
Il ne faut pas ici tomber dans une vision manichéenne de l’entreprise avec les “mauvais·es” dirigeant·es d’un côté et les “bon·nes” ouvrier·es et technicien·nes de l’autre. Les adjectifs de dominant·es pour les premier·es et dominé·es pour les second·es sont plus neutres et plus proches de la réalité. Les rapports asymétriques découlant de l’organisation pyramidale sont intrinsèquement à même de générer des frustrations et des tensions. D’ailleurs, si l’ingénieur·e est plutôt considéré comme faisant partie des dominant·es, il ne faut pas négliger la diversité des formes de domination existantes. Leur marge de manœuvre est souvent très faible face au poids de l’institution et de leur propre hiérarchie. Diaboliser les “mauvais·es” ingénieur·es qui jouent le jeu des “patron·nes” revient à nier l’ensemble de contraintes et jeux de pouvoirs au sein des organisations. Dit autrement, si dans les fait les ingénieur·es servent les intérêts des dominant·es, ils ne sont souvent qu’un pion sur l’échiquier (et n’en n’ont parfois même pas conscience) [6].
La légitimité scientifique
L’ingénieur·e est, de plus, un cadre de l’entreprise qui possède la légitimité de la maîtrise des sciences “dures”, ce qui le différencie fondamentalement des autres cadres issus de formations de commerce ou de sciences politiques. La sacralisation de la science et du progrès technique au sein de nos société font de l’ingénieur·e, dépositaire de ce savoir, une pièce maîtresse de l’organisation. Il·elle est en effet souvent l’un des seuls maillons de la chaîne hiérarchique à comprendre les phénomènes physiques et la technique des processus à l’œuvre dans la réalité des métiers des ouvrier·es et technicien·nes. Son rôle est souvent de vulgariser cette connaissance afin de permettre à ses supérieur·es de rationaliser l’activité de l’entreprise, ces dernier·es leur faisant généralement une confiance absolue sur ces sujets, lorsqu’ils·elles ne les maîtrisent pas elles·eux mêmes. Cette légitimité technique reste à double tranchant, car s’il·elle souhaite se prononcer sur des problématiques dépassant son domaine technique ou sa mission dans l’entreprise, il peut lui être rappelé qu’il ou elle dépasse son domaine de compétences.
Inversement, la formation très théorique des ingénieur·es les éloigne souvent de la pratique technique, celle du terrain et des personnes qu’ils·elles encadrent. Les jeunes ingénieur·es intégrant le monde de l’entreprise souffrent régulièrement du syndrome de l’imposteur·e [7], en particulier lorsque leurs missions consistent à diriger des équipes de technicien·nes expert·es dans leur domaine d’activité. Les ingénieur·es sont ceux qui savent, mais rarement ceux qui savent faire [8]. Si cette compétence technique peut s’acquérir au fil du temps et de la curiosité des individus, elle n’est absolument pas indispensable pour permettre à l’ingénieur·e de “s’élever” dans sa structure. C’est même plutôt l’inverse : plus un métier est proche du terrain, moins il offre de perspectives d’évolution. Cette “incompétence” technique latente n’est pas ignorée des personnes qui ont voué leur carrière à la technique, suivi des formations poussées, mais ne dépasseront que rarement le “plafond de verre” des postes techniciens supérieurs [9]. Cette dimension est également source de mépris de la part des agents de terrain [10]. Mais ce n’est pas la seule non plus, car d’autres dimensions les rendent indispensables au sein des entreprises, et oppose encore plus clairement leurs intérêts à ceux des échelons inférieurs.
La gouvernance des chiffres
Historiquement et socialement, l’ingénieur·e orchestre la “rationalisation” du travail, c’est à dire son “organisation scientifique”, héritée du Taylorisme et du Fordisme [11]. Au delà de sa capacité à comprendre la science, c’est celle de manipuler les chiffres qui intéresse les managers. Dans un monde ou tout à un coût, savoir quantifier, c’est savoir déterminer les postes de dépense et de recette. Les ingénieur·es sont ainsi aux premières loges pour se prononcer sur l’organisation des entreprises, d’un point de vue comptable, mais également sur tout ce qui touche au rationnel qu’ils·elles incarnent par leur esprit scientifique : l’opérationnel, l’organisationnel, voire le stratégique. Ils·Elles se font donc volontiers les allié·es, consciemment ou non, des innombrables plans de réorganisation et restructuration des entreprises, modifiant sans cesse l’environnement de travail, chose qui est souvent source d’un profond malaise de la part des personnes dont l’activité se retrouve impactée [12] [13]. Cette tyrannie du changement permanent, exercée de manière consciente ou non, attise la haine envers les architectes de ces politiques, les ingénieur·es-managers en première ligne.
Le “travailleur de confiance” [14]
Pour synthétiser les observations que nous avons faites, nous pouvons donc discerner que l’ingénieur·e a deux caractéristiques générales : il·elle sert la science, et les intérêts des entreprises (parfois aux dépens de ceux des salarié·es). Ce sont deux piliers de légitimité : la science est reconnue de tous·es, et l’entreprise est la pierre angulaire du monde économique. Mais la science est également celle qui rationalise et réduit l’autonomie des salarié·es, qui s’effacent devant la nécessité de profit de l’entreprise. Il est donc à plusieurs égards un salarié à qui l’entreprise doit faire confiance : confiance dans son expertise technique, confiance dans l’application des directives managériales. C’est sur cette confiance, et donc cette légitimité, que repose une grande partie du pouvoir politique des ingénieurs. Mais ceux·celles-ci sont en réalité très peu politisés, et s’il existe des syndicats auxquels ils adhèrent, les individus ne portent pas de luttes transversales, n’agissant pas réellement comme un corps unifié (comme l’a pu être le corps ouvrier au cours des grandes luttes sociales).
Cette position intermédiaire de l’ingénieur·e, cadre et technicien·ne, dominant·e et dominé·e, sachant·e et ignorant·e, lui offre un large éventail de possibilités s’il·elle a conscience de son potentiel et ses limites. Notons cependant qu’en tant que partie prenante active du système capitaliste, cette place pourra également être, au contraire, un élément de décrédibilisation. Les plus désabusé·es par les dérives de ce système ne seront jamais prêt·es à accorder la moindre confiance à des ingénieur·es, peu importe les valeurs qu’ils·elles énoncent.
Un peu de nuance : la diversité des profils et des organisations
Notons que ces constats généraux dépendent nécessairement des secteurs, et des entreprises et qu’il est nécessaire de les nuancer un peu. Certain·es ingénieur·es peuvent être très compétent·es techniquement, et / ou bien s’entendre avec leurs équipes, voire les défendre contre des directives plus haut placées. Certain·es n’encadrent même pas du tout d’équipe, comme c’est souvent le cas dans des entreprises essentiellement composées de cadres telles que les bureaux d’étude [15]. Des études sociologiques rigoureuses sur la “classe” des ingénieurs existent, et tendent d’ailleurs à montrer que l’existence même d’une telle “classe” peut être discutée, tant les profils sont différents [16].
Il existe également des modèles d’entreprise qui, par construction, cherchent à s’extraire des logiques gouvernant les entreprises classiques. Les statuts SCOP et SCIC ouvrent notamment d’autres rapports à la gestion et à la production des entreprises, et leur permet de ne pas nécessairement reproduire les mécaniques de domination que nous avons décrit ci-dessus. Ces réflexions sur les entreprises “éthiques” ne seront pas plus développées dans cette série car elle sont malheureusement des débouchés encore marginaux pour les ingénieur·es, mais nous pourrons y revenir en détail dans des articles ultérieurs.
Entrée et (sur)vie dans l’entreprise
Si la perte de sens survient avant d’intégrer le monde de l’entreprise, cette étape peut être critique et cruciale. Comme nous l’avons vu, il est également caricatural de parler d’une “entreprise” universelle, et notre discours pourra toujours être nuancé, avec des exemples contradictoires. Néanmoins, c’est un milieu qui présente une homogénéité suffisante pour que cela vaille la peine de s’y attarder. Nos remarques portent sur les entreprises les plus ancrées dans le système productiviste et mondialisé, notamment les multinationales, friandes de jeunes ingénieur·e en sortie d’étude.
Entrer dans le moule
Penser que l’on va tout changer en intégrant une entreprise est une erreur, d’autant plus marquée que la structure est grande et complexe. Les règles et procédures qu’il faut y respecter sont en effet décidées très loin des personnes qui effectuent les tâches. Les conséquences du moindre changement impactent des dizaines, centaines, voire milliers de personnes. Chaque action est codifiée, et doit être justifiée devant une hiérarchie (qui, elle-même, se justifie devant la sienne). Ces États dans l’État ont leurs propres lois, leur propre administration, leurs propres moyens de contrôle et de coercition… et au final une terrible inertie (bien que ce constat puisse être particulièrement nuancé dans les entreprises plus petites ou plus ouvertes à la participation des employé·es).
Les jeunes ingénieur·es commencent donc souvent leur carrière en utilisant ce qu’ils considèrent être leur meilleure qualité : l’adaptation [17]. S’adapter à la structure, aux contraintes légales et organisationnelles, entrer dans la réalité du monde de l’entreprise peut alors paraître naturel pour de jeunes esprits désireux de se forger réputation et expérience. L’adaptabilité est d’ailleurs forgée au cours de la formation par la nécessité d’apprendre les codes de l’école, de maîtriser un nouvel environnement, de partir à l’étranger, en stage dans diverses structures… Ce nouvel apprentissage est donc d’une facilité déconcertante par rapport aux études (classes préparatoires, examens, sélection…) par lesquelles ils·elles sont passé·es. S’adapter à l’entreprise, ce sera donc assimiler ces nouvelles procédures, les nouveaux codes sociaux, les nouvelles règles explicites ou implicites, les nouveaux objectifs, les nouvelles normes et échelles de valeur. C’est en faisant la preuve qu’ils·elles savent s’y adapter qu’elles·ils pourront gagner leur légitimité et devenir de vrais ingénieur·es et devenir des travailleur·ses de confiance.
Gagner la confiance
Nous l’avons vu, c’est sur cette confiance de l’entreprise que repose la légitimité et le pouvoir d’un·e ingénieur·e. La position qui leur donne leur marge de manœuvre doit donc être construite patiemment, ce qui revient à bâtir ce lien de confiance avec les acteurs internes. Gagner cette confiance signifie, dans un premier temps au moins, avoir une ligne de conduite compatible avec les codes de l’entreprise et avec ses objectifs. Le monde économique nous propose un terme franglais pour désigner cette posture d’allié proactif : être un bon ingénieur, c’est notamment être corporate. Sa mission réelle va au delà de sa simple fiche de poste, il s’agit de défendre les couleurs de son entreprise-nation, et de faire prévaloir ses intérêts sur tous les intérêts concurrents (que ce soient les autres entreprises ou les politiques publiques). Prouver à l’entreprise que l’on a intégré ses intérêts et qu’on les défend par nos actions, prouver que l’on est fidèle et dévoué, jouer le jeu de la communication d’entreprise en y participation, voici des actions qui prouvent la bonne volonté… Mais qui peuvent aussi mettre profondément mal à l’aise la personne qui ne s’y reconnait pas.
Dans ce contexte, on peut facilement se retrouver en forte dissonance cognitive, car nous l’avons vu, les objectifs de l’entreprise sont souvent opposés aux objectifs écologiques et sociaux. C’est un jeu qui peut être difficile à jouer, et qui peut même demander une sévère dose d’hypocrisie, pour peu que l’on soit prêt·e à la supporter. Difficile de rester l’élève modèle lorsque l’on doute du professeur. S’il reste possible d’y échapper, du moins en partie (il n’est pas nécessaire d’être un modèle corporate pour exercer son métier), c’est un levier fondamental de la confiance que l’on pourra obtenir, et donc de la marge de manœuvre que l’on pourra s’offrir.
Au delà de la confiance de la hiérarchie et de l’organisation, il ne faut pas négliger d’obtenir la confiance, humaine, de ses collègues, quel que soit leur « rang ». Car l’entreprise héberge également des personnes engagées, touchées par les mêmes problématiques que soi, qui gardent leurs convictions en sous-mains pour les exprimer quand elles sont « en dehors » du travail et du discours corporate de façade. Ces allié·es sont précieux·ses au sein du monde du travail, à la fois pour obtenir du soutien et du réconfort, mais également pour réfléchir à des stratégies collectives.
Garder ses valeurs
Voler en éclat où être assimilé·e : voilà deux dangers extrêmes que l’ingénieur·e engagé·e devra affronter en se frottant à l’entreprise
Gagner sa légitimité en tant qu’ingénieur·e nécessite donc d’assumer sa position dominante au sein de l’entreprise, et permet d’obtenir une crédibilité dans les cercles de pouvoir. Mais peut-on réellement atteindre une telle place, un tel niveau de reconnaissance de la part des puissant·es, tout en gardant personnellement ses valeurs ?
En effet, intégrer un milieu économique dont le sens est globalement opposé aux valeurs environnementales et sociales qui animent les personnes engagées peut être réellement éprouvant. Conserver ces valeurs dans un monde dont la rentabilité est la raison d’être demande beaucoup d’énergie, et donne l’impression de progresser sans cesse en terrain miné. De quoi peut-on parler à sa hiérarchie ? À ses collègues ? Qu’a-t-on le droit ou non de dire afin de garder un minimum d’influence au sein de notre structure ? De plus, plus l’on obtient un poste haut placé dans le système actuel, moins on risque de cautionner et d’assumer les actions que l’on devra effectuer. Combattre et faire les choses que l’on combat peut amener une forte dissonance cognitive difficile à supporter. Bien qu’il soit possible de trouver du support grâce à un réseau, il semble peu attrayant d’être payé pour un métier que l’on ne souhaite pas faire. C’est d’ailleurs pour cela que les ingénieur·es engagé·es sont très vulnérables aux dépressions professionnelles (burn out etc. Voir ci-après). Il faut également apprendre à se satisfaire des petits pas et d’accepter les objectifs de durabilité faible, tout en conservant ses idées radicales dans la durée. Cela est d’autant plus difficile que l’on sera, au fil des années, menacés par l’érosion de son engagement.
L’entreprise (et parfois même le cercle de proche) peuvent être des milieux hostiles pour ces idéaux, les rappelant sans cesse à leur propre réalité (relative) [18]. Car lorsque l’intégralité de son monde exerce des pressions contraires, notre notion de la normalité et notre référence de radicalité peuvent glisser vers une ambition bien inférieure à notre motivation initiale. Pour cultiver sa détermination à agir, il est important de pouvoir continuer à discuter et débattre sur les enjeux de société avec des personnes engagées, motivées et impliquées dans ces luttes. Si l’existence d’un tel support et réseau se veut être un objectif d’Ingénieurs Engagés, il existe, localement et à l’échelle nationale, de nombreux réseaux, associations, groupes de discussions, permettant de garder une proximité intellectuelle, sociale et affective avec des personnes partageant nos valeurs. Seule la force du réseau peut vaincre l’isolement et offrir un support dans des actions qui dépassent celles de notre fiche de poste. Cela n’est pas chose aisée, car en plus de l’érosion des idéaux, nombreux·ses finissent par être pris·es dans l’engrenage de la vie [19] et se surprennent à la résignation. Voler en éclat où être assimilé·e : voilà deux dangers extrêmes que l’ingénieur·e engagé·e devra affronter en se frottant à l’entreprise, faute de parvenir à faire vivre ses valeurs.
Une posture décalée par rapport aux valeurs de l’entreprise
Le monde de l’entreprise offre à l’ingénieur.e une perspective d’emploi stable, pérenne (même si, de moins en moins) et reconnu. C’est la continuité logique de la “voie royale” que suivent les étudiant·es depuis leur orientation au lycée et après le bac au travers des filières scientifiques. C’est donc une position a priori très confortable. Mais une part croissante des ingénieur·es (et notamment de la nouvelle génération) se reconnaissent de moins en moins dans les valeurs de l’entreprise, les conduisant à une perte de sens. Lorsque celle-ci s’installe (que ça soit avant ou après avoir intégré l’entreprise), il devient difficile de faire comme si de rien était.. Nous verrons dans cette partie comment s’adaptent (ou non) les ingénieur·es engagé·es à ce profond décalage.
Choix et non-choix : métiers d’ingénieurs alimentaires (ou comment exploser en vol)
Face à la perte de sens, tout le monde n’a pas nécessairement le luxe de se poser la question de faire ou non partie du monde de l’entreprise. Certain·es n’ont simplement pas les moyens financiers de refuser ces emplois si bien payés, ou sont pris dans d’autres types d’engagements dont ils ne peuvent se libérer (emprunts [21], engagements familiaux…). En plus de cela la voie hors de l’entreprise “traditionnelle” est très étroite, ingrate, inconfortable, eût-elle pour finalité de vivre en accord avec ses valeurs.
C’est pourquoi certain·es optent malgré tout pour un emploi d’ingénieur “alimentaire”, ne croyant ni à leur mission ni aux valeurs de leur entreprise, et tentent de mettre leur conviction en œuvre parallèlement. Si ceci offre un compromis qui semble séduisant pour résoudre la dissonance cognitive, beaucoup s’y brûlent les ailes, car passé un certain seuil il devient impossible de sacrifier sa force de travail à des causes qui semblent inutiles [22].
Burn out, Bore out, Brown out
Le principal risque à mener une vie en opposition avec ses valeurs est “d’exploser en vol”. Si certain·es parviennent, après de nombreuses années, à une reconversion en douceur, la souffrance peut devenir insupportable et avoir des conséquences graves. Les managers et psychologues de l’entreprise reconnaissent généralement trois types de malaise différents que sont le burn out, le bore out et le brown out [23]. Vivre son activité quotidienne en décalage avec ce qui nous semble réellement important expose particulièrement à toutes ces formes de souffrance psychologique.
Le burn out se traduit en français par “syndrome de l’épuisement professionnel”. C’est une belle litote pour masquer la violence des pressions qui peuvent s’exercer sur les emplois de cadre intermédiaire. Si celle-ci ne concerne pas que les ingénieur·es engagé·es, ces dernier·es peuvent subir un burn out d’un genre particulier. Car, insatisfait·es par un travail vide de sens, certain·es seront tentés par s’investir parallèlement dans l’engagement associatif, de manière aussi intense que la perte de sens est profonde. Ce “double emploi” (voire triple, pour certaines femmes portant en plus la charge des tâches ménagères [24]) peut catalyser la descente aux enfers du burn-out.
Le bore out est une forme de burn out qui est non pas dû à l’excès de travail, mais à l’excès d’ennui dans son travail. Celui-ci peut être dû notamment à la prolifération de ce que l’anthropologue David Graeber appelle les Bullshit Jobs [25]. Une sensibilisation accrue aux problème sociétaux peut exacerber cet ennui, avec l’impression de ne pas ou trop peu agir. Le terme de brown out a récemment été proposé pour décrire une certaine forme d’ennui, qui est lié à l’incompatibilité entre les missions que l’on effectue au quotidien et les valeurs morales des salarié·es. Ce type de dépression correspond à la perte de sens poussée à l’extrême, et devient de plus en plus fréquente et médiatisée. Et n’en déplaise aux services des ressources humaines, il ne suffira pas toujours d’une mutation ou d’un entretien professionnel pour combler le vide. La perte de sens se concrétise, par exemple, par la perte complète de motivation, voire la démission de personnels pourtant qualifiés. Ce malaise existentiel mène généralement à des choix brutaux (reconversion, changement de vie…) et parfois incompris [26].
Une approche stratégique
Tirer sur la corde jusqu’à ce que le corps ou l’esprit cède n’est pas une voie désirable. Ceux et celles dont les vies doivent se recomposer suite à ces ruptures passent par de grands moments de souffrance, et quittent parfois complètement l’univers des ingénieur·es. C’est pourquoi nous développons le concept d’approche stratégique. Celle-ci suppose que les valeurs des ingénieur·es engagé·es sont (au moins en partie) incompatibles avec celles de l’entreprise, et que nier cette réalité conduit, tôt ou tard, à une rupture plus ou moins brutale avec ce monde.
Surmonter la dissonance
Dans l’immense majorité des cas, les objectifs des ingénieur·es engagé·es ne seront pas alignés avec ceux de l’entreprise (à moins de trouver une structure réellement éthique, et pas simplement parée d’une solide communication RSE). Cela met ces personnes en porte-à-faux avec le rôle qu’elles sont censées tenir au sein des organisations, supposées défendre la structure et être corporate. Il·Elle portera alors toujours des objectifs plus ou moins dissimulés, et plus ou moins antagonistes à sa structure. Mais afin de garder sa position et les opportunités qu’elle lui offre, il·elle devra également jouer le jeu dans une certaine mesure.
Prenant acte de cette dissonance, il s’agit de réfléchir à un plan d’action personnel prenant cette réalité en compte, et permettant de vivre en cohérence avec ses valeurs et en accord avec ses compétences. Cette stratégie est évolutive, personnelle, et dépend de nos propres sensibilités et contraintes. Elle peut également être concertée et collective, en s’unissant au travers de réseaux. Être stratège ne signifie pas nécessairement avoir une attitude hostile ou hypocrite envers son employeur. Cela revient simplement à considérer que son rôle dans la société dépasse celui qui nous est accordé par notre emploi, et à réfléchir à ce rôle dans la durée plutôt que de le subir au quotidien.
Différentes stratégies
Changer le système de l’intérieur, c’est souhaiter parvenir, à terme, à imposer ses valeurs dans la stratégie de l’organisation voire au delà. Or donner un cadre de durabilité forte aux entreprises est, nous l’avons vu, plus ou moins opposées aux intérêts de l’organisation (c’est à dire le profit). Arriver à un tel résultat nécessite de se poser de réelles questions stratégiques sur comment “infiltrer” des organisations avec des objectifs plus ou moins opposés aux siens, pour faire les faire infléchir. Cette stratégie a d’ailleurs été utilisée par d’autres combats, avec la notion d’entrisme [27] qui pourrait être réemployée dans ce cadre [28].
Il existe dans cette approche deux postures principales et antagonistes : celle de lutter avec, et celle de lutter contre [29]. Lutter avec l’entreprise contre les problèmes sociaux et environnementaux est la posture majoritaire. En effet, accepter de faire partie du monde de l’entreprise revient à en accepter les règles, et dans une certaine mesure, de jouer le jeu. S’il est illusoire de croire que les intérêts de l’organisation et les valeurs personnelles peuvent coïncider totalement, on peut néanmoins trouver une zone de convergence, ou à minima un terrain de concession. En revanche lutter contre l’entreprise en faisant partie de ses membres signifie trahir la loyauté implicite qui lui est due, ce qui est une attitude extrêmement risquée et contraire à une certaine éthique.
Au delà de ces deux mouvances, il existe une autre distinction entre les actions faites au sein de l’entreprise. Celles-ci peuvent faire partie du rôle qui nous est accordé par l’entreprise, ou au contraire faire partie d’une démarche personnelle et volontariste. Agir dans son rôle signifie que l’on va chercher à se servir de l’entreprise pour atteindre ses objectifs (quels qu’ils soient). Mais cela revient également à admettre, dans une certaine mesure, que l’entreprise se sert également de soi. Cette posture correspond ainsi à faire coïncider au mieux les objectif de sa mission avec ses objectifs personnels, guidé·e par ses valeurs. Sortir de la fonction qui nous est proprement attribuée correspond au fait d’utiliser la position d’ingénieur·e comme un gage de légitimité, ou comme potentiel de ressources et d’action. Un pouvoir privilégié confié par ce rang social est par exemple le potentiel d’action qu’il offre.
Conclusion
Faire partie de l’entreprise est la voie de facilité pour les ingénieur·es. Cela représente également un statut social valorisé, et une position de légitimité. Mais cela peut également représenter un défi en soi lorsque les contradictions sociales ou environnementales se font trop fortes. Que la prise de conscience se fasse avant ou après avoir intégré cet univers, il devient nécessaire de réfléchir à un approche stratégique personnelle et à l’attitude que l’on souhaite avoir vis à vis de ces contraintes. Faute d’arriver à mener ses propres objectifs, le risque est important de se briser sur sa perte de sens. Il est également important de rester en contact régulier avec des pairs engagé·es afin de ne pas laisser s’éroder son engagement et être assimilé au monde économique et ses travers.
C’est seulement à ce prix qu’il sera possible d’espérer pouvoir mobiliser la force du rôle politique des ingénieur·es au sein du système, pour le faire changer de l’intérieur. Après cette digression, le prochain article sera dédié à la présentation détaillée du panel d’action possible dans ces différentes postures décrites dans cet article.
****
Cette œuvre (texte et illustration) est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.
Notes et références
[1] Shinn Terry. Des Corps de l’Etat au secteur industriel : genèse de la profession d’ingénieur, 1750-1920. In: Revue française de sociologie, 1978, 19-1. pp. 39-71. DOI : 10.2307/3320953, disponible sur
www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1978_num_19_1_6618.
L’auteur de ce texte retrace la manière dont s’est construit la légitimité des ingénieur, en tant que classe dominante et métier prestigieux
[2] Nous pouvons notons également l’extrême valorisation du métier dans les informations sur l’orientation. Voir par exemple Challenges.fr, 26/06/2014 10 informations à connaître sur les ingénieurs en France, disponible sur https://www.challenges.fr/emploi/10-choses-a-savoir-sur-les-ingenieurs-en-france_17952, ou encore l’article du 03/02/2019 sur le site de l’IMT : 5 raisons de devenir ingénieur, disponible sur : https://alternance.imt.fr/5-raisons-de-devenir-ingenieur/
[3] Pour approfondir le sujet, voir Marie-Pierre Bès, « Les relations entre anciens élèves ingénieurs : réseau personnel ou capital social ? », Socio-logos [Online], 8 | 2013, Online since 02 January 2014, connection on 12 June 2020. URL : http://journals.openedition.org/socio-logos/2787.
Cette étude approfondie des liens tissé dans et hors des écoles montrent à quel point ces réseaux sont importants pour la carrière des ingénieurs et constitue un réel capital social.
[4] Une synthèse de cette polémique sur le site d’Ingénieurs Sans Frontières (ISF): (24/03/2020) Total investit l’école Polytechnique, disponible sur : https://www.isf-france.org/articles/total-investit-lecole-polytechnique
[5] Voir par exemple l’illustration d’Arielle Compeyron Jacques Baille, Emilie Fruchard. (2009), La diversité des élèves ingénieurs de l’INSA Lyon, données et problèmes. ⟨halshs-00787161⟩
[6] Crawford Stephen. Ingénieurs français et déqualification. In: Sociologie du travail, 29ᵉ année n°2, Avril-juin 1987. pp. 199-217. DOI : https://doi.org/10.3406/sotra.1987.2363, disponible sur
www.persee.fr/doc/sotra_0038-0296_1987_num_29_2_2363
Cet article fait une synthèse du débat sur la “déqualification”des métiers d’ingénieurs (thèse qui est, selon cet auteur, démentie dans le cas français) et met en exergue les pressions et contradictions qui peuvent s’exercer sur les postes les moins élevés
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/31653/C&T_1984_12_337.pdf?sequence=1
[7] Voir la description de ce “syndrome” par la presse classique : La Depeche (11/11/2017) Ces jeunes brillants persuadés d’être des imposteurs, disponible sur :
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/11/2682754-ces-jeunes-brillants-persuades-d-etre-des-imposteurs.html
mais également par la presse managériale Equationdecarrière.com (05/04/2020) Ingénieurs, 4 clefs pour dépasser le syndrome de l’imposteur et gagner en bien-être au travail, disponible sur
https://equationdecarriere.com/ingenieurs-4-clefs-pour-depasser-le-syndrome-de-l-imposteur-et-gagner-en-bien-etre-au-travail/
Ces réflexions ont été approfondies au cours d’une thèse universitaire : Kevin Chassangre (2008), La modestie pathologique : pour une meilleure compréhension du syndrome de l’imposteur, Thèse de doctorat, 284p, disponible sur https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01920350/document. Notons qu’aucune de ces analyse ne semble réellement dépasser la psychiatrisation de ce “trouble” : vu comme une “pathologie”, il n’est jamais expliqué par un contexte social et socioprofessionnel.
[8] D’ailleurs, Christelle Didier souligne que, particulièrement dans le cas français, très peu d’ingénieur·es le deviennent par vocation, mais plutôt par “accident”. Voir Didier et Simonnin (2018) “I Became an Engineer by Accident!”: Engineering, Vocation and Professional Values dans Mitcham et al. (2018) Philosophy of Engineering : East and West.
[9] Alain Lemasson, sur le site Capital.fr (14/10/2019) Le système des grandes écoles a créé une multitude de plafonds de verre, disponible sur https://www.capital.fr/entreprises-marches/le-systeme-des-grandes-ecoles-a-cree-une-multitude-de-plafonds-de-verre-1352705
[10] Bouffartigue Paul, Gadéa Charles. Les ingénieurs français. Spécificités nationales et dynamiques récentes d’un groupe professionnel. In: Revue française de sociologie, 1997, 38-2. L’économie du politique. pp. 301-326.DOI : 10.2307/3322935 www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1997_num_38_2_4606. Cette analyse poussée du métier d’ingénieur français met en exergue les différences et rivalités existantes avec le corps des “techniciens”, et les rivalités que cela peut engendrer.
[11] Voir la notion d’Organisation Scientifique du travail, notamment sur Wikipedia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_scientifique_du_travail
[12] Cette pratique managériale poursuit la logique de domination impulsée par les politiques d’organisation scientifique du travail. Voir l’entretien très riche de Danièle Linhart par Nolwenn Weiler, sur Bastamag, (22/03/2018) « La dictature du changement perpétuel est le nouvel instrument de soumission des salariés », disponible sur
https://www.bastamag.net/La-dictature-du-changement-perpetuel-est-le-nouvel-instrument-de-soumission-des
[13] Jean-Luc Metzger, (2012) « Le changement perpétuel au cœur des rapports de domination », SociologieS [Online], Theory and research. Disponible sur http://journals.openedition.org/sociologies/3942
Cet article de sociologie montre comment ces politiques gestionnaires accroissent les rapports de domination et la privation d’autonomie des salarié·es
[14] Terme utilisé dans l’article de Bouffartigue et Gadéa (op. cit.)
[15] La sous-traitance du travail intellectuel ne fait pas disparaître les rapports de force au sein du monde capitaliste, d’une part car ils peuvent exister même au sein de petites structures en apparence homogène, et d’autre part car les calculs effectués en bureau d’étude se retrouveront, un jour ou l’autre, dans le tournevis d’un·e technicien·ne. Ce n’est qu’une délocalisation du rapport de force.
[16] Voir notamment l’étude de Boltanski sur les cadres : Luc Boltanski (1982) Les cadres : la formation d’un groupe social, les Éditions de Minuit, 1982, 523 pp., ISBN2-7078-0617
[17] Si cette remarque relève surtout d’une observation personnelle des discours des jeunes ingénieur·es, on peut noter à quelle point cette qualité est appréciée par les entreprises. Voir par exemple Docendi.com (18/07/2018) L’adaptabilité professionnelle : soft skill n°1 dans un monde qui change, disponible sur
https://www.docendi.com/blog/adaptabilite-professionnelle-comment-sajuster-monde-qui-change/
[18] « c’est pas le monde des bisounours »… « c’est beau l’utopie mais ça ne fait rien avancer », « On va pas revenir à la bougie » : on peut parier que chaque personne mettant en avant son engagement a déjà entendu ça…
[19] Et surtout du modèles économique et sociétal : crédit, achat immobilier, famille à nourrir…
[20] J’ai choisi de représenter ces deux manières “d’exploser en vol” dans le diagramme de stratégie, même si ce ne sont pas en soi des stratégie. L’idée est qu’elles représentent un coût (congés longue maladie, poids mort, perte de compétence…), qui va à l’encontre des intérêts de l’entreprise.
[21] D’autant plus que les emprunts étudiants pour réaliser des études d’ingénieurs sont indexés sur le salaire attendu en sortie des écoles. Cela implique qu’une prise de conscience et une volonté de se rediriger en cours de route vers des métiers avec plus de sens (mais des salaires faibles) sera d’autant plus pénalisée par la nécessité de rembourser un emprunt lourd.
[22] De nombreux·ses ingénieur·es témoignent de cette désillusion au sein du réseau Ingénieurs Engagagés, par exemple
https://ingenieurs-engages.org/2019/09/le-malaise-du-salariat/
[23] Jeanne Caillier, sur Droit-Travail-Finance.fr (11/03/2019) Burn out, bore out, brown out, savez-vous les différencier ? disponible sur
https://www.droit-travail-france.fr/burn-out–bore-out–brown-out–savez-vous-les-differencier–_ad1584.html
Notons que ces termes sont décrits comme des troubles psychologiques (similairement à ce que nous avions observé, plus haut, sur le syndrome de l’imposteur). C’est à dire que c’est supposément une faiblesse du·de la salarié·e, qui doit donc porter la charge de sa guérison en plus de sa souffrance. Nous reconnaissons dans ce procédé un énorme biais d’attribution, qui focalise uniquement sur les causes internes à la personne et non sur les causes externes (environnement, stress, politiques de l’entreprise…)
[24] Si ces questions vous sont étrangères, vous pouvez vous y sensibiliser avec ce blog très pédagogique : Emma, 09/05/2018, “Fallait demander”, disponible sur
https://emmaclit.com/2017/05/09/repartition-des-taches-hommes-femmes/
[25] David Graeber, 2018, Bullshit Jobs, Les Liens qui Libèrent, 416p.
[26] Marie Tomaszewski, sur Le Bonbon, 19/07/2019 Après le burn out, le brown out touche de plus en plus de jeunes, disponible sur
https://www.lebonbon.fr/paris/societe/le-brown-out-maladie-qui-affecte-les-jeunes/
[27] La notion d’entrisme (ou noyautage) est très colorée politiquement et connotée négativement. Elle désigne initialement les stratégie d’infiltration concertées de la gauche communiste, à partir des années 1930, dans les organisations (parfois diamétralement opposées) et administrations afin d’influencer la ligne stratégique de celles-ci. Sur ce sujet, l’article Wikipedia est bien fait : https://fr.wikipedia.org/wiki/Entrisme
[28] Une différence notable est tout de même que cette stratégie n’est aujourd’hui pas vraiment concertée.
[29] Notons qu’il existerait une troisième position qui serait lutter sans se soucier de l’entreprise. Néanmoins, nous pouvons assimiler ce type de posture à une lutte “avec” qui serait très modérée. Car lutter contre implique un engagement personnel beaucoup plus important.