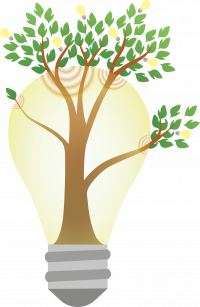Auteurs : Nicolas B, Anthony B
Introduction
Cet article s’interroge sur la capacité de la Low-Tech à constituer un modèle sociétal à la hauteur de ses promesses de convivialité et durabilité. Issu de nombreuses discussions et réflexions avec divers acteurs gravitant autour de cette sphère, il développe le constat de limites plus ou moins contraignantes aux représentations majoritaires de la Low Tech, du bricolage au néo-artisanat. Ce texte a notamment été inspiré par de longues discussions avec Cyrille, spécialiste en métallurgie et promoteur du solaire thermique à concentration, qui porte cette vision de manière marquée et nous offrira quelques éclairages techniques. Il propose l’idée que, pour en faire un projet de société cohérent, il est nécessaire de les compléter avec une montée en puissance – au sens propre – des réalisations. Nous proposons de développer ce point de vue qui semble nécessaire, car certaines limites connues du concept semblent aujourd’hui constituer un réel frein à l’imaginaire d’une société Low-Tech. Cette échelle néo-industrielle semble a priori antinomique avec les valeurs fondamentales du mouvement et nécessite donc une attention particulière. Sans proposer de réponse toute faite à ce paradoxe, nous exposons dans ce texte les raisons pour lesquelles cette troisième voie semble malgré tout indispensable à un projet de société Low-Tech, et constitue donc un fort appel à la réflexion et la mise en pratique.

Visions divergentes – L’individu, le territoire et la société
Genèse d’un imaginaire
L’imaginaire collectif autour des Low-Tech est issu en grande partie des nombreux et précieux tutoriels produits par le Low-Tech Lab[1] et de L’Âge des Low-Tech de Philippe Bihouix, deux piliers de la diffusion du concept en France. Les Low-Tech y sont représentées comme des systèmes simples, peu coûteux, fabriqués à partir de matériaux naturels ou de récupération, et qui permettent de répondre à des besoins de base[2]. À ces technologies pratiques s’ajoute une véritable philosophie qui veut notamment permettre à tout un chacun de reprendre en main la technique, d’apprendre à faire de ses mains un objet qui lui sera utile personnellement ou collectivement[3]. Dans une société occidentale actuelle hyper industrialisée, ces imaginaires représentent en effet une rupture radicale et loin d’être évidente pour tous·tes avec la société du high-tech et de l’obsolescence programmée. Pour de nombreuses raisons cette lutte est nécessaire et désirable, et a paradoxalement été largement investie par le milieu ingénieur, pourtant plutôt habitué·es à faire perdurer l’imaginaire suranné du progrès technologique. Ce phénomène qui est sans doute en grande partie dû à la terminologie usitée – inspirée du monde de la tech – ne doit d’ailleurs pas faire oublier qu’il existe des approches similaires qui n’en portent pas le nom. Par exemple, il existe aussi dans le monde du design un retour à la pratique manuelle et la production créative artisanale, bien que les designers soient en majorité étrangers au concept de Low-Tech[4]. Naturellement, le concept n’est pas resté sans critiques, y compris venant des sphères les plus engagées[5]. La Low-Tech est ainsi souvent jugée irréaliste, trop peu ambitieuse, oubliant une partie des problématiques auxquelles elle pense apporter des réponses… Par ailleurs, plus l’écosystème Low-Tech étend ses racines[6] plus il apparaît paradoxalement complexe de faire connaître et reconnaître cette philosophie dans la société. La sortie prochaine d’un documentaire grand public[7] devrait à ce titre se révéler comme un instant de vérité, capital pour l’avenir de mouvement. Ainsi, riche de ces critiques et au travers de ses pratiques, la Low-Tech témoigne de plusieurs visions qui se trouvent parfois en opposition.
La démocratisation du bricolage
Il existe premièrement une vision DIY – Do It Yourself, ou “bricolage”, dans la langue de Molière – qui séduit beaucoup les bricoleurs et bricoleuses, expérimenté·es ou aspirant à le devenir. Le Low Tech Lab, par ses nombreux tutoriels -de difficulté variée-, a rendu cette vision particulièrement attirante, notamment pour les ingénieur·es en perte de sens et souhaitant se rapprocher d’une pratique manuelle. Elle porte l’imaginaire qui permet à tout un chacun de s’approprier la technique, de reprendre le contrôle sur nos modes de vie, et de gagner en autonomie. Cette vision s’inscrit en quelque sorte dans une l’héritage du mouvement des “makers”[8] et des communautés des fablabs[9] dans leur vision du partage et de l’open source, en y intégrant une forte dimension sociale et écologique. Les objets qui découlent de cette vision sont souvent considérés comme des Low-Tech “pures” devenues les images les plus emblématiques du mouvement : douches solaires, toilettes sèches, machine à laver à pédale… Celles-ci permettent une réelle reprise en main concrète et immédiate d’objets techniques du quotidien, accessible à toutes et tous avec des outils et connaissances de base (dispensées par des tutoriels de difficulté variables ou par des formateurs). Peu chers à réaliser, ces objets peuvent être fabriqués à partir de matériaux de récupération et répondent à des besoins très simples, souvent à l’échelle d’un individu ou d’une petite communauté. Cette démarche de démocratisation de la technique permet donc de réaliser une profonde sensibilisation. Elle fait prendre conscience à la fois de la complexité technique de notre monde – d’ouvrir les ‘boîtes noires’ des objets du quotidien – et la simplicité possible pour répondre à nos besoins – en prouvant par l’expérience qu’il est à la portée de chacun de les réaliser. A l’usage, ce type de Low-Tech est particulièrement pertinent pour des systèmes faciles à entretenir et sans véritable problème de sécurité, comme la marmite norvégienne, ou encore le séchoir solaire. En revanche, il reste difficile de compter sur du tout-bricolage au niveau individuel pour des réalisations plus complexes requérant plus de pratique.
L’émancipation collective sur les territoires
On trouve ainsi, en parallèle de cela, une vision néo-artisanale visant à réaliser des Low-Tech que les utilisateurs n’ont pas directement les moyens de produire eux-mêmes, car elles ont un niveau de technicité et/ou une échelle plus importante. Cette vision propose donc de redimensionner l’appareil productif à petite échelle, pour qu’il soit mieux adapté à la société et aux contraintes de durabilité. Dans ce modèle, ce sont les utilisateur·ices qui restent à l’origine de la conception, en définissant leurs besoins – contrairement aux pratiques du système industriel qui vise à décider à leur place quels devraient être leurs besoins. D’autre part, cette activité néo-artisanale se veut proposer une réponse ancrée dans une échelle locale pour l’adapter au mieux avec les spécificités de son territoire. On pourrait par exemple rattacher les activités de l’Atelier Paysan[10] à ce modèle. Ce collectif vise à outiller les agriculteur·ices avec des techniques les plus simples et sobres possibles, adaptées à leurs usages, pour leur faciliter des pratiques plus écologiques et les rendre indépendants du machinisme du système agro-industriel. Si les agriculteur·ices ne disposent pas des compétences techniques pour produire elle·eux-mêmes ces outils, l’objectif est qu’il·elles puissent les acquérir au bout d’un certain temps d’apprentissage. Cette vision des Low-Tech, dans laquelle différents acteurs se spécialisent dans un certain produit ou service, est beaucoup plus hétéronome que la première. Elle promeut en quelque sorte un retour assez intense de l’artisanat spécialisé pour retisser les liens sociaux qui se sont brisés avec l’uniformisation et l’industrialisation de la société. De cette vision découlent des Low-tech élaborées, qui répondent toujours à des besoins simples, mais qui se situent plutôt à l’échelle des communautés. Elles permettent de mutualiser et optimiser des ressources naturelles, financières et humaines. Ces techniques doivent être robustes, fiables et durables dans le temps. Elles nécessitent pour leur fabrication des moyens plus importants (machine-outils, place de stockage, …) et compétences plus pointues (résistance des matériaux, travail du métal ou du bois, …). Néanmoins, une fois en service, elles peuvent être entretenues et maintenues de manière simple et autonome par des usagers formés, leur permettant malgré tout la réappropriation démocratique de la technique. Ce mode de production est notamment adapté pour produire des équipements collectifs (fours solaires collectifs, micro-éoliennes) à destination de communautés, pouvant alors être considérés comme des biens communs. L’échelle idéale pour cette vision est celle d’un territoire, défini comme un lieu de vie multifonctionnel auquel se sentent rattachés des individus (une plaine, une vallée, une rivière… territoires qui sont plus ou moins bien délimités par les découpages administratifs du territoire national). Un autre exemple de déclinaison à cette échelle est proposé par le projet Glocal Low-Tech, qui s’est proposé d’animer une concertation avec les habitants d’un territoire pour en définir les besoins et concevoir des solutions Low-Tech[11] pour y répondre. On y retrouve ainsi également une forte aspiration de réappropriation démocratique de la technique.
Un échelon global manquant ?
En marge de ces deux approches très majoritaires, il existe une vision néo-industrielle de la Low-Tech qui, propose de développer à une large échelle des filières de productions qui permettent, à terme, de se passer des ressources fossiles sans détruire le vivant. Cette vision se base sur les limites des deux premières à ce que chacun·e puisse vivre un quotidien Low-Tech dans tous ses aspects, et arrive à la conclusion qu’une production de masse est nécessaire dans une certaine mesure. L’objectif d’un tel modèle serait ainsi de produire des Low tech standardisées, tout en parvenant à s’écarter des travers de la standardisation. Le standard correspond ici autant à la diffusion massive souhaitée des Low-Tech dans la société qu’à la constitution de nouvelles normes d’utilisation. En d’autre termes, il s’agit ici de construire de nouveaux codes techniques et sociaux à grande échelle centrée sur la philosophie Low Tech, qui correspond alors à un projet de société. Il existe certain·es acteur·ices qui se posent déjà des questions qui vont dans ce sens, comme l’initiative « Éco-Industrie Locale”[12] qui relocalise la production de parapluies en utilisant des matériaux écologiques et des techniques sobres, ou le cabinet de conseil RSE Goodwill Management[13] à l’origine notamment de la Low-Tech Skol, premier établissement de formation en France dédiée aux Low-Tech. A première vue, cette vision ressemble fortement au greenwashing avéré des réponses censées rendre le système industriel plus durable sans remettre en cause le modèle capitaliste : industrie “propre”, filières “éco-responsable”, croissance “verte”[14]… C’est d’ailleurs probablement pour cette raison que son imaginaire est très peu développé dans la pensée Low-Tech. On pourrait d’ailleurs dire qu’une industrie Low-Tech est un non sens pour beaucoup de partisans de la démarche – et nous reviendrons dessus. Il n’existe donc aujourd’hui que très peu de réflexions écrites ou d’exemples concrets témoignant de cette troisième voie. L’objet de cet article est d’exposer en quoi elle semble cependant indispensable à la formulation d’un projet de société complet en articulation avec les deux autres visions. Nous exposerons pour cela les principaux défauts des deux premières approches, pour illustrer en quoi il est nécessaire d’élargir les horizons de la Low-Tech. Nous souhaitons montrer que ce projet, contrairement à l’idée que l’on pourrait s’en faire, peut lui aussi s’inscrire dans une rupture radicale avec le modèle dominant et embrasser toutes les dimensions politiques et philosophiques de la Low-Tech. Nous proposons ainsi de défricher un imaginaire qui semble aussi paradoxal que fertile, pour imaginer un cadre d’action systémique, réaliste, et enthousiasmant.
Les limites du système D(IY)
Si la vision de la Low-Tech comme réappropriation démocratique de la technique par le bricolage est séduisante, elle rencontre très vite ses limites lorsqu’on la projette à une échelle spatiale ou temporelle plus large. Bien entendu, les bidouilleurs et autres férus de DIY ne promeuvent pas nécessairement une massification et une généralisation du “système D”, mais il semble bon de rappeler les plus évidentes limites de cette vision pour qui en serait tenté.
Les limites de la récupération
Une des approches caractéristique de l’univers Low-Tech, et notamment de l’approche DIY, consiste à détourner de leur usage premier des objets ou matériaux déjà disponibles dans notre environnement immédiat pour les adapter à nos besoins. Cette possibilité semble à première vue très intéressante et pertinente. La société industrielle actuelle produit en permanence des monceaux d’objets plus ou moins utiles et surtout rapidement obsolètes. Ces tonnes de déchets électroménagers ou de construction sont ainsi autant de coffres aux trésors regorgeant de ressources utilisables ailleurs : moteurs, vitres, planches… Chacun·e peut ainsi fabriquer une petite éolienne avec un moteur d’imprimante[15], un panneau solaire thermique à partir d’une grille de frigo et d’une simple vitre[16], ou encore une marmite norvégienne avec des restes d’isolation et des morceaux de palettes[17]. Ces initiatives permettent ainsi à tout un chacun de disposer de ces technologies sobres pour améliorer son quotidien. Dans de telles conditions, la récupération, réutilisation ou recyclage de ces déchets est évidemment quelque chose de vertueux. Mais encore une fois, si l’on se pose la question de la généralisation de ce modèle, il se heurte également à d’importantes limites. Le premier problème est un problème qualitatif : avec des matériaux de récupération, la qualité de l’objet final est grandement dépendante de la qualité des matières récupérées, qui est très aléatoire. Dans le cas du panneau solaire thermique, différents éléments de récupération posent des problèmes graves s’ils ne sont pas pris en compte. Comme le rappelle Cyrille, “L’utilisation de verre à vitre classique pour le panneau implique qu’il cassera probablement à la première averse de grêle. En effet les panneaux industriels utilisent du verre trempé, hautement technique et surtout très résistant, pour pallier ces aléas. Il est sans doute possible de récupérer des vitres de ce type (par exemple des vitres de trains) mais elles sont beaucoup moins courantes, et encore faut-il avoir connaissance de ce risque. Ce danger, en plus de porter fortement atteinte à la durabilité de l’installation, entraîne un réel risque de coupure ou de brûlure pour l’utilisateur, ce qui augmenterait statistiquement de manière considérable les accidents liés à la massification de cette approche.” Par ailleurs, la qualité du verre utilisé influence également l’absorptivité du verre et donc ses performances dans un panneau thermique[18]. Une autre limitation importante liée à la récup’ est qu’il est impossible d’avoir une maîtrise de la quantité, des dimensions et autres caractéristiques de nos matériaux puisqu’elles varient en fonction de nos trouvailles. Chaque nouvelle réalisation conçue à partir d’objets récupérés doit être unique, faite sur mesure, avec à chaque fois un temps considérable passé pour s’adapter à l’imprédictibilité des matériaux. Se baser uniquement sur la récup’, c’est donc, en quelque sorte, se condamner à construire en permanence des objets sous-optimaux, en ajoutant des contraintes de conception supplémentaires. Si ces contraintes ne sont pas un problème dans des ateliers pédagogiques ou dans des réalisations individuelles, elles restent, ici encore, peu satisfaisantes en tant que modèle de société. Le temps passé à trouver, démonter, vérifier et adapter les matières premières à ses besoins est considérable et pas forcément tenable (Et quiconque a déjà passé 2h à démonter une palette pour récupérer quelques planches de solidité douteuse saura facilement s’en convaincre !). Cette approche complexe semble ainsi plutôt contradictoire avec la simplicité et l’accessibilité que prône la philosophie Low-Tech. Devoir réaliser des objets uniques ou presque en fonction des arrivages nécessite d’avoir les compétences et l’inspiration de produire une véritable œuvre d’art à chaque nouvel ouvrage. Impossible dans ce cas d’envisager la professionnalisation et standardisation (même néo-artisanale) d’une production à moins de compter sur une filière de récupération de déchets industriels (produits de manière constante et uniforme) et donc d’être dépendants de cette industrie pour concevoir son produit Low-Tech. Il réside d’ailleurs ici un dernier point qui fait que la récupération n’est structurellement pas un modèle viable de société. Celle-ci se base sur en effet sur l’existence d’une importante source de déchets issue de l’ économie capitaliste et linéaire actuelle. La récupération n’est possible que parce qu’il existe en parallèle un système qui produit ces déchets, système qu’une société Low-Tech prétendrait à terme remplacer. Pour toutes ces raisons, la Low-Tech basée sur des matériaux de récupération ne constitue pas un modèle global de société cohérent. Cela ne veut pas dire qu’il faut arrêter de faire de la récup’ – et on aurait bien tort de s’en priver lorsque c’est pertinent – mais simplement qu’elle ne peut pas être structurante pour un projet à l’échelle supérieure que celle du bricolage.
| Quand la récup’ est contre-productive : le frigo qui réchauffe… |
|---|
La réutilisation est presque toujours plus efficace énergétiquement que le recyclage. Il existe néanmoins des cas où les produits sont dangereux, complexes, ou utilisent des matériaux rares, dans lesquels une prise en charge structurée serait plus intéressante pour optimiser le recyclage ou minimiser l’impact environnemental. Par exemple, si l’on reprend le cas du chauffe eau solaire DIY, la récupération d’une grille de réfrigérateur utilisant une charge de 200 g de réfrigérant R134a[19] libère l’équivalent de 286 kg de CO2, soit plus d’1/10 du budget carbone annuel par personne pour respecter les Accords de Paris[20]. Il est aujourd’hui obligatoire de traiter les équipements frigorifiques en fin de vie pour éviter de relâcher ces gaz de synthèse à très fort pouvoir de réchauffement. Ils peuvent ensuite soit être recyclés et réutilisés, soit simplement détruits[21]. Cependant, ce système de traitement industriel semble malgré tout inefficient, notamment concernant les équipements des particuliers, puisque moins de la moitié passerait effectivement par ces filières[22]. Encourager la récupération sur ce type d’équipement sans traitement approprié pourrait donc paradoxalement aggraver certains problèmes environnementaux. |
L’illusion de l’autonomie
Une limite plus importante que celle de la récupération est la portée nécessairement limitée de ces Low-Tech individuelles, malgré certains discours qui pourraient laisser à penser que chacun pourrait grâce à celles-ci devenir autonome. Un des premiers problèmes qui vient ébrécher le mythe des Low-Tech accessibles à tous concerne l’outillage. En effet, si on peut considérer que chacun peut raisonnablement avoir accès à un marteau ou une clé de 12, il est moins sûr qu’un poste à souder, une ponçeuse à bande, ou une perceuse à colonne soient aussi répandus. L’acquisition de l’outillage nécessaire pour réaliser les tutos simples et peu chers peut, elle, représenter un investissement conséquent. Cela remet en cause la dimension ‘accessible’ des Low-Tech, en plus de poser des questions sur l’effet rebond d’un tel engouement pour les outils de bricolage – mais nous viendrons un peu après à cet aspect. Bien sûr, le mouvement Low-Tech a une forte dimension collective, et il serait tout à fait logique que ces outils puissent être rendus disponibles par des systèmes locaux de partage ou de location d’outillage (par exemple, au sein de repair cafés, Low-Tech labs…). Admettons donc que tout le monde puisse avoir facilement accès aux outils nécessaires pour ses projets. Encore faut-il savoir les utiliser correctement, et de manière sécurisée. Des formations sont possibles, et permettent de répondre à de nombreux besoins. Cela nécessite cependant que chacun·e y consacre un temps et des ressources considérables. La réappropriation démocratique de nos objets technologiques ne peut se passer d’un apprentissage manuel, voire théorique, assez complet, pour chaque nouvel objet Low-Tech considéré. Or, dans une société où nous sommes globalement spécialisés dans des tâches précises, il semble difficile de demander à chacun·e d’y consacrer la quantité de temps qui serait réellement nécessaire. Il est ainsi impensable que tous·tes les citoyen·nes parviennent à maîtriser complètement tous les aspects techniques de leur quotidien pour être parfaitement autonomes envers le système qui les loge, les nourrit, les chauffe, les divertit… Si chacun·e devait devenir expert·e dans tous les aspects de la vie quotidienne, le résultat serait d’ailleurs probablement très peu satisfaisant. Pour dire les choses de manière un peu caricaturale : si chacun·e devait faire pousser sa nourriture, se fabriquer des vêtements, construire sa maison, et concevoir son système énergétique, alors nous serions sûrement beaucoup à être affamé·es, vêtu·es de loques, sans endroit au sec pour dormir et éclairé·es à la bougie. À petite échelle, il existe bien entendu certains exemples de foyers ou collectifs qui démontrent qu’il est possible d’être ‘autonomes’ à leur échelle – même si cette autonomie reste illusoire, comme nous l’aborderons par la suite. Le point est que ce modèle de petite échelle n’est pas réalisable à grande échelle, et que même si c’était le cas, on peut émettre de fort doutes sur la désirabilité d’une telle société. Plantons une autre épine dans le pied du mythe de l’autonomie en abordant la question de l’accessibilité à toutes et tous de ces techniques. Si l’on a vu qu’une personne valide et disposant de ressources suffisantes se confronte déjà à un défi très complexe pour espérer l’autonomie grâce au système D, quelle serait la place des personnes à mobilité réduite – à commencer par nos aîné·es ? Comment s’assurer de ne pas aggraver les discriminations envers les personnes porteuses de handicap, de facto moins autonomes que les autres, et ainsi accentuer ou entretenir le système d’oppression dit validiste existant à l’heure actuelle ? La philosophie Low-Tech promet de fortes valeurs d’entraide et de solidarité qui donnent beaucoup d’espoir pour les possibilités de développement de dispositifs adaptés à chaque situation, même si ces questions restent encore très peu évoquées dans l’écosystème actuel. Quoi qu’il en soit, cela montre qu’en plus d’être autonome pour soi, il faudrait également permettre une telle autonomie à celles et ceux qui ne peuvent pas l’être par elles·eux-mêmes. Dur fardeau pour notre société autonome déjà mal nourrie, mal vêtue et mal logée… Cette vision autonomiste radicale est une extension un peu caricaturale de la généralisation du système D qui n’est bien entendu pas promue par le monde de la Low-Tech. Ainsi, bien que cela puisse paraître comme une évidence, la Low-Tech version ‘bricolage’ ne fait pas en soi modèle de société. Le bricolage s’adapte ainsi très mal au passage à une échelle supérieure[23]. Une éolienne à base de moteur d’imprimante délivre au mieux quelques dizaines de watts, ce qui peut dans le meilleur des cas alimenter une lampe ou un ordinateur. Cela peut être éventuellement utile dans les endroits isolés du réseau électrique (en montagne, ou dans des pays en développement, par exemple) mais cette option est bien loin de répondre aux besoins d’une maison actuelle lambda – même en réduisant au maximum la consommation. Sans nier l’intérêt pédagogique et politique de promouvoir et développer la réalisation de Low-Tech DIY, à son échelle, avec des matériaux de récupération, on convaincra non sans mal qu’une société Low-Tech doit développer une professionnalisation et une spécialisation des tâches. Le développement de solutions Low-Tech néo-artisanales apparaît donc bien comme complémentaire à cette approche individuelle.
Les limites du modèle artisanal
De plus en plus d’adeptes de la philosophie Low-Tech, conscient·es des enjeux précédemment évoqués, s’intéressent à la fabrication d’objets à plus grande échelle en utilisant des matériaux locaux et renouvelables, des procédés sobres, des outils manuels demandant un haut niveau de maîtrise… dont la productivité est moindre que celle des chaînes de productions industrielles, en accord avec la nécessité de décroissance de la consommation. Ce type de production est par ailleurs plus résilient en cas d’effondrement de la société thermo-industrielle, puisqu’il ne demande que très peu d’énergie externe au corps humain, et requiert dans la majorité des cas des matériaux locaux et renouvelables (comme le bois notamment). Ces savoirs et savoirs-faires, parfois anciens ou parfois réinventés, permettent alors de s’atteler à des réalisations plus complexes, plus fiables, et plus généralisables que celles faites par des bricoleurs amateurs. Cependant, une généralisation de cette forme d’artisanat 100% manuel, correspondant à un mode de production antérieur au XVIIIe siècle, se heurte à divers défis dans le contexte et les enjeux du XXIe siècle.
Un premier aspect à prendre en compte est l’exigence, la difficulté et la dangerosité de ces métiers artisanaux. Si leur contenu technologique est relativement faible, il est compensé par un apprentissage très long des diverses techniques pour arriver à un résultat satisfaisant. Par exemple, arriver à transformer un tronc d’arbre en meuble acceptable est très loin d’être simple et donc n’est pas accessible à qui n’a pas un certain nombre d’années d’expérience dans le métier ou a minima les ressources documentaires et techniques nécessaires. L’utilisation d’outils mécaniques permet de rendre cet apprentissage plus court, et réduit également le temps passé à des tâches pénibles et répétitives comme raboter des planches à la même dimension[24]. Cependant, tous les outils mécaniques ne se valent pas, notamment du point de vue de la sécurité. Ainsi, l’absence de ‘sécurités’ de base sur les machines anciennes (arrêts automatiques, caches de protection…) était la source d’un nombre important d’accidents potentiellement très graves. Il apparaît donc ici un arbitrage à faire dans la démarche de production Low-Tech, puisqu’il serait regrettable que le gain en qualité environnementale se fasse au détriment de la santé de l’artisan.
Une deuxième problématique est qu’il est impossible de se passer de toutes les ressources non renouvelables. A moins de se passer d’un très grand nombre d’objets, il y aura toujours besoin de fer, de cuivre, d’argent, d’aluminium ou même de pétrole ou de charbon. Ne pas utiliser de telles ressources reviendrait à se passer d’appareils de soins médicaux, de lignes de train, de canalisations, de vélos, d’informatique voire même simplement d’électricité. On admettra sans trop de mal qu’un projet de société désirable Low-Tech ne correspond pas à un tel ‘retour à l’âge de pierre’, ce qui pose la question de l’accès à ces ressources de manière sobre et durable, à défaut de pouvoir toujours être local. Les néo-artisans devront pour certains se procurer de telles ressources, indéniablement appelées à se raréfier. En effet, les révolutions industrielles successives ont extrait des quantités immenses de minerais, en commençant par les filons les plus riches et facilement accessibles, donc les plus rentables. Aujourd’hui de nombreux minerais sont accessibles uniquement en creusant des mines très profondes ou en brassant des montagnes entières, la teneur en métal du minerai ayant fortement baissé. De même, le taux de retour énergétique (TRE), c’est-à-dire le ratio entre l’énergie nécessaire à la production des métaux et celle que leur utilisation va générer, ne cesse de baisser. Comme le note Guillaume Pitron, “[au Chili, premier producteur mondial], l’énergie nécessaire pour extraire le cuivre a augmenté de 50% entre 2001 et 2010, pendant que la production totale de cuivre n’augmentait que de 14%”[25]. Cela a pour conséquence que, si ça a pu être le cas par le passé, il est aujourd’hui impossible d’extraire de tels matériaux de manière Low-Tech, car les gisements faciles d’accès ont pour la plupart été épuisés avant la délocalisation actuelle des activités minières. Pour extraire ces ressources, il sera donc nécessaire de disposer d’une certaine puissance et d’un certain outillage technique qui n’entre pas vraiment dans l’imaginaire Low-Tech.
Notons qu’en l’absence d’une croissance incontrôlée, l’usage de matériaux non renouvelables n’est pas forcément une aberration. On pourrait probablement se contenter en bonne partie de métaux déjà en circulation, en améliorant le tri et le recyclage des différents alliages au lieu de les mélanger comme aujourd’hui pour en faire de l’acier de consommation courante (suffisant pour la plupart des usages mais pas pour des outils de qualité), ou de l’utiliser de manière dispersive, comme l’aluminium des déodorants ou le titane des peintures blanches, qui ne pourront jamais être recyclés[26]. On imagine cependant difficilement ce recyclage s’organiser ici encore à des échelles très locales et néo-artisanales.
La perte de certaines technologies industrielles serait également très préjudiciable à la nécessaire efficacité énergétique de nos productions. L’exemple du roulement à bille est tout à fait représentatif de ce problème. Autrefois, les frottements entre un axe et son logement (par exemple l’essieu en bois d’une charrette) étaient limités par lubrification avec du suif (graisse de porc), additionné à un peu d’huile végétale ou animale. Puis est arrivé le besoin de transports de charges plus lourdes, et les coussinets en bronze lubrifiés à l’huile minérale sont apparus. Avec cette solution les frottements sont réduits, mais les pertes sont quand même très conséquentes. Seule l’arrivée progressive des roulements à billes et à rouleaux, à partir de 1907, permettra une amélioration très forte des performances[27]. Problème : une fabrication de bonne qualité nécessite une précision extrême, ainsi que des matériaux très techniques, que l’on peut obtenir seulement dans un contexte industriel[28]…
Une irréductible dépendance à la High-Tech
La plupart des limites évoquées peuvent se résumer dans l’idée que les visions actuelles de la Low-Tech ne la rendent possible qu’en marge d’un modèle de société majoritairement High-Tech. En effet, ce n’est pas parce qu’un objet est considéré comme une Low-Tech qu’il est forcément fabriqué de manière Low-Tech – attention à la nuance ! D’ailleurs, si l’on réfléchit vraiment en terme de modèle de société, il faut aller bien au delà de la fabrication. Dans cette catégorie, on peut par exemple considérer qu’une cafetière à piston est Low-Tech, car elle est très sobre énergétiquement dans sa phase d’utilisation et qu’elle est composée d’un petit nombre de pièces à première vue très simples et compréhensibles. Tout le monde s’accorde ainsi en général pour dire qu’elle est beaucoup plus Low-Tech et adaptée à une société résiliente qu’une cafetière à capsules jetables. Pourtant, en y regardant de plus près, cette technologie est très loin d’une Low-Tech “pure” et accessible à tous.
Cette simplicité apparente cache en effet une incroyable complexité, que décrypte Cyrille : “Le détail du piston est en fil d’acier inoxydable tressé-maillé, avec sertissage de l’œillet en hydraulique. Le porte-filtre est une feuille emboutie, avec perçages adoucis, ressort spiral engagé sur le rebord, pourvu de perçages réguliers. Les usines requises pour produire comprennent l’extraction des minerais : fer, chrome, nickel, manganèse, vanadium, molybdène, la cokerie, les hauts-fourneaux, laminoirs et train à bandes, façonnage des feuillards, bancs d’étirage et usine de tréfilerie, maillage de précision, le rig d’extraction de pétrole, mais également la raffinerie de pétrole, l’usine de conversion du plastique butadiène-rubber, l’injection plastique pour le fond et le manche, la verrerie capable de faire le pot en Pyrex avec des côtes de précision (verre borosilicate résistant aux écarts brusques de températures, car un verre classique en sodocalcique éclaterait)…. Si l’on souhaite se réapproprier TOUTES ces usines, il y en a pour pas loin de 5 milliards de dollars.”
En bref, même en supposant la substitution du pétrole par une autre source d’énergie et des matériaux issus du recyclage, il apparaît clairement que tout cela est très loin d’être simple, accessible, local et résilient… Ce raisonnement au sujet d’une cafetière ( qui ne doit pas éluder d’autres questionnements comme les impacts écologiques du café, les alternatives locales possibles à la caféine…) pourrait très bien être reproduit avec d’autres exemples. Pour citer Philippe Bihouix : “Même les objets les plus simples, les plus conviviaux, les plus réparables, ne pourront être entièrement fabriqués localement. Prenons l’exemple d’un vélo. Même un modèle simple contient plusieurs centaines de pièces élémentaires, dont la plupart ont un contenu technique qui n’est pas maîtrisable “localement” : métallurgie d’alliages et métaux différents, usinage et ajustage des pièces, vulcanisation du caoutchouc des pneus, préparation des peintures anticorrosion ou de la graisse pour la chaîne… demandez à un forgeron de village de vous fabriquer un dérailleur !”[29]. Un vélo est indubitablement très gourmand en métaux et en techniques de fabrication complexes[30], sans que cela ne l’empêche d’être considéré comme représentatif de l’esprit Low-Tech. Mais la suite du passage ouvre des perspectives : “En revanche, une fois construit, il est clairement possible pour le commun des mortels d’en comprendre parfaitement le fonctionnement, de le “bricoler” et un réseau de réparateurs ayant accès à des pièces détachées simples peut le maintenir en état pour de très nombreuses années, pour ne pas dire indéfiniment ou presque”. S’il ne semble donc pas possible de produire localement l’ensemble des solutions Low-Tech dont nous avons besoin, la compréhension de leur fonctionnement, leur réparation et – dans une certaine mesure – leur adaptation à nos besoins précis, sont tout à fait accessibles à chacun·e. C’est d’ailleurs en cela qu’on peut les considérer comme des Low-Tech.
Si ces deux exemples concernent des technologies ‘toutes faites’, qui ne sont pas fabriquées par l’utilisateur·ice, ces réflexions n’épargnent pas non plus la low tech en version DIY. En effet, tous les outils indispensables pour faire le moindre bricolage sont l’aboutissement de chaînes de productions industrielles au moins aussi complexes que celles de la cafetière ou du vélo. Perceuse, scie électrique, marteau, serre-joint, tournevis, fer à souder, meuleuse, sans parler des consommables : clous, vis, boulons, colle, joint, enduit… autant d’outils sans lesquels la construction DIY ou artisanale semble impossible à réaliser et qui pourtant sont issus de la société de consommation[31]. Notons également ici l’importance que tous ces outils et consommables soient produits de manière normalisée et uniformisée, pour que, d’une atelier ou d’un chantier à l’autre, on puisse utiliser le même matériel et le même savoir-faire. Certes, il est possible de mettre en commun, mutualiser, partager, emprunter, acheter d’occasion ou donner, mais cela n’enlève pas la complexité qui existe derrière ces outils et consommables dont la diffusion de masse est un atout indiscutable.
| Derrière les miroirs du concentrateur solaire |
|---|
| Cyrille illustre un des paradoxe de la Low-Tech avec l’exemple d’un concentrateur solaire : “Le concentrateur solaire dispose d’un faible rendement et d’une grande emprise au sol, mais est simple et bricolable avec des matériaux de récupération basiques, et est notamment adapté pour des contextes comme l’Afrique où il y a un grand ensoleillement et beaucoup de place en dehors des villes. Ces performances pourraient donc être satisfaisantes pour de petites entreprises comme des boulangeries. C’est plus discutable pour l’Europe où il y a un plus faible ensoleillement, de plus nombreuses précipitations qui dégradent le système, et où la place manque, notamment en ville. Prenons le cas d’un miroir. Celui de la Galerie des Glaces de Versailles, par exemple – conçu pour impressionner les puissants. Le verre a été produit à la Manufacture Royale de Saint Gobain (Aisne) où le dépôt d’argent avait été fait avec du mercure. L’amalgame AgHg est versé et chauffé par dessous, ce qui génère des vapeurs extrêmement toxiques[32]. Cela est “presque” encore d’actualité. Premièrement, la feuille de verre plat est un produit de très haute technologie issu d’une usine qui fait 300 mètres de long. Ce verre glisse sur une piscine d’étain fondu de 4 mètres de large et se refroidit lentement, d’où les 300 mètres[33]. On ne peut pas faire plus petit. On dépose à l’envers de ce verre un polissage soigneux puis un rinçage au protoxyde d’étain, puis on verse le nitrate d’argent avec un réactif, souvent de l’ammoniaque. L’argenture est faite, on la bloque avec une couche de cuivre métallique, puis une peinture au plomb couvre l’argent. Au plomb, à 70% en masse…[34] Peut-on considérer qu’un concentrateur produit avec un tel miroir est durable ? Probablement. Lorsque certains fabriquent des concentrateurs solaires « Do It Yourself », les couches d’argent sautent en un rien de temps, et l’on disperse aussi du plomb dans la nature. Les miroirs redeviennent alors du verre, transparent, incapable de produire de l’énergie renouvelable, pour un résultat nul ou presque, invendable. C’est Low-Tech, absolument. C’est une énergie renouvelable, décarbonée. Mais pourtant, en quelques années, cela ‘promeut les usages dispersifs de métaux stratégiques’. À l’opposé, la High-Tech a créé des céramiques nanostructurées sur de l’aluminium, métal on ne peut plus abondant. La durée de résistance à la corrosion atmosphérique est garantie 40 années. Mais ce n’est plus une approche Low-Tech. Si l’on doit sortir de la dépendance au pétrole, on n’a juste pas assez d’argent-métal pour faire des miroirs…” |
Vers une société Low-Tech
On prend alors conscience de la réelle portée des exigences d’un modèle de société, c’est-à-dire d’un système sociotechnique qui soit Low-Tech. Au delà que nos objets du quotidien soient sobres, utiles et accessibles, cela nécessiterait que l’intégralité des outils et des matières premières utilisées répondent aux exigences de la Low-Tech, ainsi que les procédés utilisés pour produire ces matières premières, les outils intervenant dans ces procédés, les chaînes d’approvisionnements, … On pourrait ressortir très pessimistes de ce constat, car la généralisation de la Low-Tech semble se confronter à une impasse : tout simplement impossible. Serait-elle donc condamnée à ne rester qu’une niche de sensibilisation pour des personnes privilégiées dans un système dominant qui restera high-tech jusqu’à son effondrement ? Nous proposons une autre manière de réagir face à la prise de conscience de ces limites. Nous proposons qu’un modèle de société Low-Tech est possible, à condition que la définition de la Low-Tech ne s’arrête pas à une question d’échelle ni – paradoxalement – du niveau de technicité des outils employés, mais se recentre sur leur finalité et le modèle socio-économique dans lequel ils s’insèrent. Si un retour en force de l’artisanat est désirable dans certains domaines, il n’est pas la réponse à tout. Reprenons à nouveau les mots de Philippe Bihouix : “Il ne s’agirait donc pas d’un retour massif à l’artisanat, même si celui-ci serait évidemment amené à se développer. Mieux vaut garder une usine de serrures que tenter de tout faire fabriquer chez le forgeron du coin (déjà occupé avec votre dérailleur de vélo…), mieux vaut ne pas revenir immédiatement au rouet comme nous y invitait Gandhi. En “démécanisant” à ce niveau, nous y perdrions beaucoup, et sans doute trop, en capacité de production pour de nombreux produits de base, sans forcément gagner grand-chose sur la consommation d’énergie ou de matières premières. Si l’on veut profiter de nos moindres besoins pour progresser vers une société du temps libre, il sera donc sage de conserver de petites usines et des ateliers spécialisés, dans lesquels la petite échelle n’empêche pas une productivité élevée… et d’orienter le cordonnier et d’autres artisans avant tout vers la réparation plutôt que la création sur mesure.”[35]
Toutes les limites évoquées précédemment n’ont donc pas pour but de disqualifier la démarche Low-Tech dans son ensemble ou dans ses pratiques actuelles, mais plutôt de suggérer qu’il lui manque un niveau de raisonnement à une échelle plus systémique. Notons que loin d’être un problème philosophique, un tel niveau de réflexion est indispensable pour élaborer un nouveau récit de société qui soit crédible et auquel les citoyens auront envie de contribuer. Or, à moins de concessions impensables au sein d’un tel récit, nous avons montré que cette échelle systémique ne peut se passer d’une certaine production massive et uniformisée, qui est aujourd’hui accomplie dans le système industriel par des machines-outils de pointe. Cet échelon est fondamentalement manquant dans la philosophie Low-Tech, car il va à de nombreux égards à l’encontre des principes d’accessibilité, de convivialité et de durabilité. Après être revenu plus en détail sur ces points noirs, nous proposons de terminer ce texte en ébauchant des pistes pour dépasser ces incompatibilités pour renforcer les perspectives d’un projet Low-Tech systémique.
L’incompatibilité du modèle industriel et de la Low-Tech
L’industrie est, presque par définition, antinomique de la Low-Tech. Un des pionniers de cette philosophie, Ivan Illich, a d’ailleurs construit toute sa pensée et son argumentation en opposition à l’industrie, et à la massification de la production et des services[36]. Premièrement, l’industrie est loin d’être démocratique. Elle est pilotée par des détenteurs de capitaux ou actionnaires qui peuvent réaliser des investissements monumentaux, et est mise au service de l’accroissement des richesses de ces personnes. Les salarié·es ne sont souvent considéré·es que comme des “ressources” (humaines) dont il faut extraire le plus de valeur, à l’instar des “ressources naturelles”. Ils·elles travaillent aux cadences des machines et des algorithmes qui ont été conçus pour optimiser la chaîne de valeur. En d’autres termes, l’outil n’est plus au service de l’humain, mais c’est l’humain qui devient un esclave de la machine. Deuxièmement, il n’existe pas grand chose de moins libre d’accès que les technologies industrielles[37], qui sont jalousement gardées comme des “propriétés intellectuelles”. Troisièmement, la production industrielle aboutit à des objets uniformisés, et impose des choix technologiques à l’ensemble de la société. Contrairement à leur profitabilité, l’utilité, la pertinence ou la sobriété des technologies ne sont clairement pas des conditions nécessaires à leur développement et diffusion massive. Tout ceci mène à des objets techniques constitués comme des boîtes noires, dont l’utilité n’est jamais remise en question, et auxquels la société n’a souvent d’autres choix que de s’adapter. L’obsolescence programmée est le syndrome maladif de ce modèle, lorsque la conception empêche toute réparation ou que le renouvellement fréquent de modèles – non rétrocompatibles avec les pièces détachées, évidemment – est incité par des défauts de conceptions spécifiquement prévus. Enfin, la dimension environnementale est absente de la pensée industrielle, qui ne la prend en compte que lorsqu’elle y est contrainte par des normes ou qu’elle atteint les limites physiques des ressources planétaires. Ces impacts sont exacerbés par la production massive de gadgets inutiles, vendus à grand renfort de marketing destiné à créer de nouveaux besoins et participant également à l’obsolescence programmée à un niveau psychologique. Pour résumer, le système industriel tel qu’il existe est la cause des problèmes sociaux et environnementaux contre lesquels lutte fermement la Low-Tech.
Des angles de compatibilité ?
Néanmoins, il serait malhonnête de ne pas voir une dimension sociale positive au développement du système industriel. En effet, celui-ci s’est probablement imposé entre autres car il a initialement permis à un très grand nombre de personnes de subvenir rapidement à des besoins de première nécessité qui étaient jusqu’alors réservés aux plus riches, pouvant s’offrir les travaux des artisans. Par ailleurs, nous avons vu que la standardisation de la production et l’uniformisation de l’environnement technique permettent aussi la modularité et l’interopérabilité. En effet, s’il est facile de changer une roue de vélo ou une pompe dans un système hydraulique, c’est parce qu’il existe des normes et des standards issus du monde industriel. Cette modularité est indispensable à la démocratisation de la technique et à son accessibilité, autant de valeurs promues par la philosophie Low-Tech. La démocratisation et la massification du bricolage n’est possible que si l’on dispose d’outils fiables, sécurisés, ergonomiques et relativement homogènes. Sans cela, impossible d’imaginer un apprentissage de chacun·e et une réappropriation collective de l’environnement technique, car une diversité trop élevée entraînerait une extrême complexification de l’utilisation et serait donc un facteur d’exclusion. La performance des outils permet de limiter l’intensité en temps de travail, ce qui laisse plus de place à la convivialité et aux loisirs. Par ailleurs, l’utilisation de composants fiables dans le bricolage permet d’améliorer la durabilité et la sécurité des objets produits, ce qui est également essentiel. C’est également grâce à des normes et un vocabulaire technique commun qu’il est possible d’envisager des projets dépassant l’échelle individuelle.
Enfin, l’industrie permet une indéniable efficacité sur les processus de production. En optimisant les systèmes de production d’énergie, les enchaînements d’opérations unitaires, la gestion des sous-produits, l’univers industriel, malgré les dégâts environnementaux qu’il provoque et l’intense consommation qu’il génère, reste un moyen de production incroyablement efficace. Si tous les objets du quotidien étaient produits en quantité équivalente par de l’artisanat, cela représenterait probablement une consommation d’énergie et de ressources ainsi qu’une génération de déchets bien plus importantes. Bien entendu, cette manière de cadrer le problème est biaisée, car l’intensification de l’artisanat amènerait probablement des objets plus simples, fiables et robustes, durables et réparables et donc in fine à en diminuer la quantité. A l’inverse de l’effet rebond, il est probable qu’une diminution de l’efficacité de production entraîne bien une diminution de leurs impacts. La dichotomie entre industriel et artisanal est réelle à l’heure actuelle mais pourrait être dépassée dans une société Low-Tech. Si la plupart du temps le modèle artisanal est indiscutablement plus avantageux, d’un point de vue social, que le système industriel, il en est également aujourd’hui très dépendant. Au niveau de l’approvisionnement en matières premières, au niveau de la conception d’outils artisanaux complexes, ou encore au niveau de la gestion des déchets de production, il est nécessaire de porter une réflexion sur les avantages de la solution industrielle par rapport à la solution artisanale. Bien entendu, la réponse ne sera jamais systématique, et doit être pensée en fonction du contexte. Mais dans toutes les situations où l’artisanat est trop peu efficace pour être durable ou souhaitable d’un point de vue social (notamment, au niveau des conditions de travail), il est nécessaire de mettre en place des solutions de plus grande envergure permettant de prendre ces tâches en charge à un niveau collectif adapté.
La production de masse démocratique et conviviale, un modèle à inventer
Malgré ses nombreux défauts, on voit ici se tracer les points de convergence entre l’échelle industrielle et les valeurs de la Low-Tech. Plus même qu’une compatibilité ou une possibilité de coexistence, la première partie de cet article montrait une réelle nécessité de l’existence d’un tel système pour développer et généraliser la Low-Tech. Exposé sous cet angle, on peut également se rendre compte que ce qui dégrade réellement l’environnement et les rapports sociaux dans le modèle industriel est moins la manière de réalisation et les outils utilisés que les raisons pour lesquelles sont effectuées ces opérations – en l’occurrence, l’accroissement du capital des investisseurs. La question ici n’est donc plus de savoir si il faut conserver une industrie. Elle est plutôt de repenser comment concevoir une industrie qui réponde aux besoins de la Low-Tech et qui en partage la philosophie. Dans les développements futurs de la Low-Tech, il est nécessaire de cesser d’ignorer les dépendances à la High-Tech pour au contraire réfléchir à la meilleure manière de dépasser ce plafond de verre. Parfois une solution Low-Tech ne sera pertinente que si elle fait intervenir certains composants très High-Tech. Il n’est pas nécessaire de se priver de ces possibilités si – et seulement si – cette High-Tech peut être produite en respectant la philosophie Low-Tech : c’est-à-dire utile, sobre, et accessible (dans la mesure du possible). En effet, le contenu technologique de ces solutions n’empêche par exemple pas la relocalisation des industries productrices, en réduisant quand c’est possible leur échelle. Ainsi on pourrait très bien imaginer une multitude de PME qui produisent à une échelle nationale voire régionale divers objets durables et leurs pièces détachées pour en assurer la maintenance pendant des décennies. Dans ce modèle, la gouvernance et la coordination de ces industries devrait être radicalement repensée, afin qu’elle se structure de manière démocratique et autour des intérêts des salarié·es, plutôt que par la recherche du profit des détenteur·ices du capital comme aujourd’hui. En effet, seul un raisonnement démocratique des moyens de production permettra de s’assurer qu’ils sont cohérents avec un modèle social juste, et compatibles avec les enjeux environnementaux. L’usine réellement Low-Tech appartiendra à ses salarié·es, et sera pilotée par les citoyen·nes et autres acteur·ices de la Low-Tech qui nécessitent ses services. Elle produira ce qui ne pourra être produit autrement (notamment les outils, pièces techniques ou High-Tech jugées nécessaires, consommables uniformisés indispensables…). Si le défi de la Low-Tech est passionnant, c’est autant car il est aujourd’hui une nécessité que parce qu’il appelle à questionner le système productif dans son ensemble. Les embryons de réponses que nous avons proposés sembleront sans doute insatisfaisants au vu de l’importance des enjeux, mais nous ne nous donnons pas pour ambition de trancher la réponse à cette question. Il s’agit plutôt d’un point de départ, de premières pistes, d’un appel aux acteurs de la Low-Tech à se saisir pleinement de la question. Cette nouvelle problématique se formule sous la forme d’un curieux oxymore : comment concevoir l’industrie Low-Tech ? Pour y répondre, il est nécessaire de faire la part des choses entre les bons et les mauvais aspects du système industriel, le principal défi étant que les seconds surpassent aujourd’hui largement les premiers. À l’instar des questions que l’on peut se poser sur la pertinence des techniques dans une démarche de sobriété personnelle, c’est donc le système productif dans son ensemble qu’il faudrait interroger. Que produit aujourd’hui le système industriel ? De quelles industries avons-nous (vraiment) besoin? Desquelles sommes-nous dépendant·es, et desquelles pourrions-nous nous passer ? Où s’arrête l’indispensable, et où commence le superflu ? Qu’est-ce qui doit être uniformisé et qu’est-ce qui ne doit pas l’être ? À quelle échelle doit-on fournir les produits et services Low-Tech ? Comment organiser cette production pour qu’elle ne subisse pas les mêmes dérives que le précédent système industriel ? Si certaines propositions au niveau systémique commencent à émerger – notamment dans le projet Glocal Low-Tech[38]-, la réflexion n’en est qu’à son balbutiement. C’est en apportant des réponses à toutes ces questions – ainsi que celles qui en découlent –, par la pensée et par l’action, qu’il sera possible d’écrire le récit enthousiasmant d’un projet de société Low-Tech systémique.
Conclusion
La philosophie Low-Tech s’est construite autour d’une vision idéalisée de la réappropriation collective de la technique. Faites de bricolages, de récupération, d’expérimentations, ces technologies en accès libre offrent la perspective d’un monde durable et convivial. Néanmoins ces Low-Tech idéalisées se confrontent à une vision beaucoup plus pragmatique de la réalité : certaines choses qui semblent aujourd’hui essentielles, y compris des choses que l’on pourrait qualifier de Low-Tech, ne peuvent simplement pas être produites en dehors du système industriel. L’artisanat est une seconde voie de la Low-Tech qui porte des promesses très intéressantes, mais ne pourrait pas se substituer à tout ce qui compose notre environnement technique. Les objets les plus basiques du quotidien nécessitent parfois des outils de production colossaux impossibles à reproduire à l’échelle individuelle ou même artisanale. De ces défauts découlent un manque de fiabilité et de sécurité de certaines Low-Tech qui est extrêmement problématique, mais surtout un manque de cohérence globale du projet de société Low-Tech. Face à ce constat, nous ouvrons une voie pour dépasser la vision “bricolage” et artisanale de la Low-Tech, tout en en conservant les principes fondamentaux. Cette voie est pavée de questions que nous ne faisons qu’ébaucher afin d’engager l’ensemble de l’écosystème Low-Tech pour y répondre. Au long de ce cheminement, il devient réellement nécessaire de ne plus considérer les Low-Tech comme des objets techniques finis, mais de les réinsérer dans une société qui permet leur production, de manière durable. C’est la société entière qui doit devenir Low-Tech, et qui a besoin pour cela de concevoir une articulation intelligente entre récupération, bricolage, artisanat mais aussi production de masse. En d’autres termes, il faudrait jongler entre des Low-Tech “bricolées” qui restent indispensables pour se réapproprier l’environnement technique, d’autres plus élaborées qui nécessitent un savoir faire que chacun·e ne pourra s’approprier sans effort important, et enfin des étapes de production nécessitant des moyens plus importants, plus centralisés, mais essentielles aux échelons plus locaux. Il reste maintenant à imaginer et concrétiser ce dernier niveau – que l’on peut ou non vouloir appeler “industrie” – qui doit parvenir à rester sobre, utile et inclusif, et en rupture avec les standards du système capitaliste. Cela nécessitera, bien évidemment, de reconsidérer de manière radicale le rapport entre la société et ses outils de production.
****
Merci à tous·tes les relecteur·ices pour leurs retours critiques et constructifs sur ce texte qui ont permis de grandement améliorer sa qualité.
Pour aller plus loin, voir ce texte de chercheurs découvert après la rédaction de l’article : https://lapenseeecologique.com/6312-2/
Notes et références
(1) [Retour au texte] Disponibles ici : https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Explore
(2) [Retour au texte] Pour une définition plus précise des Low-Tech, voir https://www.lafabriqueecologique.fr/vers-des-technologies-sobres-et-resilientes-pourquoi-et-comment-developper-linnovation-low-tech/, ou encore https://fr.wikipedia.org/wiki/Low-tech
(3) [Retour au texte] Cette vision est notamment développée dans les articles d’Ingénieur·es Engagé·es :, https://ingenieurs-engages.org/2019/09/un-autre-recit-du-progres-la-perspective-low-tech/, https://ingenieurs-engages.org/2020/12/salt2020/
(4) [Retour au texte] Voir : https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2022/09/28/soucieux-d-ecologie-de-jeunes-designers-vont-droit-aux-rebuts_6143551_4497319.html
(5) [Retour au texte] Notamment dans ce type de critique radicale : https://www.partage-le.com/2022/07/23/high-tech-low-tech-anti-tech-le-probleme-de-la-technologie-par-nicolas-casaux/
(6) [Retour au texte] Voir : https://lowtechlab.org/fr/actualites-blog/l-archipel-low-tech-en-france-illustre
(7) [Retour au texte] Présentation du documentaire : https://youtu.be/n9hw2wx-nH8
(8) [Retour au texte] Voir : https://lejournal.cnrs.fr/articles/des-makers-aux-fablabs-la-fabrique-du-changement
(9) [Retour au texte] Voir à ce sujet notre article : https://ingenieurs-engages.org/2020/05/les-tiers-lieux-espaces-de-creation-collaboratifs-focus-sur-les-fablabs/
(10) [Retour au texte] https://www.latelierpaysan.org/
(11) [Retour au texte] Michel Foata-Prestavoine, 2022, Rapport de la Recherche Action. GLOCAL LOW-TECH, « Exploration des voies, méthodes et outils pour un essor systémique de la Low-Tech », disponible sur : https://drive.google.com/file/d/1zxnnNNVwYUJSPBlKofphtPvCxf-EoXUX/view
(12) [Retour au texte] Voir notamment : https://www.eco-industrie-locale.fr/ ; https://www.youtube.com/watch?v=gOs4wLqmRU8
(13) [Retour au texte] https://goodwill-management.com/
(14) [Retour au texte] Voir cet article qui propose de déconstruire la notion de greenwashing : https://ingenieurs-engages.org/2020/05/changer-le-systeme-de-linterieur-1/
(15) [Retour au texte] https://wiki.lowtechlab.org/wiki/L%27%C3%A9olienne
(16) [Retour au texte] https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Chauffe_eau_solaire
(17) [Retour au texte] https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Marmite_norv%C3%A9gienne
(18) [Retour au texte] https://www.cder.dz/vlib/bulletin/pdf/bulletin_027_05.pdf
(19) [Retour au texte] Le R134a est un réfrigérant très commun dans les systèmes de plus de 10 ans (GWP = 1430 kg éqCO2) https://www.abcclim.net/les-gwp-des-fluides.html
(20) [Retour au texte] On trouve dans l’analyse de Carbone4 les ordres de grandeur des efforts nécessaires pour respecter les quotas d’émissions fixés par ces accords http://www.carbone4.com/publication-faire-sa-part/
(21) [Retour au texte] Comme c’est précisé sur le site du ministère : https://www.ecologie.gouv.fr/substances-impact-climatique-fluides-frigorigenes
(22) [Retour au texte] Comme le pointe l’association ZeroWaste France : https://www.zerowastefrance.org/fin-de-vie-refrigerateurs-enjeu-climatique-meconnu/
(23) [Retour au texte] Par exemple, lorsque l’on souhaite concevoir un concentrateur solaire pour 2000 repas par jour en Inde https://www.youtube.com/watch?v=8pOiEhR_BKE
(24) [Retour au texte] https://www.partage-le.com/2020/05/13/bertrand-louart-a-ecouter-certains-ecolos-on-a-en-effet-limpression-que-les-machines-nous-tombent-du-ciel
(25) [Retour au texte] “La Guerre des métaux rares”, Guillaume Pitron, 2019, pp.232-239
(26) [Retour au texte] https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-matiere/dossier/recyclage/chaine-recyclage-produit-produit-passant-dechet
(27) [Retour au texte] « Énergie et Équité », Ivan Illich, 1973
(28) [Retour au texte] Pour vous en convaincre : https://www.youtube.com/watch?v=eXXp9tbOnM0
(29) [Retour au texte] “L’Âge des Low-tech”, Philippe Bihouix, 2014, p.128
(30) [Retour au texte] Comme cela a par exemple été exprimé dans cet article : https://energieetenvironnement.com/2021/01/02/enjeux-materiels-de-la-fabrication-de-velos-dans-un-monde-postcroissance/
(31) [Retour au texte] Voir un exemple ici : https://youtu.be/3ZIQQyn8zX8
(32) [Retour au texte] Sur ces aspects : https://www.proantic.com/magazine/lhistoire-du-miroir-au-mercure/
(33) [Retour au texte] Voir le procédé ici : https://archives.saint-gobain.com/ressource/xxe/levolution-des-procedes-de-fabrication-du-vitrage-depuis-le-xviie-siecle
(34) [Retour au texte] Note : Il semble exister d’autres possibilités de fabrication se passant de plomb. La documentation disponible est trop limitée pour évaluer l’importance exacte de l’utilisation du plomb dans la fabrication des miroirs qui permettrait d’appuyer ou de modérer ce constat.
(35) [Retour au texte] “L’Âge des Low-tech”, Philippe Bihouix, 2014, p.152
(36) [Retour au texte] « La Convivialité », Ivan Illich, 1973
(37) [Retour au texte] Seul le secret défense est peut-être plus compliqué à percer…
(38) [Retour au texte] On notera notamment les réflexions de ce projet sur les moyens de repenser l’attribution de la valeur par un système monétaire qui permettrait de valoriser les pratiques vertueuses.