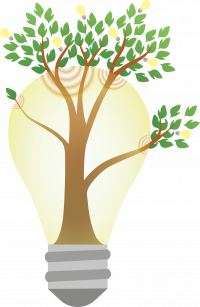Texte : Noam Marseille
Illustrations : Charlène Lemasson
Cet article est le dernier d’une série de 4 articles intitulée « Quelle place pour les ingénieures, les chercheurs et les enseignantes, entre transition et colonisation écologique ? »
Il s’agira ici de décrire les contours de visions du monde alternatives et de comprendre les pistes qu’elles ouvrent pour nos pratiques scientifiques et humaines. Nous examinerons les rôles que nous pourrions y jouer en tant qu’ingénieurs, chercheuses, étudiants ou enseignantes.
Dans la partie V, je propose d’élargir le champ de vision en mobilisant d’autres conceptions du monde et du développement. J’expose d’abord quelques raisons pour lesquelles nous sommes formés et formatés à une conception du monde dominante. Puis j’essaie de dépasser ces verrous à l’aide de l’anthropologie pour présenter quelques visions alternatives comme le buen vivir (Equateur), le swaraj (Inde) et la décroissance (Europe) et leurs points communs.
Dans la partie VI, je recentre les réflexions et les exemples sur l’ingénieur, la chercheuse et l’enseignant. J’entreprends de proposer des pistes concrètes pour dessiner les contours de places et de rôles permettant de retrouver du sens. En me basant sur des recherches en géographie et en sciences sociales, j’essaie de faire le lien entre les mondes étrangers présentés auparavant et nos mondes d’origine, afin d’ouvrir un dialogue porteur de sens en gardant « les pieds sur Terre ». Les alternatives présentées sont majoritairement liées au domaine de l’énergie, mais sont rapprochées de nombreux autres domaines comme l’agroécologie, les Low Tech, les études environnementales ou l’économie écologique.

5ème prise de conscience : plusieurs mondes coexistant apparaissent, quand on apprend à regarder l’autre
En partant de la manière dont nous sommes ou avons été formé.e.s, il est possible de comprendre un peu mieux pourquoi, devant ces constats, nous nous trouvons si souvent démunis. Ce fut en tout cas le cas pour moi, car j’avais l’impression que le monde dans lequel j’évoluais était en déphasage fondamental (pour ne pas dire complètement absurde) par rapport à ce qui me semblait important. Quel sens alors trouver à tout cela ? Commençons d’abord par nous recentrer sur les formations dont nous sommes issu.e.s.
En fait, plusieurs travaux majeurs de sociologie expliquent comment notre système d’éducation mène à une reproduction des hiérarchies sociales de façon apparemment légitime. Pourtant, nous entendons souvent que ce système est « méritocratique », qu’il permet une « égalité des chances », que la réussite scolaire se mesure au mérite de chacun.e, à son travail acharné, à seuls efforts ou à son talent « naturel ». Contre cette idée reçue très fréquemment instrumentalisée, Pierre Bourdieu explicite minutieusement les mécanismes par lesquels les élites sociales sont fabriquées et reproduites à travers le système des classes préparatoires et des Grandes Ecoles dans son ouvrage La Noblesse d’Etat [1]. Ainsi, fondé sur un travail statistique et de terrain impressionnant (durant 30 ans), il expose dans un style implacable comment les plus dotés de capital culturel hérité (contexte familial et acculturation, aide aux devoirs…) réussissent le mieux scolairement. Il lie ensuite ce capital culturel au capital social (position sociale) et au capital économique (pouvoir économique, finances) qui lorsqu’ils sont regroupés donnent leur identité à l’élite sociale dominante. Il expose l’existence de nombreuses « écoles-refuges », pour accueillir et légitimer ceux qui échoueraient scolairement malgré leurs ‘prédispositions’ (écoles privées très onéreuses formant notamment au marketing et autres métiers au fort capital socio-économique). Il déconstruit méthodiquement le mythe du « self-
made man » et démontre aussi que même parmi les « minorités » (fils d’agriculteurs à Polytechnique par exemple), les « élus » se distinguent des autres sur des critères secondaires (autre membre de la famille issu d’une Grande Ecole, comme le grand-père par exemple, prix d’excellence, précocité). Il montre finalement comment à travers la sacralisation du titre (diplôme), l’esprit de corps, l’enfermement sur soi-même et le manque de mixité sociale, une élite qui semble légitime se redistribue l’ensemble des positions de pouvoir économique et politique [1]. Cette lecture m’a personnellement permis de mieux cerner pourquoi j’avais l’impression de me retrouver face à une impasse devant les formations qui m’étaient proposées et les valeurs de compétitivité perdurant dans l’institution (classements, notes, compétition pour les postes ou financements, examens-concours). De même pour les pistes au semblant « vertueux » qui existaient ailleurs à travers des programmes de Développement Durable et des formations à la gouvernance des autres.
En partant de ce point, j’ai eu la chance de pouvoir mettre en pause ma formation pour effectuer un voyage basé sur le volontariat (Workaway), durant lequel j’ai pu rencontrer de nombreux autres mondes. Les projets dans lesquels j’ai travaillé étaient divers, de l’agriculture écologique (permaculture, agroécologie) à la restauration écologique d’une zone humide, de l’enseignement à la préparation de repas en cuisine professionnelle, de la construction écologique à des travaux de plomberie et d’électricité. Ces rencontres ont permis d’ouvrir de nouvelles perspectives, et de sortir des impasses apparentes dans lesquelles je me sentais égaré. Associées à des lectures en anthropologie, sociologie des alternatives, histoire coloniale et post-coloniale, écologie politique et pratique, sciences de la nature et énergétique, j’ai pu finalement avec de nombreuses aides et un support sans faille de mes proches accéder un tant soit peu à d’autres visions du monde. Ces systèmes de valeurs alternatifs sont en fait très nombreux de par le monde, et beaucoup plus riches que je pouvais l’imaginer comme le montre l’exemple suivant.

Le mouvement de rébellion populaire des Zapatista dans l’Etat très défavorisé de Chiapas au Mexique, se souleva le 1er janvier 1994 en réaction à l’accord de libre-échange censé réunir Etats-Unis, Canada et Mexique (ALENA) en se déclarant ouvertement en faveur d’un « changement du monde sans prise de pouvoir », d’une autonomie et notamment une libre détermination des peuples autochtones (droit de décider pour eux-mêmes) et contre le néolibéralisme. Ce mouvement gagna rapidement en importance, et il devint un symbole de l’altermondialisme (faire monde, mais autrement qu’à travers la globalisation et les logiques d’accumulation de profit capitalistes et de dérégulation néolibérales), notamment à travers une déclaration en 1996 selon laquelle « Dans le monde du puissant, il n’y a de place que pour les grands et leurs serviteurs. Dans le monde que nous voulons, il y a place pour tous. Le monde que nous voulons est fait de beaucoup de mondes, tous y ont place. Le monde que nous voulons est un monde dans lequel plusieurs mondes tiennent ». La démarche que je tente de suivre est celle d’une déconstruction constructive. Déconstruire pour comprendre où l’on se trouve et ce que l’on attend de nous, de façon constructive pour aller vers quelque chose qui fait sens pour nous, et y trouver une place de façon consciente.
Certains de ces mondes sont justement décrits par une grande diversité d’auteur.e.s du monde entier dans le livre Pluriverse : A post-development dictionary, constitué de courts textes décrivant en 3 pages chacun des alternatives à notre conception du monde, et du développement [2]. Le mouvement de Buen Vivir en Amérique Latine, de Swaraj en Inde et de Décroissance en Europe y figurent aux côtés de nombreux autres, et permettent ainsi d’ouvrir les imaginaires et les perspectives que nous pouvons avoir [2]. Dans une analyse comparative de ces mouvements, certains points communs ressortent, en contraste avec les visions du développement durable ou de la croissance verte. D’abord, les processus de démocratie directe centrés sur les communautés – ou municipalités – avec des institutions représentatives contrôlées par des institutions locales (contre une démocratie représentative centrée sur les Etats et les entreprises, avec des mesures de transparence). Le cadre économique est lui aussi centré sur les communautés, avec une propriété publique ou collective des moyens de production, une vision holiste orientée vers le bien-être et une auto-suffisance locale pour les besoins essentiels (contre le centrage sur les marchés financiers avec des mesures de soutenabilité, et un accent mis sur la compétitivité et la globalisation économique). En termes de justice sociale et d’équité, il s’agirait d’une redistribution radicale du pouvoir et de l’argent, avec une émancipation des plus faibles pour prendre le contrôle de leurs vies (contre le développement inclusif, et la responsabilité vis-à-vis des plus faibles). Pour les connaissances, la culture et la technologie, des statuts équitables seraient attribués aux différents systèmes de connaissance 1 (scientifique, autochtone, paysans) dans le respect de la diversité culturelle et des spiritualités différentes (contre une focalisation sur les sciences et technologies modernes, quelques concessions aux savoirs traditionnels, et une marginalisation ou mise en spectacle de certaines cultures et spiritualités). A propos de la relation humain-nature, la mise en avant de la valeur intrinsèque de la nature non-humaine et la composition entre humains et non-humains, la nature étant commune (contre un centrage sur l’humain, une soutenabilité instrumentalisée et une nature privatisée, enclose et parfois commune). Enfin, la soutenabilité écologique serait le fondement même et non-négociable de l’existence humaine, avec des limites absolues en termes d’énergie et de matière et un principe de précaution systématique en cas d’incertitude (contre un but central mais pas forcément prépondérant, et une acceptabilité peu claire des limites matérielles et de flux énergétiques) [3].
1 Note d’esprit critique : cela ne revient pas à dire que n’importe quelle croyance doit être mise sur un pied d’égalité avec les savoirs empiriques. D’où l’idée d’équité. Reste ensuite à « situer » ces savoirs, à les « traduire » si besoin, et à choisir ceux qui sont pertinents selon la situation.

On peut remarquer dans ces visions alternatives l’importance accordée au pluralisme des valeurs (plutôt qu’une valeur principalement monétaire, et une grille de lecture technique standardisée) qui permet d’ouvrir des discussions, et de nombreux débats mobilisant une diversité d’agents humains (scientifique, habitant local, experte, fermier, femme, enfant…) et même non-humains (avec l’identité juridique reconnue par exemple au fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande comme au Gange en Inde, qui peuvent maintenant intenter des procès contre certains pollueurs à travers des représentant.e.s [4]). Les anthropologues Philippe Descola (élève de Claude Lévi-Strauss) et l’un de ses élèves Damien Deville proposent une politique de la rencontre, et une écologie relationnelle [5] [6a]. Cette dernière serait basée premièrement sur la reconnaissance assumée de notre propre vulnérabilité : humains comme non-humains ont besoin des autres, de manière différente, et sont donc interdépendants. Ensuite la rencontre avec l’autre : comprendre l’autre pour ce qu’il est vraiment, ce qui ne veut pas dire apprécier l’autre car la relation revient aussi à accepter les antagonismes et les différences. Et enfin la justice, car on peut rencontrer l’autre en le dominant ou en le détruisant, il faut donc pouvoir exercer la justice dans la coexistence [5].
En pratique, cela revient par exemple dans le domaine des sciences et en tant qu’expert à reconnaitre que la science moderne n’est pas la seule valeur qui entre en jeu dans la résolution d’un problème, et donc de reconnaitre un apport irremplaçable de non-experts en science. Plutôt que de juger d’un point de vue technique chaque élément, il s’agit de reconnaître que la science occidentale n’est pas tout, et que la connaissance technique ne justifie pas non plus le pouvoir (technocratie). Par exemple en termes de connaissances précises sur l’environnement les personnes y vivant au quotidien ont sans doute beaucoup à nous apprendre, même si ils ne le formuleront certainement pas dans un langage scientifique.
Ainsi, les peuples aborigènes considérés comme des « sauvages » à l’aune de nos représentations furent massacrés, leurs droits et leurs connaissances ne furent pas reconnus durant la colonisation malgré leur histoire d’au moins 40 000 ans de peuplement en Australie. Cependant, les récents épisodes de méga-feux de forêts depuis 20 ans ont mis en avant l’échec des techniques occidentales de gestion des feux de forêt pour un pays aussi grand et sec que l’Australie. Peu à peu depuis les années 1990, certaines pratiques des peuples aborigènes commencent à être reconnues, et on se rend compte qu’ils avaient élaboré des systèmes très sophistiqués de contrôle des feux pour empêcher que de tels incendies se déroulent. En 2015, une délégation aborigène fut envoyée au nord-ouest pour empêcher les grands incendies, et en quelques années il y eut une baisse considérable des émissions de GES liés aux feux [6b]. Lorsque j’étais en Australie, j’ai entendu parler d’un département spécial créé chez les pompiers et employant ces techniques étroitement liées aux territoires, qui d’ailleurs était saturé de demandes à cause de l’intensité des feux de fin 2019. Ces autres modes de représentation du monde sont donc ici reconnus, de manière intéressée, mais de nombreuses rencontres (écologues, fermiers, anthropologue) m’ont permis d’aller plus loin dans la reconnaissance et la curiosité liée à ces cosmologies différentes. Il s’agit d’une certaine manière de « décoloniser » nos pratiques, nos institutions, nos représentations et nos imaginaires, comme le défend Malcom Ferdinand dans son « écologie décoloniale » [7].
La découverte et la reconnaissance de ces autres mondes offre donc une perspective nouvelle, qui pour ma part remit fortement en question les identités que je m’étais construites. A la fois, une volonté de rejoindre ces mondes si inspirants, et en même temps un sentiment d’étrangeté, et de perte du sentiment d’appartenance. Je propose donc ici d’essayer de réaliser un retour sur soi, et de revenir près de ce qui nous est familier mais enrichis d’un regard nouveau. Finalement, sommes-nous vraiment les maîtres de l’usage des savoirs dont nous disposons ? Nous est-il possible de choisir ? Pour qui et pour quoi voulons-nous travailler ? A-t-on le choix ?

6ème prise de conscience : De retour chez nous, des alternatives existent aussi
Le retour vers les institutions familières, écoles, universités ou entreprises, est l’occasion de reconnaître et d’accepter leurs qualités réelles pour nous (rigueur scientifique, ouverture intellectuelle, fonctionnement associatif, sécurité de l’emploi et du quotidien), sans pour autant être naïf sur leurs grandes faiblesses. Mais à partir des aspects positifs qui « fonctionnent », et grâce aux changements de paradigmes proposés précédemment, il est possible je pense, d’y trouver une place et un rôle qui font sens. De nombreuses études en sciences sociales et politiques permettent en fait de baliser le chemin de ce qui pourrait rentrer dans le cadre d’une « décolonisation des pratiques scientifiques » et d’une réelle transformation écologique. Je vais essayer ici de partager certaines de ces visions (et exemples concrets) qui pourraient être mobilisées dans le cadre de travaux de recherche, d’ingénierie ou d’enseignement.
Le domaine que j’ai le plus étudié est celui de la physique, et plus particulièrement de l’énergétique. La première vision, proposée par les chercheurs Kunze et Becker, est celle des « projets d’énergie renouvelable collectifs et politiquement motivés » (CPE) [8]. En partant comme pour l’EJAtlas de l’approche socio-métabolique (flux énergétiques et économiques : qui bénéficie des projets et qui en pâtit ?), les auteurs définissent quelques critères incontournables pour les CPE. D’abord, un modèle de propriété collectif et partagé, qui garantirait donc une redistribution de la production énergétique et des bénéfices. Ensuite, un mode de décision participatif incluant les communautés
locales notamment, au moyen d’assemblées ou de forums mixtes experts non-experts (par opposition à des décisions prises par des experts techniques ou politiques uniquement) [8]. Une illustration incluant ces deux critères est une alternative proposée à certaines communautés de l’isthme de Tehuantepec au Mexique (voir plus haut) par le Groupe Yansa (coopérative éolienne, assemblée des femmes, assemblée des enfants et propriété collective) [9]. Le dernier critère est celui de la volonté politique explicite, à savoir par exemple la réduction de la consommation énergétique (sobriété, réduction de l’extractivisme), la protection de la biodiversité, l’émancipation de groupes sociaux défavorisés, une meilleure équité.
Des exemples concrets de cela existent à plusieurs échelles. Ils décrivent au niveau municipal le projet de collectif éolien de Machynlleth au pays de Galles (propriété collective, profits utilisés pour la municipalité, baisse de la consommation et suffisance énergétique). Ils évoquent aussi, au niveau d’une grande ville, l’initiative de la « table ronde de l’énergie de Berlin » en 2013 (remunicipalisation du réseau électrique de la ville, approvisionnement 100% renouvelable et participatif, réduction de la consommation totale) qui déboucha sur un referendum en la faveur du projet à 83% mais n’atteignant pas le quorum de 25% de participation (24,2% des habitants avaient voté). Enfin, au niveau régional d’abord, puis national, ils donnent les exemples des coopératives énergétiques professionnelles de Somenergia en Espagne et Retenergie (Enostra) en Italie (mode de décision strictement participatif, production d’électricité et diffusion de valeurs sociales et environnementales fortes, groupes locaux autonomes et forums internes ou publics organisés pour débattre de thèmes variés) [8].

L’autre vision possible que j’ai pu étudier est celle de la « démocratie énergétique », défendue par plusieurs mouvements sociaux, ONG et partis politiques [10]. Cela part de la reconnaissance des enjeux politiques et sociaux de la transition énergétique, et donc de revendications elles aussi politiques liées à la démocratie. Il s’agit notamment du droit à l’énergie (similaire au droit à l’eau potable) en tant que « droit humain fondamental » basé sur un « partage des ressources énergétiques tout en protégeant l’environnement global », et de la justice environnementale (contre un accès privilégié à certaines classes dominantes au détriment d’autres). Les bases sont une réappropriation et un contrôle collectif de l’approvisionnement énergétique (contre un contrôle du marché et d’acteurs privés), une gouvernance participative, un fort contrôle démocratique, une distribution juste des bénéfices sans accumulation privée, et surtout une territorialisation de cet approvisionnement. J’entends par territorialisation l’opposition aux délocalisations comme l’extraction à Bayan Obo des terres rares utilisées en Europe, ou à une perte des identités territoriales comme les revendications des habitants de Corrèze, d’Aveyron ou de Tehuantepec qui s’opposent à l’apparition d’éoliennes imposées par l’extérieur.
Concrètement, les auteurs distinguent trois formes de réalisations pratiques [10]. Premièrement, la décentralisation de l’approvisionnement énergétique avec les « régions énergétiques » en Autriche [11], les nombreuses communautés énergétiques du Royaume-Uni [12] ou les villages solaires du Kenya [13] (par opposition aux centrales éoliennes industrielles, ou centrales à charbon). Ensuite, les coopératives, notamment au Canada, Etats-Unis, Royaume-Uni, Danemark et Allemagne [14] ou avec une remunicipalisation des infrastructures énergétiques comme en Allemagne (ou en France, pour l’eau potable) [15]. Au Mexique, dans la Sierra Norte de Puebla la coopérative Onergia travaille à l’installation de panneaux photovoltaïques avec la grande coopérative de la région, la Tosepa, pour le développement de projets énergétiques autonomes, collectifs et ancrés dans le territoire local avec ses habitants [16]. Enfin, la souveraineté énergétique à l’échelle plutôt nationale (similaire à la souveraineté alimentaire) avec par exemple en Equateur le changement radical de modèle de développement lors de l’élection en 2007 d’un parti défendant le sumak kawsay (buen vivir, « bien vivre » en français). Il s’agit d’une vision du monde basée sur les conceptions autochtones Quechua de relation entre les communautés humaines et les écosystèmes, qui a donné lieu à des changement considérables du fonctionnement du pays, notamment en termes d’approvisionnement énergétique [17a][17b].
On peut aussi penser à l’approche du Shift Project, think-tank présidé par J.M. Jancovici, pour une vision plus pragmatique et quantitative (mais aussi conviviale et participative) des changements liés aux enjeux énergie-climat [18]. Dans d’autres domaines liés aux sciences, des initiatives que nous pouvons évoquer existent aussi. L’agroécologie (agronomie + écologie) dispose déjà d’une forte reconnaissance dans les mondes scientifiques et paysans comme en témoigne l’influence des révolutions agroécologiques en Amérique Latine [19]. Il s’agit d’une vision de l’agronomie qui part des écosystèmes déjà existants qu’il faut d’abord comprendre pour pouvoir ensuite favoriser les interactions qui permettent la production de nourriture en quantité suffisante, sans intrant chimique ajouté. Cela ouvre donc un dialogue entre spécialistes scientifiques et experts du territoire détenteurs de savoirs locaux ou paysans, comme les fermiers, les agriculteurs, et les communautés autochtones traditionnelles [19]. Les Low Tech, aussi inspirées du jugaad indien et notamment défendues en France par l’ingénieur Philippe Bihouix et le Low Tech Lab, sont définies en opposition aux technologies modernes complexes et consommatrices de ressources rares. Elles visent à être utiles, simples, pratiques, peu énergivores, adaptées au contexte local et adaptables aux besoins. Elles favorisent le réemploi, la réparation, le recyclage, mais aussi la participation locale des usagers dans la définition de leurs réels besoins (plutôt qu’en créant ce besoin par la publicité) et le bricolage (plutôt que des produits « boite noire ») [20]. Du côté des sciences sociales, les études environnementales apportent aussi matière à penser, de même que la décroissance ou l’économie écologique qui s’institutionnalisent peu à peu. Des pistes s’offrent aussi à nous en génie civil avec les techniques de construction écologiques mêlant innovations technologiques et savoirs traditionnels (construction en terre-paille, argile, chanvre).

Ces différentes initiatives proposent donc des visions alternatives de l’usage que nous pourrions faire de nos expertises techniques dans des domaines variés. De nombreuses CPE et des mouvements sociaux ayant des convictions fortes et des perceptions du monde différentes ont en réalité vraiment besoin de spécialistes scientifiques pour mettre en pratique ces idées. En recherche comme en ingénierie, de nombreuses (re)découvertes sont à faire pour adapter les dispositifs existants à des conceptions du monde qui nous inspirent et des imaginaires qui nous portent. L’enseignement occupe une place centrale dans la diffusion des idées, des techniques et des savoir-faire qui y sont associés, de même que dans l’apprentissage de la communication et de l’échange avec l’autre. Beaucoup de travail reste à faire, mais le sens qui lui serait donné me paraît maintenant autrement plus inspirant.
Les raisonnements que je propose, les « solutions » que je décris et les rôles que je dessine sont sans nul doute imparfaits, car basés sur mon expérience personnelle forcément réductrice. Je n’ai fait qu’assembler et tenter d’articuler des travaux de recherche divers, venant de domaines très différents dont la subtilité m’a sans aucun doute souvent échappé, tout en espérant que l’on pourrait les exploiter plus en profondeur. J’ai en fait essayé de partager le parcours qui m’a permis de retrouver un sens, les rencontres dont je suis profondément reconnaissant et les lectures qui m’ont porté ces dernières années. Les initiatives pour la suite demanderont beaucoup de travail pour correspondre aux imaginaires qui nous inspirent. Les alternatives que je décris ont aussi de nombreuses imperfections, et nécessiteront beaucoup de débats et d’expériences pour devenir viables à long terme. Mais c’est, pour moi, ce travail qui me semble avoir du sens.
Finalement, de nombreuses pistes s’ouvrent, évoluent et s’adaptent, pour nous permettre de faire monde autrement, de rencontre l’autre et de dialoguer en le respectant. Il ne tient qu’à nous de les suivre.

Cet article est le dernier d’une série de 4 articles intitulée « Quelle place pour les ingénieures, les chercheurs et les enseignantes, entre transition et colonisation écologique ? ». N’hésitez pas à le commenter, à faire des retours et des critiques ici ou par mail à l’auteur noam@crans.org.
Je tiens à remercier particulièrement Charlène Lemasson pour son superbe travail d’illustration et de mise en page de cette série d’articles, ainsi que pour tous les échanges que nous avons eu à ce sujet. J’aimerais aussi remercier les relecteur.ice.s Anne Lecompte, Yannick Deniau, Nicolas et Laura pour leurs précieux conseils. Et surtout l’ensemble des personnes qui m’ont accompagné le long de ce cheminement parmi lesquelles Rachel Hernandez-Cornet, Volny Fages, Sofia Avila, Lisa, Elaïne et Damien, Yasmine, Talia, Audrey, Brit et Chris et bien d’autres.

Cette oeuvre (texte et illustration) est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.
Références
[1] Bourdieu P. (1989) La Noblesse d’Etat – Grandes écoles et esprit de corps. Collection Le sens commun. http://www.leseditionsdeminuit.fr/livre-La_Noblesse_d%E2%80%99%C3%89tat-1961-1-1-0-1.html
[2] Demaria F., Kothari A., Salleh A., Escobar A., Acosta A. et al (2019). Pluriverse: A post-development dictionary. Tulika Books, Creative Commons. https://drive.google.com/file/d/1NEcOUUIcigLfNyonnh3haI3BewSTq4Z9/view
[3] Demaria F., Kothari A., Acosta A. (2014) Buen Vivir, Degrowth and Ecological Swaraj: Alternatives to sustainable development and the Green Economy. Development 57, 362–375 (2014). https://doi.org/10.1057/dev.2015.24
[4] Cailoce L. (2017) Le droit peut-il sauver la nature ?CNRS Le journal. https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-droit-peut-il-sauver-la-nature
[5] Gilbert P. (2020) « La séparation entre nature et culture a favorisé l’hégémonie des imaginaires urbains » – Entretien avec Damien Deville. Le vent se lève. https://lvsl.fr/la-separation-entre-nature-et-culture-a-favorise-lhegemonie-des-imaginaires-urbains-entretien-avec-damien-deville/
[6a] Kempf H. (2020) Philippe Descola : « La nature, ça n’existe pas ».Reporterre. https://reporterre.net/Philippe-Descola-La-nature-ca-n-existe-pas
[6b] Astier M. (2020) Australie : les savoir-faire aborigènes, une solution contre les mégafeux – entretien avec Barbara Glowczewski. Reporterre. https://reporterre.net/Australie-les-savoir-faire-aborigenes-une-solution-contre-les-megafeux
[7] Ferdinand M. (2019) Une Ecologie Décoloniale – Penser l’Ecologie depuis le Monde Caribéen. Edition Seuil, collection Anthropocène.
[8] Kunze C., Becker S. (2015) Collective ownership in renewable energy and opportunities for sustainable degrowth. Sustainability Science, No. 10, pp. 425-437. https://www.researchgate.net/publication/277944560_Collective_ownership_in_renewable_energy_and_opportunities_for_sustainable_degrowth
[9] Avila S. (2017) Contesting energy transitions: wind power and conflicts in the Isthmus of Tehuantepec. Journal of Political Ecology, Vol. 24, No. 1. https://journals.uair.arizona.edu/index.php/JPE/article/view/20979/20568
[10] Naumann M., Becker S. (2017) Energy democracy: Mapping the debate on energy alternatives. Geography Compass, Vol.11, Issue 8. https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gec3.12321
[11] Späth P., Rohrracher H. (2010) ‘Energy regions’: The transformative power of regional discourses on socio-technical futures. Research Policy, Vol. 39, Issue 4, Pages 449-458. https://doi.org/10.1016/j.respol.2010.01.017
[12] Seyfang, G., Park, J. J., & Smith, A. (2013). A thousand flowers blooming? An examination of community energy in the UK. Energy Policy, 61, 977–989. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.06.030
[13] Ulsrud, K., Winther, T., Palit, D., & Rohracher, H. (2015). Village‐level solar power in Africa: Accelerating access to electricity services through a socio‐technical design in Kenya. Energy Research & Social Science, 5, 34–44. https://doi.org/10.1016/j.erss.2014.12.009
[14] Viardot E. (2013) The role of cooperatives in overcoming the barriers to adoption of renewable energy. Energy policy, 73, 756-754. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.08.034
[15] Hall D. (2012) Re-municipalisation in the early twenty-first century: water in France and energy in Germany. International Review of Applied Economics, Vol. 27, Issue 2, pp. 193-214. https://doi.org/10.1080/02692171.2012.754844
[16] Bien E. (12/2018) ‘Light for everyone’: Indigenous youth mount a solar-powered resistance. Mongabay Series – Indigenous Peoples and Conservation. https://news.mongabay.com/2018/12/light-for-everyone-indigenous-youth-mount-a-solar-powered-resistance/
[17a] Sovacool, B. K., & Scarpaci, J. (2016). Energy justice and the contested petroleum politics of stranded assets: Policy insights from the Yasuní‐ITT Initiative in Ecuador. Energy Policy, 95, 158–171.https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.04.045
[17b] Fitz‐Henry, E. (2015). Greening the petrochemical state: Between energy sovereignty and Sumak Kawsay in coastal Ecuador. The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, 20(2), 264–284. https://doi.org/10.1111/jlca.12148
[18] site web du Shift Project : https://theshiftproject.org/ ; plan de transformation de l’économie : https://theshiftproject.org/crises-climat%e2%80%89-plan-de-transformation-de-leconomie-francaise/
[19] Altieri, M., & Toledo, V. (2011). The agroecological revolution in Latin America: Rescuing nature, ensuring food sovereignty and empowering peasants. Journal of Peasant Studies, 38(3), 587–612. https://doi.org/10.1080/03066150.2011.582947
[20] Bihouix P. (2014) L’Âge des low tech. Vers une civilisation techniquement soutenable. Edition Anthropocène Seuil. https://deconsommateur.com/age-des-low-tech-bihouix/