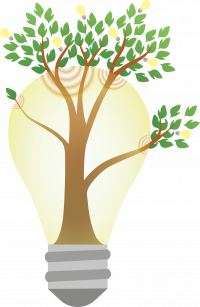Questions-réponses avec Marion R, entrepreneuse en CAE
Cet article est issu d’un café débat du 15/10/2021 intitulé “L’Entrepreneuriat en mode Low Tech”. Les questions ont été posées par les participant·es, et retranscrites dans ce témoignage.
“Je n’arrivais pas à trouver de boulot salarié qui m’intéressait. Finalement, la seule solution c’était de créer mon boulot.”
Franchir le pas
“Ce qui m’a débloqué, c’est quand j’ai compris qu’en fait c’est tout bête : tu lances ton activité, t’es au chômage pendant deux ans, Pôle Emploi est au courant que tu te lances et que tu travailles petit à petit. Ça prend du temps, et c’est normal.”
Bonjour Marion, premièrement merci à toi de nous partager ton expérience d’entrepreneuriat Low-Tech !
MR : Bonjour, et merci de m’en donner l’opportunité ! En introduction, je voudrais quand même préciser mon positionnement par rapport aux Low-Tech. On parle des Low-Tech parce que la philosophie m’inspire beaucoup, mais dans ma pratique au quotidien, on est assez éloignés des choses que fait classiquement le Low-Tech Lab, par exemple.
Pourrais-tu commencer par nous parler de ton parcours ? Qu’est-ce qui t’a mené sur la voie de l’entrepreneuriat, par quelles étapes es-tu passée et où en es-tu aujourd’hui ?
MR : J’ai un diplôme d’ingénieur en physique-chimie, plutôt côté matériaux. Après mon diplôme, j’ai fait une thèse dans l’agro-alimentaire, sur la texture du yaourt, qui m’a passionnée. Pendant ma thèse, je me suis pris le mur du changement climatique, je me suis beaucoup renseignée, et je me suis rendu compte que c’était très grave. J’ai réalisé que ce n’était plus possible de faire juste ce qui m’intéresse, et qu’il fallait que j’utilise mes connaissances pour travailler à autre chose qu’à la nourriture industrielle. Donc à la suite, j’ai voulu rebifurquer pour aller plus dans les matériaux.
Je me suis retrouvée au chômage pendant 9 mois, en essayant de trouver quelque chose qui fasse du sens. En 2020, j’ai fait un post-doc, c’est-à-dire un contrat court de recherche, qui a duré un an. Ça ne m’a pas non plus convaincue. Dans le domaine de la recherche, il y a de gros biais, les financements sont fléchés vers des projets qui ont une certaine vision du progrès. Donc pour moi, la recherche publique et l’entreprise, ça ne collait pas. Je n’arrivais pas à trouver de boulot salarié qui m’intéressait. Finalement, la seule solution c’était de créer mon boulot.
En fin de thèse, fin 2018, on a eu des conférences sur l’entrepreneuriat dans mon université. Je sentais bien qu’il y avait quelque chose là-dedans. À ce moment je ne m’y voyais pas du tout, je ne trouvais pas de projet intéressant. J’ai fini par accepter que j’avais pas de projet, mais des compétences à valoriser en science des matériaux. J’essaie donc de créer un laboratoire de recherche et développement pour développer de nouveaux matériaux à partir de matière organique. L’idée, c’est de venir en soutien à des designers qui ont ce genre de projet (il y en a pas mal), mais qui n’ont pas forcément les connaissances scientifiques.
J’ai lancé ça en janvier cette année. Ça fait 10 mois, pourtant je suis encore au début. J’ai du mal à définir l’activité, en termes d’offre, de modèle économique… Je sais ce que je veux faire au quotidien, mais le cadre autour pour rendre l’activité viable n’est pas clair.
Et pour te lancer dans l’entrepreneuriat, quelles actions et démarches as-tu entreprises ? Est-ce que tu t’es formée, par exemple ?
MR : Ce qui a beaucoup joué pour moi, c’est de parler à des gens. L’article d’IE sur l’entrepreneuriat m’a beaucoup fait réfléchir. Le témoignage de M. & Mme Recyclage m’a aussi influencée. Ils sont ingénieurs, leur emploi ne leur convenait pas et ils se sont dit : “Rien à faire, on va être indépendants et valoriser nos années d’étude”. Les emplois qu’on nous offre sont nuls, mais nos études ont un intérêt pour la société.
Ce qui m’a fait basculer, c’est aussi d’avoir au téléphone quelqu’un qui avait fait la même école que moi. Son entreprise s’appelle Projet Celsius, et propose des formations sur les enjeux climatiques en école d’ingénieurs avec des formats nouveaux, plus vivants. Ce qui m’a débloqué, c’est quand, en parlant avec lui, j’ai compris qu’en fait c’est tout bête : tu lances ton activité, t’es au chômage pendant deux ans, Pôle Emploi est au courant que tu te lances, et que tu travailles petit à petit. Ça prend du temps, et c’est normal.
En termes de formation, j’ai rejoint une Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE) fin février cette année. La CAE c’est un moyen d’être micro-entrepreneur, de faire sa propre activité, mais en collectif. Il y a un accompagnement juridique, et ils nous forment sur des trucs basiques mais importants : qu’est ce que tu offres, qu’est-ce que tu vends, comment tu parles à tes clients, comment tu les trouves… C’est pas du tout fini, je continue à être formée et à beaucoup apprendre sur ces sujets. Je suis dans deux dispositifs d’accompagnement. Premièrement, il y a le réseau des Étudiants-Entrepreneurs, qui me permet d’avoir accès à un laboratoire à bas coût. Ensuite, j’ai aussi le programme Entrepreneurs for Good de l’association Live for Good, qui s’adresse à des personnes de moins de 30 ans, avec un projet entrepreneurial à visée environnementale ou sociale. Ça vient de commencer, mais je pense que ça va être bien en terme d’accompagnement.
En tout cas, ce qu’il faut savoir c’est que si vous vous lancez là-dedans, vous êtes pas seul·es. Il y a plein de choses gratuites dans les CCI, et un tas de dispositifs de la Start-Up Nation où vous pouvez glaner des connaissances. C’est normal d’apprendre sur le tas pour lancer votre projet, et personne ne s’attend à ce que vous sachiez tout avant de commencer. Un autre conseil que j’ai beaucoup entendu, et pas trop suivi (par manque d’opportunité plus que par envie), c’est de ne pas se lancer seul. Tout seul, un projet peut sembler irréalisable, alors que quand on est au moins deux, ça motive pour le porter.
L’entrepreneuriat devient plus complexe si l’on souhaite vendre un produit, plutôt qu’un service, non ?
MR : C’est sûr que c’est beaucoup plus simple de vendre un service, parce que tu n’as pas de logistique, trouver l’usine ou sera produit l’objet, …. C’est pour ça que personnellement j’ai plutôt pris ce créneau. Après, mon but c’est de travailler avec des designers qui eux vont devoir faire toutes ces tâches, donc il faut en tenir compte tout de même.
L’entrepreneuriat paraît difficilement accessible. Comment as-tu franchi le pas ?
MR : C’était d’abord ce déclic chômage, de me dire que j’avais le droit d’essayer et que Pôle Emploi pouvait financer cette période de lancement dans l’inconnu, et que tout ça était acceptable et pratiqué par la majorité des entrepreneurs.
Ce qui a peut-être joué aussi c’est d’échanger avec Jibé, qui est fan des CAE, très actif dans le milieu militant écolo à Strasbourg, où j’habite. À l’époque où j’étais en post-doc, il tannait tout le monde pour dire que c’était possible de faire ce qu’on sait faire en indépendant, et ainsi se dégager du temps pour militer. Son discours a un peu évolué, comme on peut le voir dans son entretien sur l’article consacré aux CAE.
Au début, je me disais que mon idée n’allait pas avec le modèle CAE, parce que c’était de monter un labo, ce qui n’a pas grand chose à voir avec les autres entrepreneurs en CAE. Personne ne fait de choses en lien avec la science dans ma coopérative, mais au final il n’y a pas de profil type. C’est juste un bon moyen de faire un test d’activité. Tu ne crées pas d’entreprise, tu ne déposes pas de statuts ni rien, tu fais ta vie. Si tu n’engages pas de gros frais, la seule chose que tu risques c’est de perdre du temps. Pour l’instant, je fais des ateliers de sensibilisation pour pouvoir payer les activités R&D. Si ça marche pas, tant pis, je me serai amusée, j’aurai tenté. Mais je trouvais vraiment trop intéressant de tenter de faire des matières à partir de déchets pour aller faire autre chose. Si ça marche pas je changerai sans doute de secteur, car il n’y a pas d’emploi salarié qui m’intéresse dans ce domaine.
La Low-Tech face à la Start-Up Nation
“Quand on entreprend dans ce domaine, on a en réalité deux projets : un qui est le cœur de ce qu’on a envie de faire, et le deuxième qui est de construire le pendant économique pour que ça marche, en faisant le moins de compromis possibles.”
On voit beaucoup de personnes qui ont une démarche pas du tout engagée dans l’entrepreneuriat, avec justement cet esprit Start-Up Nation, et essayer de vendre quelque chose de pas forcément utile… Est-ce que tu ne t’es pas sentie en décalage par rapport à la vision dominante de l’entrepreneuriat ?
MR : Je me suis souvent sentie en décalage, c’est sûr. Mais ce qu’il faut comprendre c’est qu’il y a plein de structures. L’écosystème n’est pas homogène. Ce qui me sauve, c’est l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), dont ma CAE fait partie. Là-dedans, je trouve des gens qui sont sur la même longueur d’onde que moi. On est vraiment en phase avec la responsable de ma coopérative, par exemple, elle est investie dans la résilience alimentaire et on parle de décroissance.
La Start-Up Nation pure et dure, je l’ai rencontrée quand j’ai participé à un “Start-Up week-end”. J’ai fait ça parce que je cherchais quelqu’un pour m’associer. J’ai passé un très mauvais week-end au final, j’étais pas du tout dans le même monde que les autres participants. Les projets sur lesquels on a tous travaillé, on ne pourrait même pas dire que c’était inutile parce que ça pourrait se vendre, mais ça avait zéro valeur sociétale. J’ai vraiment eu du mal. Donc maintenant je m’en tiens loin. Là, c’était Alsace Digitale, c’est le milieu de la tech’, et je n’ai pas encore trouvé d’endroit où on s’intéresse aux tech’ décroissantes.
L’accompagnement Live for Good, c’est un système de stage, et c’est aussi dans l’ESS. Mais même là, y a quand même un peu ce truc de créer son activité sans remettre trop de choses en question dans le système économique. Je n’ai pas trouvé l’esprit très alternatif ou décroissant, mais au moins, il y avait des gens avec qui je pouvais en parler.
Par exemple, j’ai croisé une personne qui faisait un logiciel pour aider les agriculteurs en circuit court, car ils perdent beaucoup de temps sur excel. Il est hyper engagé, il monte des tiers lieux alternatifs. C’est cool de pouvoir trouver des alliés, qui sont très critiques du système actuel, pour pouvoir discuter de ces choses là. Ce n’est pas très surprenant que Live for Good soit assez conventionnel, Le gars qui a fondé l’association est le numéro deux de Microsoft, ce ne sont pas des gens très alternatifs, même s’il y a des belles valeurs humaines derrière. C’est déjà mieux que la plupart des dispositifs pour start-up.
En parlant d’ESS, est-ce que selon toi la Low-Tech est capable d’être compétitive avec ce qui n’est pas Low Tech ? Étant donné que c’est moins sur-optimisé, que c’est pas fabriqué en Chine, ça risque de mener à des produits plus chers que les autres… Comment on peut croiser écologie et social avec la Low-Tech ?
MR : Dans le Low-Tech, ce qui est intéressant c’est que le modèle économique qui va avec est à construire, et que c’est tout un écosystème en construction. La réponse n’est pas donnée. Les structures qui se professionnalisent ont tendance à valoriser la formation. C’est-à-dire qu’elles ne vont pas apporter des produits tout faits, mais proposer des formations à l’autoconstruction de poêle de masse, ou de fours solaires par exemple.
Sur ce sujet, les enquêtes du Low-Tech Lab sont hyper intéressantes. Elles sont très très poussées dans la démarche que les gens ont eu, la manière dont ils ont construit leur autonomie, leurs modèles économiques… Il y a aussi l’association OseOns, qui est dans cette réflexion de quel système économique pour les Low-Tech, comment on favorise leur essor, et comment on vit des Low-Tech.
Quand on entreprend dans ce domaine, on a en réalité deux projets : un qui est le cœur de ce qu’on a envie de faire, et le deuxième qui est de construire le pendant économique pour que ça marche, en faisant le moins de compromis possibles. Il faut arriver à garder l’esprit Low-Tech tout en payant ses factures et en se rémunérant à la hauteur de ses besoins.
On parle d’entreprise, mais il y a aussi des gens qui montent un projet plutôt associatif. Quelle est la différence ?
MR : Pour moi, monter une association, c’est déjà de l’entrepreneuriat. Il y a des gens qui font ça en parallèle de leur activité professionnelle, en s’appuyant sur l’aide de bénévoles, en espérant que ça puisse se lancer un jour. L’écosystème Start-up de territoires accompagne plein de projets comme ça, et les fondateurs finissent souvent par se faire salarier par l’association. C’est juste juridiquement un peu différent, et donc selon les projets une association est plus adaptée qu’une entreprise, notamment si son activité repose pas mal sur les subventions. Les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) sont un modèle un peu hybride très intéressant, dans lequel le bénévolat est possible, mais elles sont plus compliquées à mettre en place qu’une association ou une société classique.
Entrepreneuriat et Recherche
“Hors de mon domaine d’expertise, j’ai été très impressionnée par la confiance que m’accordent les gens, et l’aura qu’ils me donnent.”
Tu es passée par un doctorat, et par le milieu de la recherche, mais est-ce que ton activité entrepreneuriale te permet de continuer à être reconnue par cette communauté ?
MR : Pour l’instant, je ne sais pas si je continue à avoir une crédibilité dans le monde scientifique. Mon projet est à l’interface entre les designers et la science. Quand je suis allé les voir, ils m’ont pris vachement au sérieux, alors que j’étais traitée encore comme un bébé en post-doc. Hors de mon domaine d’expertise, j’ai été très impressionnée par la confiance que m’accordent les gens, et l’aura qu’ils me donnent.
Dans ma communauté scientifique, je n’ai pas vraiment reparlé à des gens. J’ai juste eu une expérience positive en échangeant avec une chercheuse du CNRS (où je loue un labo), qui n’a pas trouvé mon projet farfelu, et qui était au contraire intéressée. Ça m’a rassuré de savoir que j’étais encore dans le coup. Mon domaine, c’est la recherche appliquée dans les matériaux. La mode est aux nanomatériaux, aux trucs précis, hyper bien structurés au niveau moléculaire… Moi je dis clairement que mon but c’est la Low-Tech, donc de faire des manips grossières avec des matériaux un peu nazes, mais biodégradables.
Je ne suis pas à ce stade ou j’ai un truc établi, mais ça m’a rassuré de savoir que ce que je fais est entendable par des personnes de mon secteur. J’aimerai bien pouvoir me lancer dans un projet de recherche, en collaboration avec d’autres labos et des entreprises. Ce serait une véritable validation par mes pairs, mais je n’ai pas encore creusé.
Et selon toi, le doctorat est un avantage pour ce type de projet ?
Il y a des réseaux pour accompagner les doctorants, et des aides comme i-PhD de la BPI. Je ne connaissais pas, mais j’aurais bien aimé les connaître lorsque j’ai démarré. Dans des CAE spécialisés en recherche comme CoopEtic Recherche, tu peux avoir les crédits d’impôt recherche comme moyen de financement pour 30% de ton temps de travail, ce qui est génial.
Il y a aussi d’autres voies de recherche participative et indépendante aussi, non ?
MR : J’ai assisté à une conférence en ligne sur ce que ses acteurs appellent “le tiers secteur de la recherche”. Ça existe, mais ça a l’air de plus concerner les sciences sociales que les sciences appliquées. Il y a un réseau qui s’appelle Alliss, les membres font de la recherche hors laboratoire, et travaillent sur l’interface science société, sur les sciences participatives. Suite à cette conférence, je n’ai pas encore trouvé ma place là-dedans, ni la bonne articulation avec ces gens-là.
La question de la précarité
“Financièrement, c’est pareil que quand j’étais au chômage [en fin de thèse], sauf que ma mentalité est complètement différente parce que je suis dans l’action.”
Et est-ce que ça n’induit pas une sorte de précarité économique ? Est-ce que tu dois engager des frais personnels ?
MR : Le chômage me permet largement de vivre. J’ai un système léger de frais parce que la location de labo ne coûte pas très cher en tant qu’étudiante-entrepreneuse. J’ai pas mal de facilités, et je n’ai pas encore dû passer par cette étape où j’ai eu à chercher des financements. C’est pourtant une étape classique de l’entrepreneuriat.
Financièrement, c’est pareil que quand j’étais au chômage en 2019, sauf que ma mentalité est complètement différente parce que je suis dans l’action. J’ai de la chance, pour moi ça n’est pas précaire, mais j’utilise mes droits au chômage. Lorsqu’ils seront épuisés, il faudra potentiellement que je trouve quelque chose très rapidement. Je ne cherche pas du tout d’emploi à côté, pas en recherche active en tout cas. J’ai quelques alertes qui sont restées, mais depuis janvier rien vu passer qui aurait pu me faire dévier de mon projet.
Ne pourrais-tu pas répondre à des appels à projets et chercher des subventions pour démarrer ? Il y a quand même des sous à aller chercher à droite à gauche ?
MR : C’est ce qui se fait classiquement. Les subventions permettent d’avoir de l’argent qu’il ne faut pas rembourser, ce qui est vraiment un avantage. En fait, j’ai un petit fichier excel où je liste ces possibilités, auxquelles je prévois de candidater un jour, je ne l’ai pas encore fait. Mais mon mode de fonctionnement actuel fait que, si je fais deux ateliers dans le mois, je paie les factures de l’activité, et Pôle Emploi fait le reste. Dans l’entrepreneuriat, c’est admis que je ne me rémunère pas tant que je n’ai pas de chiffre d’affaire.
Donc je n’ai pas encore pris le temps et l’effort de faire des dossiers de subventions, vu que pour le moment je n’en ai pas besoin. La seule subvention qui est relativement rapide et facile à avoir, c’est l’aide à l’entrepreneuriat des jeunes de la région Grand Est, qui va me permettre de financer les premières manips en laboratoire.
On a parfois l’impression que dans le monde de l’ESS c’est un peu tabou de gagner de l’argent, mais est-ce que c’est vraiment mal ? Par exemple, si on a un prêt à rembourser, un enfant à charge, il faut quand même vivre…
MR : Je ne pense pas que ça soit mal de gagner de l’argent. Je n’ai pas de prêt, mais un loyer, de la nourriture, etc. Donc j’ai besoin de me rémunérer. J’ai rencontré une fille radicale qui construit son modèle entrepreneurial dans la construction Low-Tech sur le troc. C’est-à-dire qu’elle échange ses services contre un hébergement, de la nourriture, … Je n’ai pas atteint ce stade, et je ne pense pas l’atteindre.
C’est normal de vouloir vivre, et pour l’instant, vivre c’est gagner de l’argent.
Il y a sans doute des aménagements possibles. Peut-être que si l’argent n’est pas en euros mais en est en monnaie locale, ou si l’agriculteur me paie en légumes pour le service que je lui rends, ça me permet aussi de vivre. À plus forte raison si tu as des personnes à charge, c’est normal de vouloir gagner de l’argent. Sur IE, il y eu un article partagé sur une boulangerie coopérative qui avait testé le salaire libre, les gens décidaient ensemble de combien ils allaient être payés. Un des employés avait besoin de plus d’argent car ses enfants faisaient des études. Au final, l’expérience avait conduit à des tensions, ça n’avait pas forcément bien marché, mais j’avais trouvé ça hyper intéressant. Améliorer notre système économique, ça demande de repenser ce qu’on sait du salariat.
La vie d’entrepreneure
“Ce dont je ne me rendais pas compte avant de me lancer, c’est que le côté entrepreneurial prend énormément de temps : définir son offre, trouver des gens à qui la vendre, réfléchir à comment ça va pouvoir marcher…”
Concrètement, l’activité d’entrepreneur peut être assez difficile à imaginer. Est-ce que tu peux par exemple nous expliquer sur quoi tu passes du temps, au quotidien ?
MR : Pour l’instant, ma grosse déception est de passer très peu de temps au laboratoire. J’arrive pas trop à y aller pour avancer sur la partie scientifique. Le temps que je passe, c’est essentiellement à contacter des gens, parler à des gens de la mairie, de la région, des designers, des gens qui font des choses similaires… Il y a également la partie ateliers de sensibilisation (notamment de fresques du climat) qui me prend du temps, car il faut trouver les clients, préparer et faire les ateliers.
Je ne suis pas une grosse travailleuse. Les entrepreneurs qui font des grosses journées et 70h par semaine, ça me laisse admirative, mais concrètement je ne sais pas ce qu’ils font. Je fais plutôt du 9h30 – 18h.
Ça varie beaucoup en terme de contenu, c’est jamais la même chose. Mais la triste conclusion, c’est que quand chaque lundi je regarde ce que j’ai a faire, je me dis que c’est pas encore cette semaine que je vais avancer dans mes manips au labo.
Ce dont je ne me rendais pas compte avant de me lancer, c’est que le côté entrepreneurial prend énormément de temps : définir son offre, trouver des gens à qui la vendre, réfléchir à comment ça va pouvoir marcher, mettre des mots sur des idées, faire de la communication… En CAE, le contrat de démarrage de l’activité, le Contrat d’Aide au Projet d’Entreprise, qui ne permet pas de se rémunérer, dure 8 mois et est renouvelable jusqu’à 24 mois au total. Je trouvais ça très long en arrivant, mais après 8 mois je comprends que ce n’est pas du luxe.
Le fait d’échanger avec d’autres est donc un point clé ?
MR : Pour moi, le réseau est très important, et les gens sont très ouverts quand je les aborde avec mon projet. Il ne faut pas hésiter à aller parler à des gens passionnés, ils sont en général très disponibles pour donner des détails sur ce qu’ils font, et filer des conseils et des bons tuyaux. J’ai l’impression que la formation à l’entrepreneuriat se fait beaucoup en cherchant des retours d’expériences d’autres entrepreneurs.
Le statut d’entrepreneur est admiré dans la société, notamment avec la culture “start-up” nation, où chacun doit être entrepreneur. C’est un peu hypocrite, parce que les entrepreneurs vivent souvent dans les premières années sur le chômage, et donc en quelque sorte au crochet de la société, tout comme les autres chômeurs que l’on méprise et à qui on demande de “traverser la rue”.
L’entrepreneuriat comme débouché professionnel
“En tant qu’ingénieur·e engagé·e, tu as l’impression d’essayer de changer le monde de façon active. C’est gratifiant de te dire que tu tentes ta chance.”
À ton avis, est-il possible de se lancer dès la fin de l’école d’ingénieurs, ou faut-il une première expérience professionnelle auparavant ?
MR : Le gros problème, c’est qu’en sortie d’école, on n’a pas le chômage ni le RSA. Les gens que je connais qui font ça, ils font un petit boulot à côté, ce qui est plus difficile.
À part ces considérations financières, le problème vient de nous-même, on se dit qu’on n’est pas capable et qu’il faut qu’on ait de l’expérience. Moi aussi, j’ai un certain syndrôme de l’imposteur, mais il ne faut pas se laisser faire.
Pour se lancer en sortie d’école, il suffit de lire le témoignage de M. & Mme Recyclage (cf supra), ils ont juste fait une belle expérience au Népal, et j’ai l’impression que ça a marché pour eux, de pas aller dans une entreprise.
Je connais des personnes qui se disent ce genre de choses, qu’il faut passer 5 ans dans un grand groupe, mais en fait c’est des barrières qu’on se pose à nous même. Peut-être qu’en allant en entreprise, on comprend un peu mieux le monde économique et ses contraintes, et encore. Mais il faut aussi en subir les côtés repoussants. Selon moi il n’y a pas besoin d’expérience professionnelle préalable, le seul frein en sortie d’étude pouvant être les considérations financières, qui sont tout aussi importantes.
Mais au final, dans un parcours professionnel, le fait d’entreprendre ne risque-t-il pas d’être une sorte de perte de temps, dans laquelle on aura mis sa vie en pause ?
MR : Je pense pas que se lancer dans un projet entrepreneurial, ce soit mettre sa vie en pause. C’est sûr que pour acheter un appartement, ce n’est pas l’idéal, parce que les banques ne font pas de prêts quand on est au chômage. Mais autrement, je dirais que ce n’est pas pire que de faire deux ans de CDI dans une boite, où on bosse à fond avec plus beaucoup de vie sociale à côté. Surtout si on fait une reconversion derrière. En fait, c’est même le contraire, je me sens beaucoup plus libre, je pense que c’est vraiment une expérience très enrichissante autant personnellement que professionnellement. J’arrive à continuer mes loisirs comme quand j’étais salariée. Et puis, même si le projet n’aboutit pas, l’expérience entrepreneuriale reste très valorisée dans un parcours professionnel.
Donc selon toi, ce serait une voie intéressante pour les ingénieur·es engagé·es ?
MR : Je pense que ça vaut au moins le coup d’y penser. On peut faire l’exercice de se demander, avec toutes ces études qu’on a faites, qu’est ce qu’on a acquis, et est-ce qu’on arriverait pas à vendre ces compétences pour avoir le choix de ses missions.
On gagne de la liberté. Je dis ça en étant au chômage, ce qui est ironique. Je ne suis pas arrivée au moment où il faut que je paie mon loyer en travaillant avec des gens avec qui je ne suis pas en accord, donc je reste sans doute naïve.
Mais en tant qu’ingénieur·e engagé·e, tu as l’impression d’essayer de changer le monde de façon active. C’est gratifiant de se dire que je tente ma chance, et que si ça marche pas j’irai élever des chèvres dans le Larzac. Parce que l’issue d’un projet raté, ça peut aussi être de se mettre un peu en marge de la société, vu que les problèmes du système économique dominant et du salariat ne se sont pas résolus entre temps. On verra le temps venu.
****
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.
Propos retranscrits par Nicolas B. pour le projet Livre d’Ingénieur·es Engagé·es
Merci à Marion pour le partage de son expérience lors du café-débat et sa relecture consciencieuse de l’article. Merci également aux relecteur·ices attentif·ves du projet Livre.