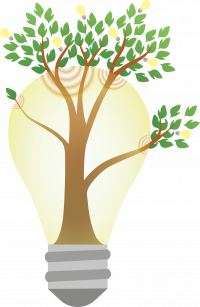Ingénieur·e engagé·e en entreprise : quelle marge de manœuvre pour agir ?
Cet article fait partie d’une série traitant sur les leviers d’action de l’ingénieur·e au sein du système, dont les réflexions ont été initiées lors du café-débat ayant eu lieu sur le Discord Ingénieurs Engagés le 09/04/2020.
Article 2 : Ingénieur·e engagé·e en entreprise – approche stratégique d’une posture dissonante
Article 3 : Ingénieur·e engagé·e en entreprise : quelle marge de manœuvre pour agir ?
Article 4 : Sortir de la voie royale
Auteur : Nicolas B
Relecture : Groupe Montrer les Possibles
Introduction
Dans l’article précédent, plusieurs postures sont proposées pour une action stratégique des ingénieur·es engagé·es au sein des entreprises. L’objectif de celui-ci est de rentrer dans le détail de ces postures et des actions qu’il est possible de faire dans chacune d’entre elles. Il n’a pas vocation à être prescriptif, et il revient à chacun·e de se positionner et de choisir à quel niveau agir. Nous avions distingué deux principales logiques qui sont agir avec, et agir contre l’entreprise. Au sein de ces logiques, il est possible d’agir dans son rôle ou d’agir hors de son rôle.
Agir en synergie avec l’entreprise
Lorsque l’on discute du rôle des entreprises dans la transition écologique, il est courant d’entendre que l’on ne peut régler un problème avec les mêmes modes de pensée qui ont conduit à ce problème. [1] C’est pour cela qu’il semble de plus en plus crédible que la solution aux dégâts causés par le progrès technologique ne soient pas à attendre de ce même progrès. De même, peut-on vraiment s’en remettre aux plus grosses entreprises pour s’attaquer aux défis environnementaux de notre siècle alors que celles-ci causent également le plus de dommages sur cet environnement ? Cependant, une vision moins manichéenne du capitalisme permet de reconnaître le potentiel d’action gigantesque que permet une grande entreprise (pour peu, bien entendu, qu’il y ait un bénéfice à en retirer).
Les petits pas, ça suffit pas…
…mais ça peut être utile quand même
Nous avons largement développé dans de précédents articles en quoi la mission de l’entreprise, poursuivant des intérêts privés, s’oppose plus ou moins ouvertement à l’intérêt collectif [3]. Néanmoins, tous les “petits pas” sont-ils à rejeter ? Même si les slogans des marches pour le climat clament avec ferveur que ceux-ci ne suffisent pas, cela ne signifie pas qu’ils sont inutiles dans l’absolu. Une posture peut être de placer son énergie dans ces petits pas pour essayer tant bien que mal de faire pencher la barque du bon côté. Il ne s’agit pas de renoncer à promouvoir une durabilité forte, mais plutôt de considérer que celle-ci ne peut advenir par une rupture brutale avec le monde actuel. Les ingénieur·es sont des pièces idéales pour avancer sur tous les chantiers qui semblent aujourd’hui indispensables et pourtant trop lents. Peut-on réellement se passer, à l’heure où les entreprises dominent le monde, de leur puissance d’investissement et de travail pour entreprendre une transition planétaire ? Certes, seules les activités rentables peuvent bénéficier de cette force de frappe ; Mais si celles-ci participent à un projet global qui semble pertinent, pourquoi ne pas y contribuer ? Il ne faut pas oublier qu’à l’heure actuelle, ce sont les acteurs privés qui s’accaparent la quasi-totalité des compétences d’ingénierie, et de même que le colibri ne peut éteindre l’incendie, l’ingénieur·e seul·e ne peut arrêter la machine. En tant qu’individu [4], peut-on, et doit-on réellement porter sur ses épaules le manque de cohérence généralisé du système productif ? Si l’on trouve une place au sein de ce système qui fait avancer la méga-machine dans le bon sens, ne serait-ce que d’un millimètre, alors ce sera déjà mieux qu’une écrasante majorité des emplois salariés. Il faudra néanmoins pour cela faire des concessions sur une partie des questionnements qui poussent à la perte de sens et en un sens, assumer que la fin – pour quoi ? – justifie les moyens, et notamment de fermer les yeux sur les actes discutables de son employeur – pour qui ? –
Agir dans son rôle au sein de l’entreprise
Agir dans son rôle d’ingénieur·e correspond à trouver du sens en faisant exactement ce que l’entreprise attend de soi. Comme nous allons le voir, cela ne s’oppose pas nécessairement à défendre une vision forte de la durabilité. En restant dans son rôle, il y a également plusieurs possibilités d’agir selon ses valeurs. Nous détaillerons par la suite deux principales postures : Avoir un emploi utile, et agir selon une éthique personnelle forte.
Un emploi d’ingénieur en entreprise peut-il être utile ?
Nous défendons dans cette partie qu’un emploi d’ingénieur peut être utile, y compris en défendant des valeurs socio-environnementales fortes, même si tout porte à croire le contraire. Un emploi peut être utile à plusieurs titres. De manière évidente, il peut être utile dans ses missions à proprement parler, c’est à dire utile pour la société, mais il peut également être utile pour un autre objectif personnel, c’est à dire utile pour soi.
Être utile pour la société.
Les missions que l’on peut estimer utiles sont souvent liées au secteur de l’environnement ou de la transition énergétique, que ça soit dans l’aspect technique ou managérial. Dans l’aspect technique, on pourra par exemple souhaiter participer au déploiement des énergies renouvelables (solaire, biomasse, éolien, …), de mesures d’efficacité énergétique (isolation, optimisation de procédés, …), de valorisation des déchets (méthanisation, compostage, recyclage, …), de dépollution, d’études d’impact… Dans l’aspect managérial, les missions qui paraissent intéressantes sont celles qui mettent en œuvre, au sein des organisations, des structures permettant de mesurer et améliorer les bilans environnementaux des entreprises (au risque de devenir les dictateur·ices du changement décriés dans l’article précédent).
Mais, il y a un mais qui aura probablement frappé le·la lecteur·ice qui a déjà passé beaucoup de temps à se renseigner sur ces thématiques. En effet, pour chacune des pistes évoquées ci-dessus il existe des détracteur·ices qui ont des arguments parfaitement valables. La réalité est que dans le problème complexe que constitue la préservation d’un environnement viable sur Terre, il n’existe pas de solution simple ou unique. Afin d’illustrer ce point, il est intéressant de prendre un exemple : le développement de l’énergie éolienne. Il y a de nombreux postes d’ingénierie dans ce secteur, et il semble important d’augmenter la capacité de production d’énergie éolienne [5], ce qui en fait l’idéal-type d’un emploi d’ingénieur utile. Néanmoins ce secteur comporte deux défauts majeurs que nous développons dans l’encadré suivant.
| Cas d’école : Le développement éolien est-il un métier utile ? |
|---|
| Si le développement éolien semble un métier d’avenir particulièrement intéressant pour les ingénieur·es tournés vers l’environnement, deux types de reproches lui sont régulièrement faits. Le premier d’ordre social, et le second d’ordre physique. Au niveau social, les projets d’implantation éoliens sont presque systématiquement attaqués par les communautés locales [6], parfois même au nom de la préservation de l’environnement ou du paysage[7] [8]. Les promoteur·ices de projets éoliens semblent en effet rarement se soucier des dommages sociaux et environnementaux que peuvent causer leurs projets, conçus hors sol, et dont les bénéfices ne reviendront pas aux territoires et aux personnes directement impactées. Il existe bien entendu des structures plus vertueuses, qui remettent la question “pour qui” au cœur de la problématique. Au niveau physique, la place de l’énergie éolienne au sein de la transition énergétique alimente également d’intenses débats. Il existe beaucoup de discussions sur les avantages environnementaux des énergies renouvelables, et nous pouvons notamment citer certains des arguments les plus classiques sans qu’il soit question d’arbitrer le débat. Le principal reproche fait à l’énergie éolienne est son intermittence, et notamment le fait qu’il faille installer une capacité de production bien plus importante que le besoin réel. Un second reproche est la difficulté à rendre pilotable cette énergie intermittente. Enfin, des critiques sont émises concernant l’intensité globale en matériaux requise (notamment le béton et l’acier), dont la recyclabilité ou la disponibilité à long terme n’est pas toujours assurée. L’éolien est en réalité un enjeu complexe, comme absolument tout ce qui existe en termes de transition écologique. Cela n’en fait pas moins un métier qui peut être utile et intéressant. |
Le point à retenir de cet exemple est que briguer une mission utile requiert la condition impérative d’être soi-même convaincu·e que la mission est effectivement utile, faute de se retrouver un jour ou l’autre face à une contradiction insurmontable. Pour cela il est important d’avoir conscience de l’impact négatif que génère nécessairement l’activité en question, et de considérer qu’il s’agit d’une condition acceptable. Il est ainsi tout à fait légitime de penser qu’une action, même imparfaite, est mieux que l’inaction. Il est pour cela parfois nécessaire de remettre profondément en question nos convictions pour analyser tous les arguments et faire la balance entre les impacts positifs et négatifs de nos actions, ce qui nécessite un esprit critique affûté et une certaine humilité. Avoir une mission utile est tout à fait envisageable dans tous les types d’entreprises, même celles qui semblent les moins éthiques. Il est indispensable dans cette situation de connaître ses propres contradictions et d’être à l’aise avec elles. C’est ainsi un moyen d’être honnête avec soi-même et de prendre conscience des priorités que l’on établit au sein des valeurs que l’on défend. Il est également très important de garder un esprit critique et ouvert à de nouveaux arguments, et de continuer à s’informer et confronter régulièrement ses opinions.
Un emploi utile pour soi, une stratégie gagnant-gagnant avec l’entreprise ?
Une autre manière de voir l’utilité d’un emploi est de considérer l’apport qu’il nous fournit par rapport à nos objectifs stratégiques personnels. Les ingénieur·es récemment diplômé·es cherchent souvent à acquérir des compétences clés au cours de leurs premières expériences professionnelles, y compris leur stage de fin d’étude. Les entreprises disposent aujourd’hui de nombreux domaines d’expertise dans lesquels elles sont prêtes à former ces jeunes ingénieur·es. Une stratégie intéressante peut être de se servir des entreprises pour acquérir des compétences et savoirs qui nous semblent essentiels, ou un réseau de connaissances lié à une problématique clé. Ceci permet d’intégrer le monde confortable de l’entreprise, tout en se projetant au-delà de la raison d’être affichée de son employeur. Apprendre, par exemple, à faire des études environnementales, à dimensionner des éoliennes ou des échangeurs thermiques, apprendre à maîtriser une interface logicielle ou des techniques de conception peut être utile bien au-delà et en dehors des intérêts capitalistes. Si certaines de ces compétences peuvent être acquises au cours de la formation, leur application dans le monde professionnel peut être réellement enrichissante, particulièrement si l’on souhaite en faire sa propre activité professionnelle, indépendamment de l’entreprise.Cette vision de la stratégie nécessite de s’interroger sur le chemin à prendre pour construire une trajectoire qui a du sens pour soi à long terme. Elle nécessite de se projeter dans le futur en analysant ce qui nous fait défaut à l’instant t (légitimité, compétence,…), et au moyen de l’acquérir dans le monde tel qu’il existe aujourd’hui. Bien que l’entreprise ne soit pas un prérequis pour entrer dans la vie active, elle peut être un point de passage important pour développer sa marge de manœuvre en tant qu’ingénieur·e. Les contreparties pour cela sont diverses, parfois lourdes. D’une part, cela peut nécessiter de faire de forts compromis sur son éthique à court terme. D’autre part, le propre de l’avenir à long terme est d’être fortement imprévisible, et la vision du monde de ce qui a du sens pour soi évolue régulièrement au fil de la vie. Enfin, cette posture peut sembler hypocrite dans une certaine mesure et donner l’impression de trahir son entourage au sein de l’entreprise [11]. C’est donc un pari qui ne fait sens que si l’on est certain·e de ne pas regretter les actions concrètes que l’on fera à court terme.
Le principe de responsabilité – l’éthique au quotidien
Que l’on juge notre mission éthique ou non, il est possible de revendiquer des valeurs et une déontologie professionnelle qui nous rendent légitime pour porter notre conception de la durabilité au-delà de celle qui est attendue en entreprise. Même si la responsabilité de l’ingénieur·e au sein de la société est considérée comme moins forte en France que dans d’autres pays, il est tout à fait (et de plus en plus) entendable de défendre ses valeurs personnelles au travers de son métier [12].
Si l’on occupe déjà un emploi supposé être “éthique” (responsable RSE, ou chargé de mission en Développement Durable par exemple), ces valeurs seront attendues. Bien que ces postes soient souvent, comme nous l’avions évoqué dans le précédent article, une façade destinée au greenwashing, il n’en reste pas moins qu’ils peuvent offrir une marge de manœuvre intéressante pour agir. Il est ainsi possible, dans une certaine mesure, de jouer sur l’ambiguïté des termes consensuels (développement durable, économie circulaire…) pour tenter d’implémenter, au nom de ces concepts, des politiques plus radicales qu’elles n’auraient pu l’être. L’avantage avec cette posture est que l’on peut revendiquer une position rationnelle (la plus rationnelle possible d’ailleurs), tout en agissant exactement dans son rôle. Une marge de manœuvre importante réside dans l’établissement des nouveaux indicateurs servant à mesurer la performance environnementale des entreprises. Il est possible de construire ceux-ci de manière à ce qu’ils représentent au mieux les problèmes écologiques, en intégrant par exemple le respect des limites planétaires. Il est ainsi possible de tenter de suggérer que les impacts sont directement corrélés à la croissance et que celle-ci n’est peut-être pas une fin en soi. De nos jours, ces notions sont plus entendables et peuvent intégrer la stratégie de certaines entreprises. Cependant, on imagine mal voir cette logique dépasser la petite échelle à l’heure actuelle, car au niveau global, les produits sont évalués en fonction de leur prix et non pas de leur qualité. Cela revient toujours à accepter la politique des petits pas, avec un objectif à atteindre qui est intermédiaire et non suffisant.
Mais il n’est en réalité nul besoin d’occuper un emploi particulièrement vertueux – du moment que l’on est prêt à en accepter les conséquences – pour effectuer celui-ci de la manière la plus éthique possible. Avoir un métier totalement détaché, en apparence, des problématiques environnementales ne signifie pas qu’il soit impossible de les y intégrer. Cette posture engagée est tout à fait défendable au sein d’une entreprise, d’autant plus si l’on dispose d’une forte légitimité technique. Chercher spontanément à acheter des matériaux moins polluants, à optimiser les procédés existants, à mieux valoriser les déchets produits, à prendre soin des collaborateur·ices avec qui l’on travaille, peut avoir plus d’impact que les rôles supposément éthiques. Cela nécessite une attitude proactive qui peut être contrainte par un emploi du temps déjà écrasant, mais justifier cet investissement supplémentaire peut se faire au détriment d’autres actions que l’on juge moins utiles, au nom de ses valeurs personnelles. Celles-ci ont en effet tendance à être valorisées en entreprise du moment bien sûr qu’elles ne s’opposent pas trop ouvertement à ses objectifs financiers. Il est intéressant de noter que les postes les plus influents au sein des entreprises ne sont pas souvent ceux qui sont explicitement dédiés à la stratégie environnementale. Les responsables des programmes RSE ont parfois une légitimité moindre que les chefs techniques par exemple, car leur regard est plus éloigné de certains aspects très concrets des métiers de terrain. Voir un expert technique dont la préservation de l’environnement n’est pas le cœur de métier s’investir très fortement sur ces questions peut être source d’inspiration et de motivation pour d’autres, et pourrait même entraîner certains rouages plus profonds de l’organisation. Cela peut passer par des actes directement liés au métier ou alors à des actes professionnels du quotidien : et si les chargé·es d’affaires refusaient, par exemple, de prendre l’avion pour leurs déplacements professionnels ? La contrepartie peut être lourde à accepter, car “faire tourner la machine” implique nécessairement des impacts environnementaux. Il ne faut néanmoins pas avoir une image complètement noire de l’ingénieur·e et de son rôle social : après tout, même si ce qu’il produit est rattaché aux valeurs capitalistes et productivistes, il existe une quantité importante de produits et de services nécessitant des ingénieur·es sans être directement liés la transition écologique – à commencer par la production de certains objets du quotidien.
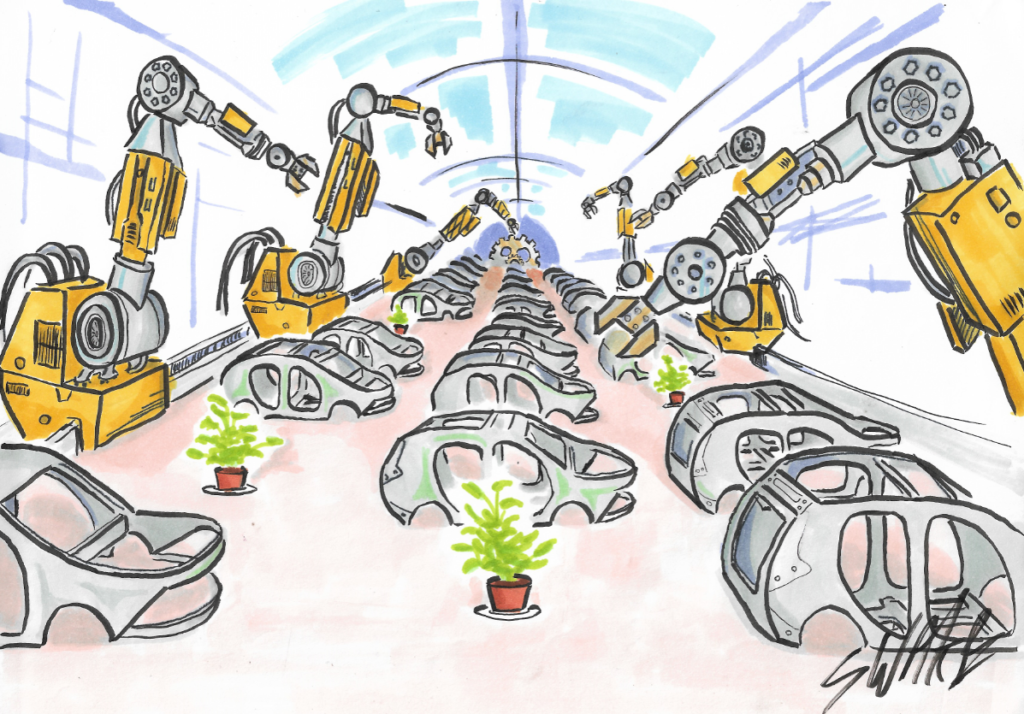
Agir hors de son rôle
La marge de manœuvre offerte pour l’action dans le cadre de son rôle au sein de l’entreprise peut sembler au final assez réduite, et souvent centrée sur une stratégie individuelle. A son échelle, on pourra toujours agir, être vertueux·se, mais cela ne sera pas suffisant si l’ambition est de changer le système. Il existe cependant des moyens d’action très intéressants, qui dépassent le rôle simplement attribué par l’entreprise, mais pour lesquels la place en entreprise est indispensable. Ces moyens d’actions laissent alors entrevoir la possibilité de stratégies plus collectives, concertées, organisées. Nous allons distinguer deux principaux types d’actions. Les premières seront des actions d’influence (ou lobbying) qui consistent à utiliser sa légitimité pour porter son message (et faire changer les orientations de l’entreprise). Les secondes relèvent plutôt de la dissidence et consistent à profiter de sa place privilégiée dans l’organisation pour retourner ses propres armes contre elle.
Faire entendre sa voix – contre-lobbying
La principale force de l’ingénieur correspond à sa crédibilité et légitimité, comme nous l’avons précédemment développé, et notamment auprès des cercles dominants. Cette légitimité, bien employée, peut être un véritable porte-voix pour diffuser les valeurs engagées et subversives que ce soit au sein de l’entreprise ou à l’extérieur. Il ou elle dispose donc d’un réel potentiel d’influence (autrement dit, de lobbying) auprès de ceux et celles qui ont le pouvoir. Ce potentiel n’est pas non plus systématique, car il est évident que certain·es seront plus écouté·es que d’autres.
La parole d’un·e ingénieur·e, qui plus est, qui fait “partie de la maison”, aura beaucoup plus de chance d’être prise au sérieux que celle d’un·e militant (type Extinction Rébellion), même si le message est identique. Tant qu’il·elle continuera à garantir sa légitimité dans l’entreprise, il·elle pourra conserver cette influence. Il est en revanche évident que cette subversivité ne pourra pas s’attaquer directement à l’entreprise au risque de s’en faire exclure (réellement ou symboliquement) et devenir un·e paria. Certaines figures de proue du mouvement écologiste actuel sont d’ailleurs ingénieur·es et revendiquent ouvertement ce titre (Comme J-M. Jancovici, précédemment cité, ou P. Bihouix connu pour ses écrits sur les Low-Tech [13]), bien qu’il·elles n’aient pas forcément des rôles d’ingénieur·es “classiques” au sein des entreprises. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
Comment s’exprimer ? Stratégie argumentative – la Raison et l’Émotion
Être entendu ne signifie pas toujours d’être écouté. Si certaines personnes seront ouvertes à la discussion sur l’entreprise, ses valeurs et sa raison d’être, il sera très difficile de passer au-delà de l’inertie face au changement. Il n’est d’ailleurs pas si rare de voir des décisions politiques s’opposer au bon sens scientifique, même au-delà des questions environnementales. Afin que son message ait une répercussion sur le réel, il est important de ne pas négliger sa stratégie argumentative. Nous le savons depuis les cours de français du lycée, il existe deux principales stratégies d’argumentation : convaincre et persuader. L’encadré suivant se propose de peser les avantages et inconvénients de ces deux stratégies pour faire passer le message environnemental.
| Convaincre ou persuader ? |
|---|
| Convaincre Cette première stratégie se basant sur la raison froide et la logique, est celle de prédilection des ingénieur·es. C’est avec les codes qu’ils·elles ont acquis au cours de leur formation scientifique, logique, technique, qu’ils·elles seront les plus crédibles, et grâce auxquels ils·elles peuvent efficacement tirer parti de leur légitimité. Cependant, il existe des argumentaires aussi froids et rationnels provenant des personnes qui estiment réaliste le mode de fonctionnement actuel de la société : appuyé par les “sciences” économiques et managériales (dont nous avons ébauché une critique dans le premier article). Il ne sera donc pas systématiquement aisé de l’emporter sur le champ de la raison, car celle-ci peut facilement être manipulée pour servir ses propres intérêts. En effet, à la rationalité écologique, c’est-à-dire de survie collective, s’oppose la rationalité de survie individuelle. Tout organisme, toute organisation, tout être doué de raison a pour premier objectif le maintien de ses fonctions vitales [14]. L’entreprise ne fait pas exception : son premier objectif est de rester “vivante”. Dans le système actuel, cela revient très souvent à satisfaire ses actionnaires, notamment par la maximisation du profit, peu importe si cela compromet la survie collective à long terme [15]. Pour résumer, être “rationnel” du point de vue d’une entreprise peut parfaitement s’opposer à la rationalité du discours environnemental [16]. Persuader Utiliser le deuxième pilier rhétorique qu’est la persuasion, l’appel au pathos et aux sentiments, peut alors être indispensable, n’en déplaise aux esprits les plus cartésiens. Car le réchauffement climatique, et les problèmes environnementaux (c’est un peu moins vrai pour les problèmes sociaux) sont aujourd’hui quasi-unanimement reconnus. Ce qu’il manque est plus la conviction qu’il est nécessaire d’agir de manière forte et urgente. Nous reprenons donc une formule chère aux défenseurs de la “collapsologie” [17] : il faut amener les gens à croire ce qu’ils savent. C’est à dire, faire sentir que les problèmes environnementaux sont réels, et auront un impact sur tout le monde à une échéance pas si lointaine [18]. Toute la difficulté de l’argumentaire émotionnel est d’arriver à transpercer la carapace des rôles sociaux pour toucher les personnes : toucher le père ou la mère de famille derrière le patron ou la responsable des ressources humaines. Cependant, l’expression de ses émotions est souvent une attitude dévalorisée, considérée comme un attribut féminin [19] qui est donc méprisée dans un modèle patriarcal particulièrement présent au sein des entreprises. Il est donc probable que les postes disposant du plus de pouvoir soit attribués aux individus (hommes et femmes) qui montrent les caractères les plus valorisés, c’est à dire virils et insensible aux émotions [20]. L’ouverture pour ce genre d’argumentation dépend beaucoup du contexte humain et social de l’entreprise, et certains environnements peuvent y être propices. Mais dans d’autres circonstances, mettre à nu ses émotions signifie prendre le risque de perdre sa crédibilité notamment auprès des responsables, ce qui peut nuire à la portée de son message dans le futur, voire à l’évolution professionnelle en entreprise. |
Les deux stratégies argumentatives ont donc leurs avantages et leurs défauts, et doivent être choisies en fonction de l’interlocuteur·ice et du contexte. La raison ne peut être invoquée en contexte professionnel avec succès que si la rationalité environnementale s’aligne avec la rationalité de la pérennité de l’entreprise (ce qui, avec les impacts du réchauffement climatique, peut malheureusement s’avérer de plus en plus crédible). Les arguments émotionnels auront plus de poids dans un contexte non professionnel, comme à la machine à café ou au repas. Utiliser les bons arguments avec les bonnes personnes relève d’un talent particulier qui n’est pas donné à tous·tes, et avoir de l’impact en suivant cette voie nécessite pour beaucoup de l’entraînement.
Pourquoi s’exprimer ? Sensibiliser et mobiliser ses alliés
Au-delà de ces réflexions, il est nécessaire de bien identifier l’objectif des discussions lorsque l’on souhaite faire entendre sa voix de manière stratégique. Nous pouvons pour cela distinguer les discours de sensibilisation, et ceux de mobilisation.
Sensibiliser ses collègues, hors de son rôle, peut constituer une stratégie en soi, si l’on pense que cette sensibilisation est essentielle dans son environnement professionnel. S’adresser à un large public ou à des personnes peu ouvertes aux questions environnementales constitue une pression sociale qui contribue à faire évoluer les mentalités au sein de la société. Ce type d’action est analogue aux actions de sensibilisation faites par les associations à destination du grand public, et le fait que celles-ci soient portées par un collègue peut permettre d’accroître la portée du message. On pourra pour cela passer par les réseaux sociaux d’entreprise, des mails groupés, des discussions interpersonnelles, voire l’organisation d’ateliers (supportés ou non par la direction de l’entreprise). Néanmoins, échanger avec des personnes peu sensibilisées, voire débattre sur les fondements avec des sceptiques, ne permettra pas nécessairement de mobiliser ces personnes. Ce sera d’ailleurs sans doute l’occasion de se faire des “ennemis”, en s’attribuant une étiquette d’écologiste zélé, mais également de se faire plus facilement identifier de ses allié·es.
En effet, la sensibilisation et la discussion autour de sujets environnementaux peut également avoir un objectif supplémentaire : celui de rassembler des personnes les plus engagées prêtes à aller plus loin dans l’action (notamment en vue d’engager un rapport de force). Il s’agit donc, soit d’identifier les personnes déjà très engagées, soit d’amener cet engagement par la discussion avec des personnes déjà sensibilisées. Identifier et mobiliser ses alliés se fait plus facilement par la discussion personnelle (ou en groupe restreint), qui favorise le lien social. C’est dans ce cadre qu’il sera plus simple, par exemple, d’identifier des éléments de culture ou de langage communs concernant la problématique environnementale. Une personne pourra être considérée comme un·e allié·e lorsque l’on a la certitude qu’à ses yeux, les enjeux environnementaux sont au moins aussi importants que les problématiques de l’entreprise. Il peut être bon de procéder par étapes dans les discussions et dans la profondeur des débats, pour ne pas risquer de refermer une porte ou de perdre la confiance de l’autre. Cela peut aussi aller très vite, au travers de l’échange d’une simple phrase. Une fois la confiance installée, et réciproque il sera possible de réfléchir collectivement aux prochaines actions.
Agir, seul·e ou en collectif
Convaincre la tête
Au vu de ce que nous venons de développer, une piste évidente qui semble s’ouvrir aux ingénieur·es est de tenter de convaincre la tête des entreprises pour inciter celles-ci à agir. Mais dans une hiérarchie complexe, il est parfois difficile d’identifier la “tête”. D’autant que chaque cadre intermédiaire (dont beaucoup sont ingénieur·es), dispose généralement de son propre champ de responsabilités. La tête qu’il faut trouver ici est celle qui a effectivement le pouvoir d’infléchir, au moins dans une certaine mesure, la stratégie de l’entreprise. Et plus la structure sera importante, plus le pouvoir sera comparativement concentré en un faible nombre de personnes qui seront d’autant plus inaccessible·s. Car peu importe le niveau hiérarchique, il existe des contraintes qui s’opposeront à un virage environnemental. Même les dirigeant·es des entreprises appliquent en réalité les décisions des actionnaires et ne sont donc pas forcément ceux·celles qui ont le plus de marge de manœuvre. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer le pouvoir des conseils d’administration, et des membres de ces conseils. Se faire des alliés parmi les membres haut positionné·es au sein des organisations reste quoiqu’il en soit intéressant, car ce seront in fine ces personnes qui mettront les stratégies managériales en œuvre. Mais s’exprimer vers le “haut” de l’entreprise est à la fois plus complexe et plus risqué que vers le “bas” (ou à l’horizontale). En effet, comme nous le décrivions dans l’article précédent, plus une personne est haut placée, plus elle est susceptible de défendre les intérêts de l’entreprise, notamment par la bonne gestion de ses subordonné·es. C’est donc en position d’infériorité, et avec une légitimité moindre qu’il faudra défendre ses arguments, et il ne suffira probablement pas d’exprimer les problèmes scientifiques dans les termes classiques. Même s’il est probable que beaucoup de cadres n’aient pas idée des conséquences réelles du dérèglement climatique, ces arguments sont vite écartés par la rhétorique d’entreprise ou institutionnelle (“Tout est sous contrôle, on fait ce qu’il faut”), par la “rationalité” économique, ou par une contre-argumentation idéologique maîtrisée [21].
Parvenir à générer des prises de conscience à des échelons élevés pourrait débloquer de puissants leviers d’action. Certain·es membres de Conseils d’Administrations peuvent être très influent·s et pousser pour des politiques engagées ou de nouveaux indicateurs. Tous·tes ne s’arrêteront pas aux arguments économiques, d’autant plus si les arguments écologiques sont appuyés par une base scientifique solide. Tant que l’entreprise restera ancrée dans le modèle économique dominant, les idées de durabilité fortes auront du mal à émerger, mais celles-ci pourraient par exemple émerger d’une prise en compte sérieuse des contraintes des limites planétaires sur la survie de l’entreprise. Quant à faire abandonner la croissance comme objectif principal et prioritaire, peut-être même qu’une stratégie réfléchie de dirigeant·es convaincu·es pourrait faire bouger des lignes.
Animer un projet environnemental au sein de l’entreprise
Le changement direct peut aussi être cherché dans la marge de manœuvre dont on dispose déjà au sein de l’entreprise, ou alors en créant de nouveaux espaces de discussion et d’action. Il existe énormément d’actions possibles à mettre en œuvre, du recyclage des déchets au mode de déplacement des salarié.es, qu’un projet d’Ingénieur·es Engagé·es a par ailleurs entrepris de détailler [22]. Ces projets nécessitent souvent d’être un petit groupe moteur au sein de l’entreprise (même si ce n’est pas impossible, il est toujours difficile de mener seul·e la bataille), d’où l’intérêt d’identifier des allié·es. Si certaines actions concernent uniquement des “éco-gestes” basiques (et indispensables), d’autres peuvent aller chercher plus en profondeur à faire bouger les lignes de l’organisation. Si cela semble être la voie la plus plus simple et consensuelle, même les plus petites actions peuvent rencontrer une opposition de la hiérarchie. Mais tant qu’elles ne remettent pas fondamentalement en cause le fonctionnement de l’organisation, il sera généralement possible de faire passer un certain nombre de choses, et par la même occasion de créer une culture collective qui est également un relais de sensibilisation. L’apparence anodine et inoffensive de ce type d’action permet de solliciter l’appui des responsables environnementaux, et donc de catalyser les projets pourvu que les personnes en charge de ces questions soient impliqué·es dans leur rôle [23]. Néanmoins, dès qu’il s’agira de faire bouger les choses plus en profondeur, il pourra être nécessaire d’aller chercher un soutien plus large pour ces actions, et notamment en organisant un rapport de force interne.
Organiser la lutte avec la base
Une prise de conscience massive au sein des entreprises polluantes pourrait conduire à créer de nouveaux rapports de force, portant des revendications environnementales fortes. La construction de ces rapports est néanmoins délicate, car elle s’inscrit dans un monde complexe de tensions.
Quelle(s) base(s) ?
L’ensemble que nous appelons “la base” est en réalité très hétéroclite, que la distinction cadre / non cadre ne suffit pas à décrire. Il existe même des situations d’entreprise où il n’y a que des cadres, comme par exemple les bureaux d’études ou de conseil. C’est bien d’une base élargie dont il s’agit ici, c’est-à-dire l’ensemble des personnes ayant un pouvoir trop faible pour impacter à leur niveau la stratégie d’entreprise. Dans ce cas, il s’agit d’organiser un rapport de force interne à l’entreprise pour faire émerger la volonté commune d’une base engagée sur la question environnementale.
La première difficulté est précisément l’hétérogénéité de cette base. Plus l’entreprise comptera de niveaux hiérarchique, de catégories de salariés différenciés présentant des intérêts différents (voire opposés), plus il sera difficile de mobiliser une base forte et unifiée pour faire une revendication commune. Porter un message au sein d’une sous-catégorie de salarié·es de l’entreprise (par exemple, un service, ou un niveau hiérarchique) peut être plus simple car la proximité entre les personnes de cette catégorie est plus grande, mais prêtera le flanc aux attaques d’autres sous-groupes de l’entreprise. Agir dans une volonté fédératrice et mobilisatrice nécessite de bien avoir conscience de ces rapports de force et de pouvoirs internes, afin de maximiser les chances que le message partagé soit largement supporté. Lorsqu’elle n’est pas source d’antagonisme, la conscience collective pourra se propager au fur et à mesure par effet d’entraînement, et gagner les autres sphères.
Un aspect particulier de ces rapports de force est que pour une majorité de salarié·es, la préoccupation de conserver un emploi leur permettant de vivre est supérieure à tout impératif environnemental. Même s’ils étaient sensibilisé·es, peu d’employé·es de la “base” seraient prêt·es à risquer leur place pour revendiquer un fonctionnement plus écologique (d’autant que cette transition peut parfois remettre en cause certains emplois). En ce sens, les cadres ont un rôle particulier à jouer, car la pression sur leur emploi est bien moindre. Les cadres peuvent bien évidemment subir des licenciements, mais cela a un coût plus important pour l’entreprise (ils·elles sont moins facilement interchangeables que des Ouvrier·es Spécialisé·es, par exemple), et ils·elles ont plus de chance de trouver un nouvel emploi équivalent ensuite. Cela constitue une arme importante qui pourrait même se passer d’un plus large soutien “en dessous”. C’est également la source d’un important risque, car la mobilisation de cadres seuls est particulièrement susceptible d’exacerber le mépris de classe et d’attiser les oppositions. Dans ce genre de stratégie, il faut donc toujours veiller à ce que les revendications portées ne s’opposent pas aux intérêts des personnes moins « gradées », et toujours se diriger vers le haut de l’organisation [24]. Cela donne en revanche un avantage considérable à ce type de lutte dans une organisation très largement composée de cadres.
En résumé, plus un mouvement sera partagé par une large partie des employé·es, plus il aura de force. Les ingénieur·es ont une position idéale dans l’entreprise pour porter ces initiatives, mais risquent d’attiser les oppositions de par leur position ambivalente [25].
Comment rallier les volontés
Mobiliser une base forte et radicale sur les enjeux environnementaux nécessite une sensibilisation importante, et dirigée à une échelle large. Depuis quelques années, les mentalités changent, et les problématiques environnementales sont prises beaucoup plus au sérieux par la majorité des personnes [26]. Ce fond de sensibilisation peut être un terreau fertile pour impulser de réelles dynamiques collectives de changement. Mais rallier à sa cause les personnes qui ont peu de pouvoir au sein des entreprises n’est efficace que si elles sont suffisamment nombreuses et permettent d’établir un rapport de force.
La plupart des personnes ne sont probablement pas sensibilisées aux questions environnementales par leur activité professionnelle. Dans ce contexte, le rôle d’un·e ingénieur·e engagé·e peut alors autant être celui d’un·e influenceur·euse, que celui d’un support. D’une part, il·elle peut jouer de sa propre marge de manœuvre pour influencer ses collègue, par exemple en amenant des sujets en réunion, en proposant des modes de fonctionnements plus vertueux ou alors en exerçant son métier de manière exemplaire (comme évoqué dans la partie “Agir dans son rôle”). D’autre part, il·elle peut être une·e précieux·se allié·e pour des collègues, notamment les personnes ayant un rang inférieur dans la hiérarchie, et leur donner la marge de manœuvre dont ils·elles ont besoin pour leurs propres actions engagées.
Lorsque les employé·es de l’entreprise sont suffisamment sensibilisés et mobilisés le rapport de force peut alors s’installer par la construction de revendications collectives. Cela correspond aux changements collectivement souhaités pour que l’entreprise soit plus vertueuse. Pour maximiser les chances d’adhésion et de réussite, ce projet doit idéalement être conçu en collaboration avec toutes les parties impliquées dans le mouvement de fond. Pour cela, il peut être nécessaire de se rassembler, d’organiser des rencontres formelles ou informelles, de s’organiser avec ou sans les outils de l’entreprise. Il peut même parfois être utile de cibler les organes de l’entreprise dédiés aux questions environnementales pour améliorer la visibilité des actions entreprises. Cela dépend bien entendu de l’attitude de l’entreprise par rapport à ces questions, mais un·e responsable RSE avec suffisamment de marge de manœuvre peut être ravi·e d’être sollicité·e pour organiser une concertation interne sur la transition de l’entreprise. Le rôle des syndicats au sein des entreprise n’est pas non plus à négliger dans l’émergence et l’organisation d’un lutte collective. C’est même leur première fonction, même si les luttes menées ne sont habituellement pas environnementales. La manière d’associer les syndicats au projet de lutte collective au sein d’une entreprise dépend grandement du contexte dans lequel se situe l’action. L’encadré suivant rappelle certains point à prendre en compte à ce sujet.
| Les syndicats : avec ou sans ? |
|---|
| Les syndicats ont une place privilégiée pour établir des rapports de force au sein des entreprises, et constituent l’option la plus classique pour s’engager dans la vie politique au sein de sa structure. Cependant, force est de constater que leur pouvoir et leur légitimité s’affaiblit d’année en année, dans une doctrine économique mondiale qui favorise de plus en plus le pouvoir des entreprises sur les salariés [27]. Il peut de plus paraître très difficile de porter des revendications environnementales au niveau des syndicats, du fait que celles-ci sont encore aujourd’hui éloignées de leurs terrains de bataille classiques. Comment pourrait-on espérer voir aboutir d’hypothétiques revendications environnementales alors que leurs revendications sociales, historiques et légitimes, ne sont pas écoutées ? Néanmoins, agir au sein d’un syndicat, même sans l’aspect environnemental, permet déjà d’agir concrètement selon certaines valeurs sociales portées par les ingénieur·es engagé·es. Cela permet de se rapprocher des problématiques des dominé·es (au risque de perdre sa crédibilité face aux dominant·es). Se faire une place au sein d’un syndicat permet également de gagner la confiance des autres membres, ce qui ouvre la possibilité de leur transmettre petit à petit l’importance de la question environnementale. Mais au vu de l’inertie et des difficultés rencontrées par ces structures historiques, il semblera parfois préférable de se passer de syndicats pour initier des rapports de force. Si cela permet de dépasser dans un premier temps la méfiance que peuvent véhiculer ces structures auprès des salarié·es non syndiqué·es, cela constitue un risque important de désolidariser les luttes sociales et environnementales, et d’attiser le mépris de classe [28]. On retrouvera dans cette logique de préoccupation l’opposition entre les cadres et les ouvriers, les premiers étant concernés par les enjeux écologiques et les seconds par les enjeux sociaux. Si l’objectif est pour les deux classes d’imposer un agenda à l’entreprise, c’est la nature de cet agenda qui diffère. Une approche intermédiaire pourrait par exemple être de faire émerger la problématique en dehors des syndicats existants, mais une fois les jalons des revendications exprimées avec suffisamment de force, tenter de les faire entrer dans les agendas syndicaux. C’est en effet leur rôle de représenter la parole des autres employé·es, et solliciter leur expérience pour accompagner de nouvelles luttes pourrait permettre de renforcer les liens et la cohésion de la base. Bien entendu, chaque situation est différente, et le rôle des syndicats est à envisager en fonction du contexte dans lequel se trouve son entreprise. |
Les ingénieur·es ne sont cependant pas toujours les mieux placé·es pour initier ces mouvements de fond. Comme nous l’avons vu, ils·elles sont en effet souvent plus proches du haut que du bas de la hiérarchie, et leurs intérêts plus proches de ceux de l’entreprise que de celui des salarié·es. La légitimité de leur discours est déformée par les liens et relations hiérarchiques, et la confiance qui leur est accordée peut en pâtir. Cela tient également parfois à une condescendance latente envers les classes moins favorisées, parfois moins éduquées aux problèmes environnementaux. Encore une fois la position de l’ingénieur·e est ambivalente.
Synthèse : la stratégie Sandwich
Lorsque l’on agit dans un but stratégique, il est important de se poser la question de là où l’on affecte ses efforts. Vaut-il mieux sensibiliser et chercher des allié·es parmi les personnes n’ayant pas de pouvoir hiérarchique (que nous nommons génériquement “la base”) pour monter des actions ou créer un rapport de force ; ou alors essayer de toucher directement les personnes à même de prendre les décisions (la “tête”) ? En réalité, les deux stratégies sont utiles, et complémentaires. Si chacun·e préfèrera mobiliser ses efforts à un niveau ou l’autre de l’organisation, le changement des entreprises sera d’autant plus efficace s’il vient à la fois du haut et du bas – Les deux pôles étant en réalité interdépendants.
Si les paragraphes précédents détaillent des leviers pour mettre en place une lutte verticale, celle-ci a peu de chance d’aboutir si elle est unidirectionnelle. Une politique d’entreprise environnementale top-down sera un fiasco si les collaborateurs ne la comprennent pas. De même, un mouvement bottom-up à l’encontre d’une direction réfractaire fera probablement accoucher l’éléphant d’une souris. Afin d’infléchir les politiques de l’entreprises (et donc de changer le système), il faut prendre celle-ci en étau dans deux dynamiques complémentaires. L’aboutissement d’une stratégie “sandwich” est que chaque entité de l’entreprise fasse peser tout son poids pour surmonter les obstacles à la durabilité forte. D’une part, essayer de déclencher aux niveaux les plus élevés des politiques environnementales ambitieuses, malgré les fortes contraintes du système économique [29]. D’autre part, diffuser la sensibilisation par le bas et construire une dynamique collective qui ne laisse personne de côté. L’imprégnation à tous les niveaux de la question environnementale serait renforcée par l’existence de réseaux puissants et transversaux, à l’instar des structures syndicales existant actuellement sur la question sociale à l’échelle nationale.
Désobéissance et sabotage – L’ennemi de l’intérieur
Nous avons jusqu’à présent développé les stratégies qui n’impliquent pas d’opposition directe aux valeurs de l’entreprise. Même d’hypothétiques rapports de force revendiquant des changements vertueux ne sauront s’inscrire en porte-à-faux avec les objectifs premiers de l’entreprise. Mais face à l’importance des enjeux et à l’urgence, il peut être vu comme une nécessité de s’opposer frontalement au monde économique, afin de participer à déstabiliser voire détruire ce que l’on considère comme nocif. Nous passons donc ici dans une conception fondamentalement différente de la lutte. Si jusqu’à maintenant nous abordions plutôt des moyens de “lutter avec”, c’est plutôt des moyens de “lutter contre” qui seront abordés dans cette partie.
Dans cette stratégie d’opposition, le fait d’être à l’intérieur d’une organisation donne des armes potentiellement très destructrices à qui sait s’en emparer, mais représente aussi un risque et un poids moral considérable. Cette logique est réellement à double tranchant, car il s’agit souvent d’un coup “unique”, qui revient à scier la branche sur laquelle on est assis dès lors que l’on dévoile son jeu. De tout temps, dans toute organisation, les sanctions les plus sévères ne sont en effet pas dirigées vers les ennemis directs, mais plutôt vers les ennemis de l’intérieur : traîtres, déserteurs, hérétiques… Ce type d’action n’est justifiable que par un impératif moral extrêmement fort et mis en avant de manière à entraîner une adhésion plus large. De la même manière que pour les mouvements de désobéissance civile, l’image est primordiale, car sans celle-ci un·e employé·e qui trahit son entreprise n’est rien d’autre qu’un·e délinquant·e.
Nous distinguerons plusieurs formes de résistance à l’intérieur de l’entreprise, des plus “passives” aux plus actives. Il est important de noter, avant d’entrer plus dans cette partie, que cet article ne suggère pas que les actions les plus extrêmes (et les plus hostiles) sont les plus efficaces. Nous nous contentons de faire une liste descriptive des actions envisageables et justifiables selon un certain cadre de rationalité. Nous excluons néanmoins tout type de violence – physique ou morale – envers les personnes, car ces modalités d’action contreviennent aux valeurs du mouvement Ingénieur·es Engagé·es.
Résistance morale – déontologique (du droit de retrait environnemental)
Le droit de retrait [30] stipule que dans une situation où un·e salarié·e est mise face à un risque direct et identifié, il·elle est en droit de refuser de travailler afin de se protéger (ou de protéger autrui). C’est même un devoir dans certaines circonstances. Mais dans le contexte actuel, où chacun de nos gestes quotidiens compromet fortement le bien-être des générations futures, où chaque dixième de degrés de réchauffement planétaire est synonyme de milliers (voire millions) de vies humaines et non-humaines perdues, où est la limite pour en appeler à la responsabilité individuelle… et au droit de retrait ?
Nous pouvons commencer par un exemple simple. En 2016, un employé de l’entreprise ArcelorMittal est contraint de reverser sa cargaison polluante dans un cours d’eau. Cette pollution massive, directe, et proactive est également une catastrophe pour l’environnement. L’employé conscient de cela décide de documenter son acte et la stratégie de l’entreprise [31]. Mais face à une telle situation, ne serait-il pas normal d’être en droit de refuser de faire “son travail” ? Dans ce cas, la pollution est illégale, et l’employé dénonce avec courage la faute de l’employeur. Nous pourrions cependant étendre un peu la conception du droit de retrait environnemental dans des circonstances où les dégâts environnementaux dramatiques sont légaux. Par exemple, nous pourrions souhaiter que les employés chargés de mettre en œuvre les moyens de pêche intensive, destructeurs, puissent s’opposer à ces pratiques sans en être inquiétés.
En étendant ainsi le concept de droit de retrait, il serait même possible de faire une généralité du “droit d’objection de conscience” : le droit de ne pas faire quelque chose que l’on a des raisons valables de juger néfaste, même si cela est ordonné par un employeur.
Notons que ce premier volet de résistance ne s’inscrit pas nécessairement en opposition à l’entreprise. C’est plutôt une manière de revendiquer le droit d’exercer son métier sans participer à la contamination et à la destruction du monde. Il est vrai, cependant, que cela risque de remettre en question l’existence même de certains métiers, voire secteurs (par exemple, l’aviation touristique). Le droit de retrait environnemental reste dans une logique d’entreprise capitaliste, mais suppose qu’il est possible, par la lutte, de les rendre réellement vertueuses.
Résistance passive
Les stratégies de résistance interne au sein des organisations ont connu leur apogée sous l’occupation, au cours de la Seconde Guerre Mondiale. Il existait même des guides de recommandation officiels pour ces résistants passifs. Le principe est de profiter des positions de pouvoir au sein des organisations pour les rendre le moins efficace possible. L’avantage de cette stratégie est qu’elle peut parfaitement être menée en jouant le rôle qui nous est attribué. Être extrêmement perfectionniste, très procédural, faire monter en grade les moins compétent·es, multiplier les réunions et les temps non productifs… ces leviers d’inefficacité sont parfois même appliqués de manière inconsciente par les entreprises [32].
Le problème de cette stratégie de lutte est que pour être efficace et réellement freiner les dégâts environnementaux, il faudrait qu’elle soit appliquée à large échelle et de manière concertée. De plus, elle risque fort d’exacerber les conflits sociaux et les inégalités. Parallèlement à cela, il peut être extrêmement mortifère de consciencieusement mal effectuer son travail et ses tâches, quitte à rendre son quotidien absurde sur la durée. Néanmoins, c’est un levier intéressant pour déstabiliser les organisations à leur insu. L’avantage par rapport aux autres moyens de désobéissance est qu’elle ne met pas vraiment en danger la personne qui s’y emploie, qui pourra toujours se défendre – avec une certaine dose de mauvaise foi – de ne faire “que son travail”.
Révéler les secrets : lanceur·ses d’alertes et secrets professionnels
Lorsque l’on considère la résistance active, la première source de pouvoir d’action dont dispose l’ingénieur·e sur sa structure est l’information. Dossiers, archives, plans, contrats, technologies… Toutes ces informations sont bien entendu placées sous l’égide du secret professionnel et quiconque s’en sert à mauvais escient devient hors-la-loi. Néanmoins ces précieuses informations renferment parfois des scandales, ou au contraire empêchent la diffusion d’un savoir ainsi rendu inexploitable pour le bien commun. Est-il moral, dès lors que l’on en a conscience, de taire des informations scandaleuses qui s’opposent à l’intérêt général ? Est-il moral, si l’on y a accès, de priver d’autres personnes d’une technologie qui leur serait salutaire (pensons par exemple aux brevets ou secrets de production sur les médicaments) ? C’est au nom de ces dilemmes moraux que certains décident de rompre le secret professionnel, quitte à s’exposer et consacrer le reste de leur vie à fuir.
Être lanceur·se d’alerte, c’est avant tout mener une guerre de l’image. La seule protection dont ils·elles disposent après avoir violé les lois des nations et des entreprises est le statut héroïque que leur confère l’opinion publique, qui peut faire pression sur son gouvernement pour assurer leur protection. En revanche, dès que retombe ce soutien, ou dès qu’une tache d’huile (réelle ou issue d’une manipulation) vient ternir cette image, l’extradition et les sanctions ne sont jamais très loin. Certain·es lanceur·ses d’alertes sont même condamné·es à vivre le restant de leurs jours comme des fugitif·ves [33]. Ces révélations peuvent aussi se faire de manière anonyme. Par exemple, les journalistes de Cash Investigation [34] utilisent régulièrement ces “sources anonymes” pour dénoncer les rouages malsains du système économique. Être informateur anonyme n’est pas sans risques, mais protège (au moins un temps) de la violence sans merci qui s’abat sur les lanceurs d’alerte.
La divulgation de secrets professionnels (par exemple, la diffusion de connaissances acquises dans le secteur privé) semble moins courante, probablement pour deux raisons. La première est que le dilemme moral est sans doute moins marqué dans le cas des connaissances. Difficile de dire si divulguer à tous la formule d’un vaccin permettra affectivement sa production et pourra sauver plus de vies. La seconde raison est que ce genre de divulgation se place sur le plan commercial, et au-delà du plan juridique. L’ouverture et le libre accès aux connaissances est une revendication qui n’est pas unanime, dans une société où la propriété privée est synonyme de liberté fondamentale.
Le sabotage
Précisons tout d’abord qu’il s’agit dans cette partie de sabotages n’entraînant pas de dommages physiques à des personnes. Le sabotage conscient est l’action la plus hostile qu’il est possible de mener à l’encontre d’une entreprise. C’est une action usuellement utilisée en temps de guerre contre un ennemi trop puissant pour qu’il soit possible de s’y attaquer directement. Le sabotage dans l’entreprise date des premières révolutions industrielles, au cours desquelles les ouvriers ont dû apprendre, à leurs dépens, à cohabiter avec les machines [35]. Les oppositions les plus radicales consistaient à briser les machines (en y mettant des sabots, par exemple, à l’origine du mot). Les actes de sabotages sont plus souvent l’œuvre des dominé·es que des dominants, étant parfois la seule option qu’il reste pour la contestation. Dans le cadre de l’entreprise, il s’agit d’utiliser une connaissance confidentielle et spécifique sur une organisation pour identifier un point faible et l’attaquer par là. Les ingénieur·es détiennent souvent des informations capitales qui leur permettraient de grandement déstabiliser leurs employeurs (au-delà des informations compromettantes). Ils·elles peuvent se trouver dans des situations idéales pour compromettre voire détruire les capacités de production de leur entreprise. Si ce type d’action est potentiellement celle qui atteint le plus l’entreprise, elle entraîne également le plus de risques.
Contrairement aux révélations de scandales, le sabotage se base sur une base morale beaucoup plus fragile. Les répercussions de tels actes sont importantes, et peuvent parfois entraîner de lourds dommages collatéraux (par exemple : destruction d’emplois, voire des dégâts humains imprévus). Ainsi, il est très peu probable de voir les saboteur·ses érigées au même rang de héros que les lanceur·ses d’alerte. Par leur acte de vandalisme, ils·elles trahissent à la fois la confiance de leurs collègues, mais également celle des personnes qui ont une bonne image de l’entreprise ciblée. Si de tels actes étaient constatés à l’encontre d’une grosse entreprise, la plupart des gens ne comprendraient pas le geste et s’attaqueraient violemment à ceux et celles qui ont détruit. Ce type d’action compromet une personne pour le restant de sa carrière, voire de sa vie. De telles conséquences sont souvent jugées inadmissibles, même pour les plus radicaux·les des ingénieur·es engagé·es. Néanmoins, il n’est pas impossible de voir surgir, dans les prochaines années, des actions désespérées face au mur que représentent les risques environnementaux, et à l’inaction des entreprises.
L’effet d’exemple – Maintenir la pression
Il est encore aujourd’hui rare de voir des actes d’opposition ouverte à l’intérieur des entreprises, et a fortiori venant des cadres. Au-delà des conséquences directement provoquées par l’acte, les faits de désobéissance et de sabotage ont un effet stratégique intéressant. Ils permettent d’entretenir un climat de perte de confiance de l’entreprise envers ses cadres supérieurs. Même si l’immense majorité se refuserait à trahir son employeur de quelque façon que ce soit, il suffit qu’une minorité visible et active mène des actions significatives de l’intérieur pour engendrer une méfiance généralisée. Que feront alors les entreprises si elles ne peuvent plus faire confiance à la nouvelle génération d’ingénieur·es, car celle-ci les juge trop néfastes pour l’environnement ? Peut-être disparaître, privées de leurs cadres techniques, ou alors changer dans le bon sens pour ne pas craindre de tels actes…
Conclusion – La résistance ingénieure
Ingénieur·es engagé·es, nous avons notre place dans l’entreprise, car il existe des marges d’action, qu’elles soient dans ou en dehors de notre rôle. Comme le dit l’adage populaire, “si ce n’est pas nous, ce seront d’autres à notre place, qui feront pire que nous”. Nous avons exploré de nombreuses postures possibles, de la plus complaisante à la plus hostile envers les entreprises, en exposant les tenants et aboutissants de chacune d’entre elles. Il revient maintenant à chaque ingénieur·e qui souhaite tenter de faire bouger les lignes de ce monde d’identifier les leviers les plus pertinents à sa portée. Les choix d’actions sont personnels, et fonction de nombreux éléments de contexte (dépendant ou non de notre volonté).
D’une manière générale, la meilleure manière de continuer à faire vivre ses valeurs de durabilité forte au sein du monde de l’entreprise est de prendre du recul sur celui-ci. Ce faisant, l’ingénieur·e abandonne l’une de ses composantes fondamentales, et fissure un pilier de son piédestal : il·elle cesse d’être aveuglément loyal·e envers l’entreprise, en prenant en compte les enjeux environnementaux de manière lucide. Il est nécessaire pour cela de garder un esprit critique en toute circonstance, et d’observer toutes les dimensions de ses actions : celles que l’on juge vertueuses, et celles que l’on juge néfastes. Il faut requestionner constamment ses convictions et ses actions, car nul problème complexe n’a de solution simple.
Une culture de la résistance ingénieure abandonnant les mythes de l’entreprise, et cessant de croire dans leur bienfait absolu est nécessaire afin de remettre la deuxième dimension de l’ingénieur·e, la dimension technicienne, au service des enjeux réellement importants. Pour entretenir cette culture critique, il faut fonder des communautés au-delà des frontières des entreprises, des espaces où peuvent être débattus le sens de la technique ainsi que le rôle sociétal de l’ingénieur·e.
Nous avons jusqu’à présent considéré le “système” au travers d’une dimension unique, celle de l’entreprise. Si c’est en effet cette voie qui est prédominante dans les carrières d’ingénieur·es, et qu’il existe effectivement des marges de manœuvre au sein de celles-ci, il y a beaucoup d’autres manières de faire partie du “système”. Ce sont ces nouvelles voies, qui sont autant de leviers de changement supplémentaires, que nous explorerons dans le prochain article.
Cette œuvre (texte et illustration) est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.
Notes et références
[1] Citation habituellement attribuée à Albert Einstein
[2] Il est difficile d’attribuer la contribution exacte des multinationales aux émissions globales. Si l’on regarde par exemple uniquement les entreprises productrices de ressources fossiles, 100 d’entre elles peuvent être tenues pour responsables de 70% des émissions des 50 dernières années. Voir Grifin (2017) CDP Carbon Majors Report 2017, disponible sur https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/002/327/original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf.
Un article plus récent attribue quant à lui à environ 20% des émissions mondiales la part liée aux chaîne d’approvisionnement des multinationales : Zhang, Z., Guan, D., Wang, R. et al. Embodied carbon emissions in the supply chains of multinational enterprises. Nat. Clim. Chang. (2020). https://doi.org/10.1038/s41558-020-0895-9
[3] Voir par exemple le premier article de cette série : https://ingenieurs-engages.org/2020/05/changer-le-systeme-de-linterieur-1/
[4] Le terme “individu” est dans cet article utilisé avec toute l’ambiguïté qu’il porte. Il véhicule aujourd’hui, dans une certaine mesure, l’idée d’une société individualiste : celle du “chacun contre chacun” qui exacerbe non seulement la compétition et l’absence de solidarité, mais également la responsabilité individuelle sur les enjeux collectifs. « And, you know, there’s no such thing as society. There are individual men and women and there are families. » (Margaret Thatcher)
[5] Même si cela serait un exercice intéressant, nous ne proposerons pas de battre en brèche chaque métier d’ingénieur “vert”, mais il est important de bien avoir conscience que chaque métier a des défauts. Si ce n’est pas le cas, c’est probablement que l’on a pas assez creusé la question, et il peut être important de la soumettre avec ouverture d’esprit aux avis extérieurs, par exemple au sein de la communauté Ingénieur·es Engagé·es.
[6] Un rapide état des lieux sur la situation en France : Classens (2019) Opposition à l’éolien : un combat perdu d’avance, révolution-énergétique.com, disponible sur https://www.revolution-energetique.com/opposition-a-leolien-un-combat-perdu-davance
[7] Usuellement désignées de manière condescendante par le « syndrôme NIMBY – Not In My Backyard« , ces oppositions ont bien souvent des raisons très pertinentes. Rien de tel pour creuser le sujet que de consulter les arguments des collectifs directement opposés à ces projets, par exemple : https://environnementdurable.net/lutter.htm. Si ces raisons ne semblent pas toujours rationnelles, elles témoignent en réalité d’une multiplicité des points de vue et des valeurs en jeu dans le développement territorial. A propos du paysage, Fortin (2010) met en évidence les différentes lectures et valeurs qu’il peut y résider en fonction des parties prenantes, ce qui est finalement source de conflits. Voir :
Fortin, M.-J. & Le Floch, S. (2010). Contester les parcs éoliens au nom du paysage : le droit de défendre sa cour contre un certain modèle de développement. Globe, 13 (2), 27–50. https://doi.org/10.7202/1001129a
[8] Un des sujets récurrents est l’impact des éoliennes sur les oiseaux, à propos duquel la LPO a fait un rapport exhaustif. voir LPO (2017) Le parc éolien français et ses impacts sur l’avifaune. Etude des suivis de mortalité réalisés en France de 1997 à 2015 (actualisé en 2017), disponible sur https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/eolien_lpo_2017.pdf
[9] Il existe ainsi certaines initiatives qui se proposent de redonner un contrôle démocratique au développement éolien, comme “l’éolien citoyen”, voir : http://www.eolien-citoyen.fr/accueil
[10] Jean-Marc Jancovici fait office de figure de proue, en France, de la critique des énergies renouvelables. Il ne cache ses intérêts pour l’énergie nucléaire, liés notamment à son activité professionnelle, et il est nécessaire de rester vigilant à son argumentation, qui s’avère parfois erronée ou biaisée, comme le dénoncent parfois les collectifs pro-énergie renouvelables. Ses critiques s’avèrent néanmoins généralement très pertinentes. Sur l’éolien voir notamment :
Jancovici (2014) Pourrait-on alimenter la France en électricité uniquement avec de l’éolien ?, jancovici.com, disponible sur : https://jancovici.com/transition-energetique/renouvelables/pourrait-on-alimenter-la-france-en-electricite-uniquement-avec-de-leolien/
Jancovici (2017) 100% renouvelable pour pas plus cher, fastoche ? disponible sur https://jancovici.com/transition-energetique/renouvelables/100-renouvelable-pour-pas-plus-cher-fastoche/
[11] Voir son utilité personnelle avant tout peut sembler être une stratégie hypocrite et égoïste. De point de vue de l’entreprise, il ne faut également pas oublier que si elle est prête à rémunérer un travail, c’est qu’il lui est profitable, et il n’y a pas lieu à ce que la relation soit hypocrite tant que l’on ne cherche pas à agir contre les intérêts de son employeur. En pratique dans les rapports salariés, l’employé·e est parfois dans une situation défavorable, précarisée par un CDD ou par un stage, ce qui confère de fait une durée de présence limitée.
[12] A ce sujet, voir le livre très complet de Laure Flandrin et Fanny Verrax (2019) Quelle éthique pour l’ingénieur, disponible au format numérique sur https://www.eclm.fr/livre/quelle-ethique-pour-lingenieur%E2%80%AF/
[13] Bihouix (2014), L’Âge des low tech. Vers une civilisation techniquement soutenable, Seuil, 334p.
[14] On peut parler ici du principe d’homéostasie. Ce principe est vrai pour les êtres vivants, et extrapolé pour les organisations. Cette extrapolation est néanmoins plutôt robuste car il est en pratique très rare d’observer une organisation ou une communauté qui ne cherche pas à se préserver et perdurer dans le temps. Voir Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9ostasie
[15] La métaphore de la survie individuelle primant sur la survie collective est magnifiquement illustrée par les cycles de croissances malthusiens des bactéries. Après une croissance exponentielle, les communautés finissent immanquablement par épuiser leurs ressources et s’effondrer. https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_bact%C3%A9rienne
[16] Même si, de plus en plus, les conséquences de changement climatique seront également susceptibles de compromettre la survie des entreprises. La firme Américaine PG&E est à étudier, car c’est l’un des premiers cas de faillite boursière à cause de non prise en compte du réchauffement climatique. Voir Novethic (2019) https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/comment-les-feux-de-forets-californiens-ont-entraine-la-faillite-de-pg-e-un-geant-de-l-energie-americain-146888.html
Il est néanmoins fort à parier que malgré ce contexte, les entreprises continuent à miser sur leur résilience, c’est-à-dire l’adaptation aux conséquences, que sur la diminution de leur impact.
[17] Concept dont que l’on peut attribuer à Servigne (2015) notamment dans son ouvrage Comment tout peut s’effondrer, Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes (Seuil).
[18] Soit dit en passant, il devient de plus de plus difficile de nier les impacts déjà observables, qui ne sont que le résultats d’émissions de GES passées bien inférieures aux émissions actuelles.
[19] Boquet, D. & Lett, D. (2018). Les émotions à l’épreuve du genre. Clio. Femmes, Genre, Histoire, 47(1), 7-22. https://doi.org/10.4000/clio.13961
[20] Voir à ce sujet la conférence menée par Haude Rivoal dans le cadre de l’Université d’été 2020 d’Ingénieur·es Engagé·es : https://youtu.be/flekepeIZmo
[21] Citons notamment l’optimisme technologique (“la Science résoudra tous les problèmes environnementaux”), ainsi que les attaques caricaturales aux positions les plus extrêmes, c’est à dire les hommes-de-pailles classiques que l’on retrouve par exemple à l’encontre des discours décroissant (“On va pas retourner à la bougie” ou ”le modèle Amish”) ou d’effondrements civilisationnels (“Syndrome de Cassandre”).
[22] Lien direct vers le salon : https://discord.gg/y3M9MTahFJ
[23] Ils·elles constituent en cela une cible de choix pour les actions de sensibilisation, au même titre que les dirigeant·es.
[24] Il peut en effet être tentant pour les cadres de reporter la “faute environnementale” sur des employés qui feraient “mal leur boulot”, ou qui ne seraient “pas assez sensibilisés”.
[25] Voir article précédent.
[26] A titre factuel, on peut se référer à la mesure gouvernementale de certains indicateurs. Voir : Etat Français (2019) Opinions des Français sur l’environnement. Fiches Thématiques, disponible sur https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/enjeux-de-societe/les-francais-et-l-environnement/preoccupations-environnementales/article/opinions-des-francais-sur-l-environnement
[27] Amossé T. & Pignoni M.T. (2006), La transformation du paysage syndical depuis 1945. Conditions de travail et relations professionnelles in Données sociales – La société française, édition 2006 pp 405-412. disponible sur http://www.viragehumain.fr/IMG/pdf/La_transformation_du_paysage_syndical.pdf
[28] Voir par exemple le positionnement du groupe Politique d’Ingénieur·es Engagé·es dirigé à l’encontre d’un “éco-syndicat”, qui entre en concurrence avec les luttes sociales portées par les syndicats historiques. https://ingenieurs-engages.org/2020/03/mais-franchement-pourquoi-un-ecosyndicat/
[29] Il existe également un levier “par le haut”, au niveau des politiques et des normes, qui sera l’objet du quatrième article
[30] Article L4131-1 du Code du travail. Voire cette page pour plus d’informations : https://www.saisirprudhommes.com/fiches-prudhommes/droit-de-retrait-du-salarie
[31] Un point sur les suites juridiques de cette affaire : https://www.liberation.fr/checknews/2018/09/11/ou-en-est-l-affaire-arcelormittal-accuse-d-avoir-deverse-des-dechets-toxiques-dans-la-nature_1677948
[32] Voire la magnifique synthèse de Hacking Social : https://www.hacking-social.com/2016/05/09/etre-stupide-ou-lart-du-sabotage-social-selon-les-lecons-de-la-cia/
[33] Le parcours d’Edward Snowden est, à ce titre, édifiant : https://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden
[34] Malgré les penchants sensationnalistes de cette émission, parfois aux dépens de la qualité, elle est un relais important des lanceur·ses d’alerte. A titre d’exemple, ce sont notamment des cadres ingénieur·es de la gestion des eaux qui révèlent de manière anonyme et au risque de leurs carrières, les malversation dont ils·elles ont été témoins, dans l’épisode dédié : Cash Investigation (2018), L’eau : Scandale dans nos tuyaux, disoponible sur https://www.youtube.com/watch?v=IZFkrXduDP4
[35] François Jarrige dresse un tableau très complet de ces luttes dans Jarrige (2019) Technocritiques, Du refus des machines à la contestation des technosciences (La Découverte)